Élise Marrou : « Pour Wittgenstein, penser fait disparaître les confusions et nous éclaire en provoquant une transformation éthique progressive et profonde. »
(propos recueillis par Mathias Moreau)
Dans un entretien passionnant, Élise Marrou, agrégée et docteure en philosophie, maîtresse de conférences à Sorbonne Université, nous propose des clés pour comprendre la pensée de Ludwig Wittgenstein, figure singulière de la philosophie du XXème siècle dans deux ouvrages parus aux P.U.F. et aux Belles Lettres. Sous le prisme de thèmes travaillés par le philosophe, mais parfois laissés de côté par l’exégèse qui nous est parvenue, le Que Sais-Je ? d’Élise Marrou, paru en octobre dernier, est d’une limpidité toute pédagogique pour qui aimerait découvrir la pensée du théoricien autrichien, génial touche-à-tout à l’histoire personnelle flamboyante. Il suffit d’ailleurs de regarder les portraits photographiques de Wittgenstein pour imaginer quel esprit il était, sombre et lumineux, traversé par le récit familial – culturellement riche mais loin d’être épargné par les drames – et les événements non moins tragiques que la première partie du XXème siècle a produit. Ami des peintres de l’école de Vienne, élève de Bertrand Russell, Wittgenstein a laissé une œuvre courte mais d’une intensité et d’une originalité rares, hissant sa pensée parmi les plus étincelantes de toute l’histoire de la philosophie.
Mathias Moreau : Ludwig Wittgenstein semble un philosophe quelque peu à l’écart dans l’histoire de la philosophie. De par son ascendance incroyable d’un côté, et de l’autre par sa philosophie elle-même. Comment le présenter succinctement en évoquant son parcours personnel ?
Élise Marrou : Vous avez tout à fait raison, Wittgenstein est un philosophe à part. La manière dont il est entré en philosophie peut faire penser à la caractérisation que Nietzsche donne du philosophe comme une « comète imprévisible ». Il a grandi dans la Vienne fin de siècle1, fascinante en raison de ses avant-gardes picturales (son père, Karl Wittgenstein a été le mécène de Klimt et de la Sécession, et des Wiener Werkstätte, Wittgenstein léguera une partie de sa fortune à Kokoschka, ainsi qu’à d’autres expressionnistes), architecturales (c’est la Vienne d’Adolf Loos et d’Otto Wagner qui tiennent à se distinguer du mouvement de la Sécession, en attaquant avec virulence la rhétorique de l’ornementation), littéraires et poétiques, enfin (Else Lasker-Schüler, Trakl et Rilke sont les poètes auxquels le philosophe viennois cède l’autre partie de son héritage familial). La famille Wittgenstein accorde enfin la plus grande importance à la musique (la mère de Wittgenstein, Léopoldine est une pianiste virtuose, Brahms et Gustav Mahler sont des habitués du salon de musique du Palais de l’Alleegasse). C’est d’ailleurs pour Paul, l’un des frères de Ludwig, que Ravel a composé le Concerto pour la main gauche. C’est dans ces mêmes années qu’on assiste à Vienne à la naissance de la psychanalyse. La sœur de Ludwig Wittgenstein, Margaret, est l’une des premières patientes de Freud. Elle l’aide à quitter l’Autriche après l’Anschluss en 1938. Wittgenstein a ainsi réfléchi très tôt à ce qui se joue dans cet usage singulier de la parole. Il reprend d’ailleurs dans les Recherches philosophiques le terme de « thérapie » pour qualifier le travail descriptif du philosophe.
Rien ne semble alors engager le jeune Ludwig qui grandit à Vienne dans une voie philosophique : il entame des études d’ingénieur à Berlin, et quitte l’Autriche pour rejoindre une station d’aéronautique en Angleterre. Son entrée en philosophie se fait alors d’une manière soudaine : il découvre dans des cours à l’université de Manchester les problèmes liés à la crise des fondements qui préoccupaient alors les mathématiciens et les logiciens. Il rend alors visite à Gottlob Frege à Iéna en Allemagne, puis sur le conseil du logicien allemand, part faire la connaissance de Bertrand Russell à Cambridge. Logicomix, la bande dessinée d’Apóstolos Doxiádis et de Christos Papadimitriou donne une représentation fidèle de cette rencontre qui est décisive pour l’un et l’autre2 : Wittgenstein, d’abord étudiant de Russell qui est de dix-sept ans son aîné, devient rapidement l’un de ses plus précieux interlocuteurs.
Comme l’a montré Sébastien Gandon, il faut ici se méfier de « l’illusion rétrospective » selon laquelle les noms de Frege et de Russell seraient déjà en 1921 « associés à une tradition3 ». Lorsque Wittgenstein se tourne vers la philosophie, les échanges avec Frege qui se poursuivront par une correspondance durant la première guerre, et avec Russell à Cambridge, sont avant tout ceux d’un jeune logicien avec deux professeurs qui explorent chacun avec des intérêts propres et de manière indépendante les ressources qu’offre la nouvelle logique. Le Tractatus, le premier ouvrage de Wittgenstein, qui paraît en 1921, s’inscrit dans ce sillage. Comme il le souligne dans sa préface, la philosophie n’est pas selon lui une théorie, mais une activité, et plus précisément une activité de clarification. Une fois qu’il aura mis la dernière main au Tractatus, issu des carnets qu’il a noircis au front durant la première guerre mondiale, Wittgenstein décide de mettre un terme à ses recherches en philosophie et devient instituteur. Il garde toutefois le contact avec Frank Ramsey, un jeune mathématicien particulièrement brillant de Cambridge qui viendra lui rendre visite en Autriche et avec Keynes qui l’encourage à rentrer à Cambridge et à y poursuivre ses travaux après la guerre. À partir du début des années trente, Wittgenstein commence à enseigner à l’université de Cambridge. Les Recherches philosophiques, son second ouvrage, prolongent et radicalisent la rupture avec les méthodes plus traditionnelles de philosopher. La philosophie selon lui ressaisit « les possibilités des phénomènes » par la description de nos usages courants, et prend ainsi la forme d’une thérapie qui doit être réinventée à chacun de ses usages, c’est-à-dire qui doit s’ajuster à chaque problème ou chaque inquiétude particulière qui surgit en nous. Dans la continuité des Recherches, Wittgenstein fait porter son enquête sur les concepts de la psychologie. Il y consacre ses derniers cours à Cambridge durant les années 40. Cette philosophie de la psychologie est accessible aujourd’hui par la lecture de ses manuscrits4. Il cesse d’enseigner à Cambridge en 1947. Après un voyage rapide aux États-Unis au terme duquel il rédige De la certitude, il rentre en Europe et meurt d’un cancer le 29 avril 1951.

Au début de votre livre, page 13, vous avancez le fait que pour Wittgenstein, s’intéresser à la philosophie « c’est aussi prendre la mesure du renversement axiologique que cette activité produit […] » On pourrait percevoir ici les influences de Schopenhauer et Nietzsche, mais qu’en est-il réellement de cette axiologie pour lui ?
Wittgenstein caractérise la pensée d’une manière qui prend acte du tournant que Schopenhauer et Nietzsche ont engagé en philosophie.
Wittgenstein connaissait bien l’œuvre de Schopenhauer qui est par ailleurs l’un des philosophes les plus lus à Vienne lorsqu’il commence ses études. Le jeune Wittgenstein est profondément marqué par l’opposition entre la volonté et la représentation et par le déplacement, très tôt et brillamment identifié par Clément Rosset en France, d’une pensée spéculative à une philosophie de l’affectivité et du couple vérité/fausseté à celui du sens et de l’absurdité. Schopenhauer est pour Wittgenstein aussi un éducateur dans la mesure même où l’auteur du Monde comme volonté et comme représentation a radicalement transformé ce que nous entendons par « vouloir ». Pour le philosophe viennois, ce n’est pas seulement l’éthique et l’esthétique qui procurent une suspension de notre soumission au vouloir aveugle, mais la pensée elle-même
L’éthique redéfinie par Wittgenstein ne porte pas sur la conduite que nous devons adopter. Elle ne répond pas à la question : que devons-nous faire ? Wittgenstein affirme très nettement qu’il n’y a pas de devoir en soi (« Ein Soll an sich ist unsinnig5 ») et condamne avec force l’entreprise de fondation de la morale en renversant avec ironie la formule de Schopenhauer : « Prêcher la morale est une chose facile, la fonder chose difficile » en « Prêcher la morale est chose ardue, la fonder est impossible6 ». Le philosophe n’a pas plus à fonder la morale qu’à en donner la formule.
Dans sa conférence sur l’éthique, Wittgenstein part de la définition des Principia de G. E. Moore, « l’enquête générale visant à déterminer ce qui est bon » et en élargit la portée : « la recherche de ce qui a une valeur », « de ce qui compte réellement », du « sens de la vie », de « ce qui rend la vie digne d’être vécue » et propose une caractérisation par « airs de famille » de l’éthique pour souligner l’écart qui sépare le sens trivial ou relatif que nous donnons à « bon » ou « mauvais » du sens absolu, de la valeur intrinsèque. L’interrogation éthique ne concerne pas du tout les voies et les moyens à utiliser pour un certain résultat, elle porte sur la recta vivendi ratio, c’est-à-dire le bon chemin absolument, la voie sans considération aucune des moyens7 : « On ne peut conduire les hommes vers le bien ; on ne peut les conduire qu’à tel endroit ou à tel autre. Le bien est en dehors de l’espace des faits8 ». L’éthique ainsi requalifiée se situe aux antipodes d’un savoir vivre ou d’un art de vivre : on saurait formuler de préceptes généraux qui vaudraient comme autant de règles pouvant nous orienter ou nous guider.
Wittgenstein, qui prend pour cible notre soif de généralité (craving for generality) comme source principale des confusions en philosophie, s’en méfie tout autant sur le terrain éthique. Pour communiquer et transmettre le sens absolu de l’éthique, Wittgenstein s’appuie sur trois expériences qui sont pour lui des expériences éthiques, dont la première est selon lui l’expérience par excellence : celle de l’étonnement ou du miracle de l’existence du monde, le sentiment de sécurité absolue et l’expérience de la culpabilité absolue. « En tant qu’elle provient du désir de dire quelque chose du sens ultime de la vie, du bien absolu, de la valeur absolue », l’éthique ne saurait être « une science ». Elle ne peut ajouter quoi que ce soit à notre savoir, mais témoigne d’un « penchant de l’esprit humain » pour lequel Wittgenstein a le plus grand respect et qu’il ne ridiculiserait pour rien au monde.
Mais il faut ajouter que là où l’éthique est en jeu, le sujet entre en scène et s’anéantit en tant qu’ipséité autarcique et autosuffisante. L’éthique est avant tout relation et soumission à une transcendance que Wittgenstein nomme comme dans les carnets de guerre le plus souvent Esprit (Geist)9. On ne saurait conduire ou guider quiconque à instruire cette relation qui, seule, peut donner à la vie d’une personne sa forme propre : « Si quelque chose est bon, alors c’est également divin. Voilà qui, étrangement, résume mon éthique10. » Le travail sur soi prend ici le sens régulateur d’une justesse et d’une adéquation à soi qui ne sont jamais définitivement acquises. Paradoxalement, ce sens de la justesse et de la vérité à soi ne peut s’acquérir que par l’apprentissage de cet équilibre dans une forme de déséquilibre (ou de confiance sur le fonds d’un doute constitutif). La volonté ne peut opérer et devenir effective qu’à condition de reconnaître ce décalage entre ce que je suis et ce que je devrais être. À cet égard, Wittgenstein est très proche de l’injonction de Kafka : du bist die Aufgabe, et pose la « supériorité de l’éthique » tant vis-à-vis de la morale que de la Sittlichkeit.

On peut en effet soutenir que l’éthique est pour lui « celle de la tournure qu’il nous faut donner à notre vie pour pouvoir la vivre justement11 » où « donner une tournure à sa vie, c’est d’une certaine manière lui donner un « sens » – ce terme voulant dire ici direction, orientation, issue viable ». Cette modification ne peut être le fait d’une volonté empirique, ni d’une conscience individuelle. Le philosophe viennois reprend ici une opposition qu’il tient de Schopenhauer entre une conduite vertueuse et un système de vie raisonnable12.
Le point le plus décisif de sa lecture du Monde est sans doute la manière dont Schopenhauer dans la troisième partie, décrit la contemplation esthétique : grâce à elle, le sujet est délivré des relations conformément au principe de raison, et devient « un sujet pur », « un pur sujet connaissant », « un sujet affranchi de la volonté ». Schopenhauer souligne la soudaineté de ce passage, de ce basculement et le caractérise comme un affranchissement13. Cette élévation à cette nouvelle perspective, à ce qu’il nomme également un nouveau point de vue, procède de « la force de l’intelligence ». On ne considère plus alors « ni le lieu, ni le temps, ni le pourquoi, ni l’à quoi bon des choses, mais purement et simplement leur nature ». La conscience n’est plus alors occupée par « la pensée abstraite », ni par « les principes de la raison », et toute la puissance de son esprit est tournée vers l’intuition. La contemplation esthétique pour Schopenhauer permet une désindividuation : on ne subsiste plus que comme sujet pur, comme « clair miroir de l’objet », de telle sorte que « tout se passe comme si l’objet existait seul, sans personne qui ne le perçoive ». Ce qui est ainsi connu, ce n’est plus la chose particulière en tant qu’elle est particulière, mais l’Idée, la forme éternelle, l’objectité immédiate de la volonté. Pour Schopenhauer, c’est précisément « ce que petit à petit, Spinoza découvrait lorsqu’il écrivait : mens aeterna est, quatenus res sub aternitatis specie concipit. [L’esprit est éternel, dans la mesure où il conçoit les choses du point de vue de l’éternité.] Eth, V, prop. 31 , sch14. » L’art est bien mode de connaissance pour Schopenhauer, un mode de connaissance qui arrache l’objet de sa contemplation au courant fugitif des phénomènes :
Il le possède isolé devant lui ; et cet objet particulier, qui n’était dans le courant des phénomènes qu’une partie insignifiante et fugitive, devient pour l’art le représentant du tout, l’équivalent de cette pluralité infinie qui remplit le temps et l’espace. L’art s’en tient par la suite à cet objet particulier ; il arrête la roue du temps, les relations disparaissent pour lui ; ce n’est que l’essentiel, ce n’est que l’Idée qui constitue son objet15.
C’est sans doute de la lecture du Monde que Wittgenstein tient la locution latine qu’il transpose légèrement (eterni plutôt qu’aeternitatis) : « outre le travail de l’artiste, il existe encore une autre façon de saisir le monde sub specie aeterni : c’est, à ce que je crois, la pensée, qui, pour ainsi dire, s’élève dans son vol au-dessus du monde et qui le laisse tel qu’il est – le considérant d’en haut, en vol16 ». En effet, pour Wittgenstein, il ne fait pas de doute que « l’éthique n’a rien à voir avec le châtiment ou la récompense au sens usuel. […] S’il doit y avoir, en vérité, une espèce de châtiment et une espèce de récompense éthiques, ils doivent se trouver dans l’acte lui-même17 ». Il est difficile de ne pas lire ici un écho à la dernière proposition de l’Éthique : « La béatitude n’est pas la récompense de la vertu, mais la vertu même18 ». La pensée, une fois mise en mouvement est littéralement un processus de libération. Elle clarifie ce que nous faisons et par là, trace la voie que nous devons suivre. Produire de la clarté ou pour le dire dans une langue plus courante, y voir plus clair, ce n’est certainement pas restreindre les bornes ou l’étendue de nos capacités cognitives, mais être attentif à la dimension nécessairement éthique de la pensée. Cette dernière se confond avec son déploiement, c’est-à-dire avec son opération, sa mise en œuvre. Ce n’est pas donc asséner des thèses, ni élaborer une théorie, c’est une activité19. Penser n’a rien de neutre pour Wittgenstein, ni de purement négatif ou destructeur, C’est une reconfiguration profonde, progressive, ininterrompue de la voie dans laquelle s’engage celle ou de celui qui applique cette méthode. Pour Wittgenstein, comme pour Spinoza, penser nous fait accéder à une saisie du monde sub specie eterni.
Mais à mon avis la marque de Nietzsche sur la pensée de Wittgenstein est plus profonde encore. Comme le remarque Jacques Le Rider dans Modernités viennoises et crises de l’identité, « pour la majorité des modernes viennois, le nietzschéisme représentait le point de départ de leurs itinéraires individuels20 ». Faute de place, je me contenterai ici de deux remarques qui attestent l’importance de la lecture de Nietzsche pour Wittgenstein21 : les Carnets de guerre attestent que Wittgenstein s’était procuré le volume VIII des Œuvres complètes22 de Nietzsche . Il s’y réfère à propos de la difficulté solipsiste qui le préoccupe :
Pourquoi, cependant, ne pourrait-on pas vivre une vie dépourvue de sens ? Est-ce une chose indigne ? Comment cela s’accorde-t-il avec le point de vue rigoureusement solipsiste ? Mais que faut-il faire pour que ma vie ne soit pas perdue ? Je dois toujours être conscient de l’esprit, en être toujours conscient23.
Les convergences entre la généalogie nietzschéenne et la méthode de Wittgenstein sont également manifestes dans De la certitude qui souligne le manque de fondement de nos certitudes et de nos croyances : « Au fondement de la croyance bien fondée est une croyance non fondée24. » Au lieu de combler le vide créé par l’angoisse du manque de fondement, Wittgenstein le révèle donc pour ce qu’il est. L’expérience philosophique fondamentale est celle de « l’angoisse face aux incertitudes ultimes25 ». Elle consiste à affronter la « terreur infligée » par le réel. Au lieu de conjurer le scepticisme, ce déplacement plus profond du sens de la certitude le redéfinit. Le monde, plutôt qu’au principe de raison suffisante de Leibniz, n’obéit plus qu’à ce que Blumenberg nomme avec Musil « le principe de raison insuffisante ».
Par conséquent, lorsque, dans le livre paru aux Puf au mois d’octobre, j’évoque le « renversement axiologique » que produit la pensée philosophique selon Wittgenstein, je voulais avant tout souligner que pour le philosophe viennois, une pensée qui laisse indemne le penseur ne vaudrait pas une heure de peine. Car c’est bien là ce dont il s’agit en philosophie pour Wittgenstein, comme pour Nietzsche : penser clarifie certes, dissipe et fait disparaître les confusions, mais ce faisant, nous éclaire non au sens cartésien de l’évidence, mais en provoquant une transformation éthique progressive et profonde du penseur. Cette dynamique de la pensée n’est pas d’emblée rapportée à l’activité d’un sujet pensant ou d’un sujet de la représentation, mais à une personne qui désire y voir plus clair dans la conduite de son existence et qui rompt ainsi avec la hiérarchisation courante des biens ordinaires pour lui substituer une autre configuration de valeurs. Pour le dire dans les termes du Tractatus, «le monde de l’homme heureux est un autre monde que celui de l’homme malheureux26 ». Pour nos deux auteurs, s’engager dans la pensée, c’est engager une démarche qui est d’ordre pratique et qui, pour cette raison même, n’est pas dissociable d’une axiologie : elle clarifie par son cheminement même non seulement l’horizon vers lequel la pensée nous oriente et nous guide, mais ce qu’il faut entendre ici par le régime des fins et des moyens, et avant tout le renversement que cette activité produit sur l’entente courante de cette opposition.

Quelques pages plus loin, vous affirmez que pour comprendre Wittgenstein nous devons nous confronter à une pensée qui ne s’est jamais autant investie face aux problèmes que soulevait la philosophie, c’est-à-dire remonter à la racine de tout problème. Qu’entendez-vous par-là ?
Lorsque j’ai commencé à lire Wittgenstein et à découvrir sa pensée dans les années 1990, le philosophe viennois était souvent présenté comme un philosophe pour lequel les problèmes de la philosophie (de la métaphysique) étaient des faux (ou des pseudo) problèmes dont nous étions supposés nous délivrer d’un revers de main. C’est une sorte d’image d’Épinal, très courante et encore répandue aujourd’hui qui assimile l’activité de clarification menée par Wittgenstein au programme positiviste du cercle de Vienne. En m’immergeant dans sa pensée et en prenant au sérieux ce que fait le philosophe viennois lorsqu’il s’empare d’un problème, je me suis rendu compte qu’il est parmi les philosophes qui accordent le plus d’importance à ce qu’un problème philosophique peut avoir de résistant, de tenace, de profond et donc au fait décisif pour lui qu’on ne règle pas un problème philosophique à si bon compte. Comme il l’a enseigné dans ses cours des années trente à Cambridge de manière plus imagée, en philosophie, « il faut s’immerger dans la boue du problème » et surtout « ne pas court-circuiter la difficulté », même si cela n’a rien de confortable. Celui qui se heurte à un problème philosophique ne peut le résoudre qu’« en remontant à la racine même de l’incertitude27 ». Je tiens beaucoup à ce trait qui caractérise selon moi sa méthode et la distingue de celle des membres du cercle de Vienne, en tout cas de la forme que Carnap en a donné : Wittgenstein a collaboré avec les positivistes du cercle de Vienne, Schlick et Waismann sont devenus pour lui des interlocuteurs de premier ordre, mais il n’a jamais fait sien le Manifeste du cercle de Vienne (il n’accepte pas le critère de démarcation entre ce que nous disons avec sens et les absurdités que nous proférons, et le combat à mener contre la métaphysique n’est pas du même ordre pour lui). Si « en logique tout ce qui est possible est aussi permis » écrit encore l’auteur du Tractatus en 5.473 dans une formule qui de nouveau rappelle Spinoza, le philosophe n’est pas celui qui démarque les propositions sensées et délivre le critère de signification de tout énoncé bien formé, mais justement celui qui nous aide à gagner une perception plus aiguë, sensée, de ce que nous disons, dès lors que la confusion ou le non-sens ne procède pas d’un « clash » de catégories, mais d’une relation confuse que nous entretenons avec nos propres mots.
J’aime beaucoup la citation que vous utilisez page 19, issue de la préface du Tractatus logico-philosophicus, « […] ce qui peut être dit en général peut être dit clairement ; et sur ce dont on ne peut parler, on doit se taire. » Est-ce un résumé suffisant pour comprendre ce que veut dire Wittgenstein à propos du langage ?
On pourrait répondre immédiatement par l’affirmative. C’est ce que l’auteur du Tractatus écrit en effet dans sa préface lorsqu’il revient sur son ambition dans ce premier ouvrage. Toute la difficulté reste de comprendre ce qui distingue la première partie de la formule « ce qui peut être dit en général peut être dit clairement » de Boileau ou de Descartes. Et pour ce faire, il faut parcourir chaque étape ou pour reprendre l’image que Wittgenstein utilise, chaque barreau de l’échelle que constitue le traité. On ne peut pas faire l’économie de ce cheminement et se contenter du résumé de son ambition ou de sa visée. Quant à la dernière proposition du Tractatus qui a paradoxalement fait couler beaucoup d’encre, « Sur ce dont on ne peut parler, on doit se taire », on peut l’entendre d’au moins deux façons : cette dernière proposition a souvent été lue comme une injonction – mystique – au silence dans laquelle culminerait le traité. Dans Wittgenstein et les limites du langage, Pierre Hadot inscrit le Tractatus dans la tradition de la théologie négative, l’analyse logique est dépassée de l’intérieur par le couronnement mystique du traité. « Voir correctement le monde » coïncide avec l’exigence finale du traité, celle d’un renoncement à la parole. L’échelle illustre le point de basculement du logique au mystique. Mais il est possible de la lire aussi comme une tentative en philosophie de poser à nouveaux frais la question des limites du sens et d’y voir le rappel de ce que Wittgenstein martèle dès 1914 dans ses carnets de guerre : « la logique prend soin d’elle-même ». Le philosophe n’a ni à se soucier de rappeler aux « égarés » les limites du sens, car on ne saurait les transgresser comme des frontières qui feraient du sens et du non-sens deux domaines distincts (même si l’on peut évidemment dire des absurdités), ni à revenir de manière « méta » sur ces limites : c’est l’interprétation que l’on appelle aujourd’hui austère du Tractatus dont les grandes lignes ont été formulées par Cora Diamond dans The Realistic Spirit et qui ont été développées par James Conant (on retrouve ces lectures dans le collectif The New Wittgenstein). L’une des idées centrales de cette nouvelle interprétation est de rompre avec ce dépassement du logique par le mystique et de proposer une lecture immanente et non transcendante de l’échelle à gravir dans le Tractatus, proposition par proposition ou barreau par barreau.
Dans cette nouvelle lecture, chaque proposition du traité est une illusion que l’auteur du Tractatus nous invite à parcourir de l’intérieur pour nous en délivrer. Cette nouvelle interprétation me paraît tout à fait convaincante dans sa dimension critique. Je crois toutefois que l’on peut proposer une troisième voie qui n’est pas incompatible avec la précédente et qui consiste à prendre au sérieux l’origine sceptique de l’image de l’échelle qui clôt le Tractatus. Comme l’a bien vu Jacques Brunschwig dans son article « L’aphasie pyrrhonienne28 », Sextus Empiricus emploie cette image dans son Contre les savants pour comparer les formules sceptiques, les phonai skeptikai à des purges qui nous délivrent des humeurs du corps et s’éliminent avec ces humeurs. Dans l’usage qu’en propose Sextus, le rejet de l’échelle renvoie à l’auto-suppression des formules sceptiques qui mettent le langage à la question. Si l’on retraduit cette idée dans des termes plus contemporains, le statut des propositions du Tractatus est comparable à celui des formules sceptiques qui ne sont pas thétiques, mais s’auto-détruisent après usage, une fois le cheminement parcouru. On comprend mieux alors que « la philosophie n’est pas une théorie, mais une activité29 », et qu’ « une œuvre philosophique se compose essentiellement d’éclaircissements30 ».
On comprend au fur et à mesure de votre ouvrage que Wittgenstein entend la philosophie comme un outil pour clarifier logiquement la pensée. Page 40, vous le citez : « Le langage déguise la pensée […] »
Je ne suis pas sûre que Wittgenstein approuverait le terme d’outil. Disons que c’est une activité qui est clarificatrice. Dans le passage du Tractatus que vous citez, « Le langage déguise déguise la pensée31 », il est question des relations entre langue ordinaire et logique. Wittgenstein ne veut pas dire ici que le langage courant soit imparfait logiquement ou en désordre. Pour l’auteur du Tractatus, recourir à une langue symbolique est utile pour mettre en évidence la syntaxe logique de notre langage, mais ce n’est pas une critique adressée au langage ordinaire. Il écrit un peu plus tard à son traducteur anglais, Ogden : « Par là, je veux dire que les propositions de notre langage ordinaire ne sont en aucune façon logiquement moins correctes ou moins exactes ou plus confuses que les propositions écrites dans le symbolisme de Russell ou dans quelque autre Begriffschrift. Seulement il nous est plus facile de saisir leur forme logique lorsqu’elles sont exprimées dans un symbolisme approprié ». Wittgenstein souligne ici avant tout qu’on ne peut « déchiffrer la logique du langage à partir du langage ordinaire32 », précisément parce que « le langage ordinaire est une partie de l’organisme humain et n’est pas moins compliqué que lui ».
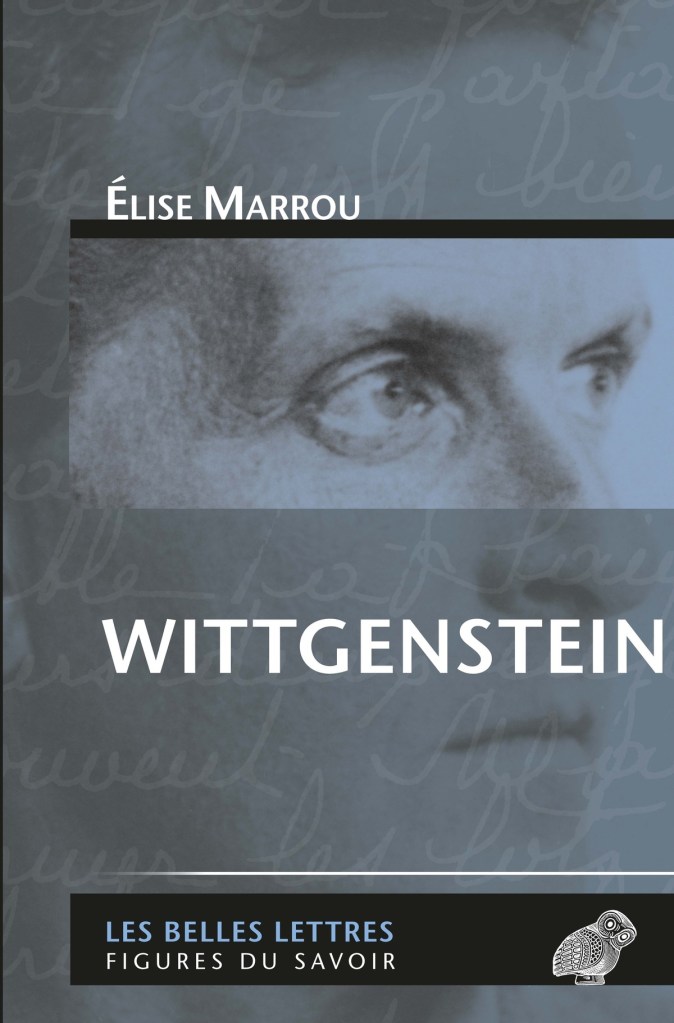
Même si l’objet d’étude principal de Wittgenstein est le langage, il s’intéresse évidemment à d’autres concepts, comme celui de l’éthique qu’il évoque dans Conférence sur l’éthique mais aussi dans Leçons et Conversations sur l’esthétique, la psychologie et la croyance religieuse. Il est intéressant de le lire expliquer ceci : « […] écrire ou parler sur l’éthique ou la religion, [c’est] affronter les bornes du langage […] » Il explique ensuite que l’éthique n’est pas une science, car « […] elle n’ajoute rien à notre savoir mais elle nous documente sur une tendance qui existe dans l’esprit de l’homme […]
Il est important – je crois – de souligner que le langage n’est pas un objet d’étude pour Wittgenstein. La pensée en philosophie, contrairement aux méthodes des sciences dures qui sont explicatives, nous transforme nécessairement sur le plan éthique. La méthode en philosophie n’est pas explicative, repose sur la description de nos usages langagiers. Wittgenstein est un philosophe qui s’intéresse aussi bien à l’intention, à ce qui distingue un sentiment d’une émotion ou que à ce que c’est qu’attendre quelque chose ou quelqu’un. La méthode thérapeutique s’appuie sur des jeux de langage qui sont autant de modélisations de nos usages (modélisations au sens où elles en font ressortir les contours et les lignes directrices de nos usages). Le point à mon sens le plus intéressant ici est qu’il paraît difficile de distinguer une éthique qui est celle du philosophe qui travaille à se délivrer d’inquiétudes conceptuelles par ce rappel de nos jeux de langage d’une seconde éthique en première personne qui serait celle de tout être humain. Pour le dire schématiquement, je crois qu’il n’y a pas d’un côté le travail de clarification qu’effectue le philosophe à des fins qui seraient purement conceptuelles et de l’autre la question éthique de la conduite de son existence. Bien entendu, certaines questions sont (ou paraissent) plus spéculatives que d’autres et certaines inquiétudes prennent une forme plus nettement éthique. Mais dès que nous recherchons de la clarté sur une question donnée, nous opérons pour Wittgenstein un renversement axiologique ou un renversement des valeurs pour reprendre l’expression de Nietzsche qui nous transforme de manière effective.
Peut-on faire un parallèle entre le langage et l’apprentissage de la volonté ?
Dans les Recherches, Wittgenstein reprend un extrait des Confessions de Saint Augustin, dans lequel l’évêque d’Hippone fait le récit de son apprentissage du langage. L’enfant silencieux observe la conduite des adultes qui l’entourent en faisant correspondre aux mots qu’il entend les objets qu’il désigne. Il souligne dans ce portrait de l’apprentissage du langage que le langage est l’instrument de la volonté. Sa maîtrise permet aux adultes d’exprimer ce qu’ils veulent et à l’enfant devenant compétent sur le plan langagier, l’instrument de la volonté. Wittgenstein s’oppose à cette compréhension de l’apprentissage du langage. Pour lui, lorsque nous apprenons à parler, nous apprenons toujours plus qu’une correspondance des mots et des choses, nous apprenons à projeter nos mots dans des activités. Nous ne séparons pas nos mots de celles-ci lorsque nous caractérisons leur signification. On ne peut donc pas dire qu’apprendre à parler pour Wittgenstein se réduise à apprendre à exprimer ses volontés. Il prend au contraire le contrepied de cette conception. En revanche, apprendre à parler, c’est entre autres choses, apprendre l’usage des concepts psychologiques, de la manière dont nous exprimons une volonté, ou un désir, dont nous sommes ainsi capables de distinguer ce que nous voulons de ce que nous désirons ou de ce que nous souhaitons par exemple. Dans cette seconde acception de l’apprentissage de la volonté, c’est-à-dire si l’apprentissage de la volonté ou apprendre à vouloir, c’est apprendre les jeux de langage du volontaire et de l’involontaire, alors, oui, il est possible de répondre par l’affirmative à votre question. Sans revenir sur ce qui a été dit déjà en réponse à votre seconde question concernant l’héritage schopenhauerien de Wittgenstein – apprendre à parler, c’est entre autres choses apprendre à exprimer ses volontés et à les faire connaître (y compris à soi-même). Enfin, pour Wittgenstein, penser en philosophie requiert bien plus que des capacités intellectuelles, le courage de la volonté. C’est en effet au courage qu’il se réfère constamment dans ses remarques pour caractériser ce qui fait le prix – et la qualité – d’une réflexion philosophique : « L’essentiel est – je crois – que l’activité d’éclaircissement doit être menée avec COURAGE : si celui-ci manque, elle n’est plus qu’un jeu de l’intelligence33 ». Ou encore : « on pourrait mettre des prix aux pensées. Certaines coûteraient fort cher, d’autres très peu. Et quelle est l’unité de compte pour les pensées ? Le courage, je crois34 ».
Votre Que Sais-Je ? se termine avec la réflexion de Wittgenstein sur l’intériorité. Nous savons que c’est un sujet brûlant en philosophie. Comment donc penser l’intime avec lui ?
Merci beaucoup de cette dernière question. À vrai dire, c’est le point de l’ouvrage paru en octobre qui me tient le plus à cœur. Jacques Bouveresse avait montré de manière tout à fait remarquable et pionnière dans Le mythe de l’intériorité que Wittgenstein soumet à son lecteur dans les Recherches philosophiques un ensemble d’exercices et d’expériences de pensée au sens le plus large du terme qui font imploser le mythe d’une parole qui trouverait exclusivement en elle-même les ressources de production de son sens, c’est-à-dire d’une parole qui ne ferait pas appel au monde et aux échanges langagiers que nous pouvons avoir avec d’autres. Bouveresse a ainsi dégagé de la pensée de Wittgenstein « une analyse et une critique véritable de la notion de sujet » qui me paraît aujourd’hui définitivement acquise.
C’est la raison pour laquelle je me suis concentrée dans le dernier chapitre de mon livre sur la contrepartie positive de cette critique : comment penser à partir de Wittgenstein la distinction entre l’intérieur et l’extérieur, le privé et le public ? Quelles leçons pouvons-nous tirer de la critique d’un langage privé ? Pour ce faire, je me suis appuyée en partie sur les réflexions d’Hannah Arendt dans La Vie de l’esprit et de Michaël Foessel dans La privation de l’intime. Michaël Foessel définit l’intimité par contraste avec la privauté comme « l’ensemble des liens qu’un individu décide de retrancher de l’espace social pour s’en préserver et élaborer son expérience à l’abri des regards ». L’intimité n’est pas pour lui le lieu d’une confirmation solipsiste du repli sur soi, mais qu’il y a celui d’ « une désappropriation de soi ».
J’ai tenté de mettre en évidence dans le dernier chapitre du livre paru aux Puf que Wittgenstein nous permet de penser cette désappropriation de soi en suivant différentes lignes de force. J’ai distingué trois niveaux dans l’analyse de l’intériorité qu’il nous propose :
– Le premier est celui d’une cartographie de l’intériorité, c’est le travail descriptif que Wittgenstein effectue sur les concepts psychologiques que nous utilisons constamment (comment par exemple distinguer une émotion comme la peur d’une disposition (une croyance) ou d’un sentiment amoureux ?). Il s’agit ici avant tout de dissiper un certain nombre de confusions qui touchent à notre usage des concepts psychologiques. Cette cartographie n’a rien à voir avec une mise en ordre, elle consiste au contraire à révéler les traits différentiels de notre vie intérieur.
– Le second est celui des « institutions de l’intériorité » – j’emprunte cette locution à Pierre Pachet, qui transpose ainsi la formule de Vincent Descombes « les institutions du sens » aux pratiques de l’intériorité. Comme l’écrit l’auteur des Baromètres de l’âme, le paradoxe du journal intime est celui d’une œuvre qui suscite un « for intérieur », en le vouant à la publication. Ce point est particulièrement intéressant et doit retenir à mon sens davantage l’attention des philosophes, car ce paradoxe d’un travail sur soi qui est voué à la publicité (au sens premier du terme) n’est nullement isolé. Il concerne la grande majorité des pratiques de soi. En effet, en étudiant la naissance du journal intime entendu comme nouveau genre littéraire et instrument de perfectionnement moral, Pierre Pachet a montré que le journal intime marque une « étape sur la voie de la privatisation et de la laïcisation, du travail spirituel sur soi ». L’auteur du Premier venu donne ici à l’intériorité un sens précis : « l’intériorité est une institution au sens où, pour qu’elle existe, il faut des conditions de la vie sociale, et des innovations qui émergent et s’imposent… ; en quelque sorte, ce sont les hommes qui l’ont créée, ce sont les hommes qui, dans la vie, dans l’histoire de la culture et des formes de vie, ont rendu possible et rendent possible cette dimension de l’existence35 ». Le journal intime résulte de cette lutte entre « cette part de la parole qui tend passionnément à la diffusion la plus large et la parole au contraire qui veut s’enfoncer dans l’intimité de l’individu, rester dans un cercle étroit, descendre même dans l’intimité de l’individu pour le séparer de lui-même, pour le mettre en relation avec lui-même par le moyen de ce qu’il y a de plus collectif, de plus universel, de plus impersonnel le langage36 ». Le modèle de l’intériorité n’est pour lui pas celui d’un for intérieur, mais du complot en un sens précis : un « complot pour se préserver, pour continuer à être soi, le complot visant à continuer à ne pas être vu dans son intériorité, à ne pas y être gouverné ». De son côté, Vincent Descombes a montré dans Les institutions du sens que la philosophie de l’esprit la plus courante laisse de côté « la part impersonnelle du mental », « les acteurs ne manifestent pas seulement des capacités mentales attachées à leurs personnes respectives, mais aussi des manières de penser communes, des institutions de sens formant ce qu’on appelle un esprit objectif ». C’est précisément là ce que Descombes entend par institutions du sens, reprenant le sens que Fauconnet et Mauss donnaient à ce terme dans l’article « Sociologie » de la Grande Encyclopédie » : « un ensemble d’actes ou d’idées tout institué que les individus trouvent devant eux et qui s’imposent plus ou moins à eux37 », c’est la présence du social dans l’esprit de chacun. Or, les pratiques qui concernent l’intériorité et plus largement les relations que nous entretenons avec nous-mêmes ne font pas exception ici. Ce qui nous paraît souvent comme le comble de l’intimité (c’est-à-dire comme le superlatif de l’intériorité) tombe lui aussi sous le coup de cette normativité sociale, qui ne se réduit bien entendu pas à une contrainte, mais qui est par principe socialement partagée. C’est cette idée que je me suis efforcée de prolonger dans le livre pour souligner que faire vivre un espoir, avoir une idée en tête ou attendre ardemment quelqu’un sont des dynamiques qui sont ancrées dans des expressions corporelles et linguistiques qui tissent ensemble le sens du récit en première personne. Cette grammaire de la subjectivité est une grammaire en première personne au sens plus précis que nous entretenons constamment avec nous-mêmes des relations qui nous font osciller entre appropriation et désappropriation ; c’est précisément dans cet écart que se loge la distinction entre la vie de notre intériorité et celle de notre responsabilité en tant qu’agents. C’est ce qui se joue par exemple dans le manuscrit tardif de Wittgenstein, L’intérieur et l’extérieur, qui met en évidence le rôle que joue cette distinction entre l’intérieur et l’extérieur dans le grouillement de notre vie.
– Enfin, Wittgenstein a repris et développé le motif biblique du cœur38, qui interroge l’engagement intégral et passionné dans une croyance religieuse donnée.
C’est la troisième direction que Wittgenstein explore dans ses Leçons sur la croyance religieuse et dans les Carnets de Skjolden dans lesquels le philosophe viennois dialogue sans relâche avec Saint Augustin et Kierkegaard sur la question de la foi39.
Ces trois directions n’épuisent pas les ressources que l’on peut trouver dans la pensée du philosophe viennois pour penser l’intériorité et l’intimité. Mais elles nous donnent plusieurs chemins à parcourir avec lui, tout en gardant à l’esprit qu’il est « important de changer toujours de posture dans l’acte de philosopher : ne pas rester trop longtemps sur une seule jambe avant d’éviter de s’ankyloser. Comme quelqu’un qui gravit longtemps une montagne parfois descend un bout de chemin, afin de se reposer et de faire jouer d’autres muscles40». Frayer de nouveaux chemins pour la pensée pour éviter toutes les menaces liées à son engourdissement, c’est précisément ce que Wittgenstein nous a enseigné. Si le philosophe n’est le citoyen d’aucune communauté de pensée41 » et que cette non-appartenance est précisément « ce qui fait de lui un philosophe », c’est cet héritage si précieux aujourd’hui qu’il importe de préserver et de poursuivre.
- Voir le catalogue de l’exposition, Vienne 1880-1938 L’Apocalypse joyeuse, sous la direction de Jean Clair, Éditions du Centre Pompidou, Paris, 1986. ↩︎
- Apóstolos Doxiádis et Christos Papadimitriou, Logicomix, Paris, la Librairie Vuibert, 2018. La biographie de Ray Monk, Wittgenstein, le devoir de génie, O. Jacob, Paris, 1993, est sans doute la biographie qui ressaisit le mieux l’entrelacement de la vie et de la pensée de Ludwig Wittgenstein, avec le livre de Ch. Chauviré, Wittgenstein, Paris, Seuil, 1989. Le film de Derek Jarman, Wittgenstein, est également à cet égard un chef d’œuvre y compris sur le plan conceptuel. ↩︎
- Logique et langage, Études sur le premier Wittgenstein, Paris, Vrin, 2002, p.13. ↩︎
- Traduits et publiés chez TER, sous le titre Remarques sur la philosophie de la psychologie, I et II, aux Éditions TER. ↩︎
- Wittgenstein et le cercle de Vienne, tr. G. Granel, Mauvezin, TER, 1991, p. 92. ↩︎
- Wittgenstein et le cercle de Vienne, op. cit., p. 93. ↩︎
- J. Bouveresse, op. cit., pp. 46-115. ↩︎
- L. Wittgenstein, Remarques mêlées, trad. G. Granel, Mauvezin, TER, 1984, p.14. ↩︎
- Par exemple, Carnets secrets, tr. J.-P. Cometti, p.34: « Je me répète en permanence, intérieurement, les mots de Tolstoï : L’homme est impuissant dans sa chair, mais libre grâce à l’esprit. Puisse l’esprit être en moi ». Trois jours plus tard, il écrit : « Nous sommes au voisinage de l’ennemi. Je suis de bonne humeur ; je me suis remis au travail. Actuellement, c’est lorsque j’épluche des patates que je peux le mieux travailler. Je me porte volontaire pour cela. Pour moi, c’est l’équivalent de ce qu’était la taille des verres pour Spinoza », op. cit., p.35. ↩︎
- L. Wittgenstein, Remarques mêlées, op. cit., p.14. ↩︎
- P. Audi, Supériorité de l’éthique, de Schopenhauer à Wittgenstein, Paris, Puf, 1999, p.26. ↩︎
- A. Schopenhauer, Le Monde comme volonté et comme représentation, Appendice : Critique de la philosophie kantienne, op. cit., p.646. ↩︎
- A. Schopenhauer, Le Monde comme volonté et comme représentation, op. cit., III, §34, p.230-231. ↩︎
- Pour bien comprendre le mode de connaissance dont il est ici question, Schopenhauer renvoie son lecteur à Éthique, II, 40, scholie 2 ; Eth V, prop. 29 ; 36 ; 38 dem et sch.) ↩︎
- A. Schopenhauer, Le Monde comme volonté et comme représentation, op. cit., III, §36, p.239. ↩︎
- L. Wittgenstein, Remarques mêlées, tr. G. Granel, Mauvezin, TER, 1984, p.15-16. ↩︎
- L. Wittgenstein, TLP 6.422. ↩︎
- B. Spinoza, Éthique, V, 42. ↩︎
- L. Wittgenstein, TLP 4.112 ↩︎
- Jacques Le Rider, Modernité viennoise et crises de l’identité, Paris, Puf, 1990. ↩︎
- Je reviens sur ce point dans l’ouvrage Wittgenstein, Paris, Les Belles Lettres, 2026. ↩︎
- Qui contenait Le cas Wagner, Le Crépuscule des idoles, Nietzsche contre Wagner, L’antéchrist et des poèmes. ↩︎
- Carnets secrets, 8.12.1914, tr. J.-P. Cometti, Les Éditions Chemin de ronde, p.78. ↩︎
- De la certitude, tr. D. Moyal-Sharrock, Paris, Gallimard, 2006, §253. ↩︎
- Je reprends ici la formule d’H. Blumenberg, Höhlenausgänge, Berlin, Suhrkamp, p. 756. ↩︎
- L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 6.43. ↩︎
- L. Wittgenstein, Remarques sur les couleurs, tr. G. Granel, Mauvezin, TER, 1983, I, §15. ↩︎
- « Les formules sceptiques sont comme des purges qui s’évacuent elles-mêmes en même temps que les matières qu’elles servent à chasser, comme le feu qui s’éteint après avoir consumé le combustible, comme l’échelle que l’on repousse du pied après l’avoir utilisée pour monter sur le mur. Cette dernière image – comme on sait – a été reprise par Wittgenstein. ↩︎
- Tractatus, op. cit., 4.112, p.134. ↩︎
- Ibid ↩︎
- TLP, 4.002, p.119-120. ↩︎
- TLP, 4.002, op. cit., p.120. ↩︎
- Remarques mêlées, 1931, tr. G. Granel, Mauvezin, TER, p.32. ↩︎
- Remarques mêlées, 1946, op. cit., p.70. ↩︎
- Voir le bel entretien en accès libre ici https://shs.cairn.info/revue-rue-descartes-2004-1-page-70?lang=fr, dans le dossier L’intériorité de la Rue Descartes édité par Corinne Enaudeau et Marie-Claude Lambotte, 2004/1 n° 43. ↩︎
- P. Pachet, Les Baromètres de l’âme, op. cit., p.178. ↩︎
- Fauconnet et Mauss, « Sociologie », Œuvres, t. III, p.150. ↩︎
- Je renvoie au remarquable article de Mathieu Eychenié, « Un mythe luthérien de l’intériorité ? La grammaire wittgensteinienne du cœur », PhilonSorbon, 14, 2020 : https://journals.openedition.org/philonsorbonne/1547 ↩︎
- J’ai approfondi ce point dans cet article paru dans la revue en ligne Théorèmes, « De la certitude religieuse, Wittgenstein sur la corde raide » : https://journals.openedition.org/theoremes/238 ↩︎
- L. Wittgenstein, Remarques mêlées, 1937, op. cit., p.42. Voir sur ce point la contribution de B. Halimi, « Crampe mentale, flexion et réflexion », Les Études philosophiques, « Wittgenstein entre les lignes », 2024/4 n° 151., ↩︎
- Fiches, tr. J. P Cometti et E. Rigal, Paris, Gallimard, 2008. ↩︎
