« C’est à travers la blessure que l’histoire et le récit s’inventent. » (à propos de David Lynch)
(Fabien Aviet)
Un an après la disparition de David Lynch, son œuvre continue de hanter l’imaginaire cinéphile par sa capacité unique à mêler violence, rêve et humanité. D’Eraserhead à Twin Peaks: The Return, le cinéaste n’a cessé d’explorer la fragilité, la douleur et le désir de ses personnages féminins, offrant un regard empathique sur les blessures infligées par la société de consommation. Plus qu’un simple narrateur de récits étranges, Lynch se révèle un voyant du sensible, capable de transformer l’horreur en épreuve initiatique et la souffrance en possibilité de renaissance. Cette traversée des ténèbres fait de son cinéma un espace de libération et de métamorphose.

D’entrée de jeu, l’œuvre cinématographique de David Lynch se place sous le signe de l’étrangeté. Comme si un mauvais génie avait patiemment détricoté le fil ordinaire des soaps américains pour y insuffler une bizarrerie trouble, jamais dénuée de finesse. Avec Mulholland Drive (2001), son film le plus emblématique, ce qui s’impose d’emblée est le trou noir central autour duquel le récit s’organise et se désagrège en épouvante hallucinée : une rêverie éclatée, sans mode d’emploi, où toute tentative de reconstitution du puzzle semble vouée à l’échec – si d’aventure le film devait avoir un sens.
Au fond, la clef manque. Ou plutôt, comme le suggère le film lui-même, la boîte est vide, ou faite pour décevoir. Elle n’est après tout qu’une boîte de Pandore, libérant des êtres de fiction comme autant de fantômes et de démons. Et les voilà à peupler les images et les esprits, avec désinvolture, comme si le spectateur, à la manière du Jack Torrance de Shining, s’était assoupi et se réveillait hébété dans un autre monde.

Mulholland Drive ne peut ainsi se déployer qu’avec la logique du rêve, mais d’un rêve inquiet, instable, où les identités se fondent les unes dans les autres, au gré des formes et des mouvements. L’art de Lynch réside dans cette fragmentation et cet enchaînement des registres, composant des tableaux dont la matière première est le sensible lui-même.
Vu peu après sa sortie, sur le câble, le film a également nourri mes premiers émois adolescents : trouble diffus où le désir, la peur et la fascination pour les images se confondaient déjà. Cette expérience intime trouve un écho dans les mots de la poétesse Sandra Moussempès qui, dans Fréquence Mulholland (MF éditions), écrit :
« Rita and Betty se réveillent là où
Elles ne se sont jamais endormies
Avec des cicatrices ou des vies perturbées. »
Si le duo saphique, quasi vampirique, évoque immanquablement Persona de Bergman (Naomi Watts devenant un double possible de Bibi Andersson), c’est surtout la manière dont Lynch traite la question de la violence traumatique qui s’impose – une violence qu’il lie intimement à la féminité et qui va jusqu’à contaminer le médium lui-même, plongeant le spectateur dans une désorientation profonde, à la mesure de la crise identitaire des protagonistes. Étonnamment, Lynch ne juge jamais ses personnages. Mieux, il prend parti pour ces femmes blessées, en apparence archétypales, broyées ou détruites par Hollywood, ce lieu fantasmatique et mortifère où le rêve américain révèle son envers le plus cruel1. L’onirisme sombre de son imaginaire s’explique en partie par son tempérament de peintre, faisant écho aux œuvres torturées de Bacon. Et comme lui, de manière plus consciente, il explore cette violence qui est l’écho du réel, cette violence sociale qui chosifie et livre les êtres en pâture au sadisme collectif – le regard, chez Sartre, en étant l’expression la plus aiguë.
Déjà dans Elephant Man (1980), Lynch adopte le point de vue de la marginalité : le corps difforme de Joseph Merrick est exposé au regard dominateur de l’Angleterre victorienne. Lynch choisit de l’humaniser, au-delà des rires moqueurs et de l’avidité pour les freak shows. Il expose le monstre non plus pour l’humilier, mais pour inverser le stigmate : Merrick y retrouve sa dignité, tandis que, par un miroir inversé, c’est la société elle-même qui apparaît monstrueuse et insensible.
Dans Blue Velvet (1986), il ne s’agit pas plus d’un regard de prédateur, comme on l’a parfois suggéré. Le film est un conte pervers et parodique, où les frontières se floutent, se retournent, s’enchevêtrent : Jeffrey (Kyle MacLachlan) découvre à la fois la violence qui l’habite en tant qu’homme et le plaisir ambigu du voyeurisme (Blue Velvet est à ce titre, avec Eyes Wide Shut, le grand film de la perversion et du fantasme), mais aussi la possibilité d’une identification à la douleur d’autrui. Le passage du seuil, matérialisé par le placard où Jeffrey s’enferme pour observer Dorothy, symbolise cette effraction dans l’inconscient et la confrontation à ses propres désirs.
C’est une autre itération de l’American Dream et de son envers : la petite bourgade tranquille, aux façades impeccables, révèle derrière les portes fermées des intérieurs violents. Le vernis bourgeois craque parfois, laissant affleurer un réel pulsionnel où la logique de non-contradiction s’effondre, et où le monde extérieur et l’inconscient se mêlent dans une inquiétante familiarité.
Lynch prend plaisir à jouer avec l’horreur et à surprendre nos attentes. L’attrait pour les ténèbres et l’aventure ne débouche toutefois pas sur la chosification de Dorothy – dont Jeffrey aurait pu jouir –, et au contraire sur une libération commune ou un transfert d’expérience. D’où l’expérience charnelle, qui est une initiation. L’horreur, en ce sens, est comme chez Bataille le passage à la limite : l’instant où le sujet se trouve destitué, perdant sa maîtrise face à l’autre qui soudain l’excède. Mais cela, c’est aussi précisément l’amour. C’est-à-dire la possibilité de ce qui ne préexistait pas, et qu’on peut appeler l’impossible.
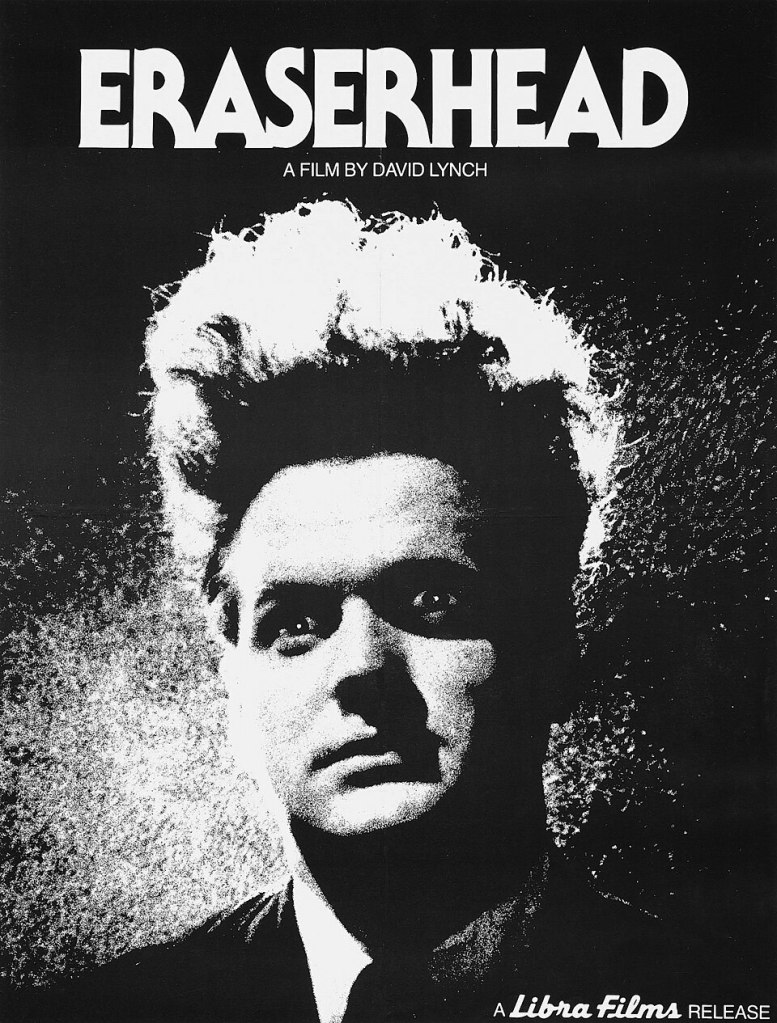
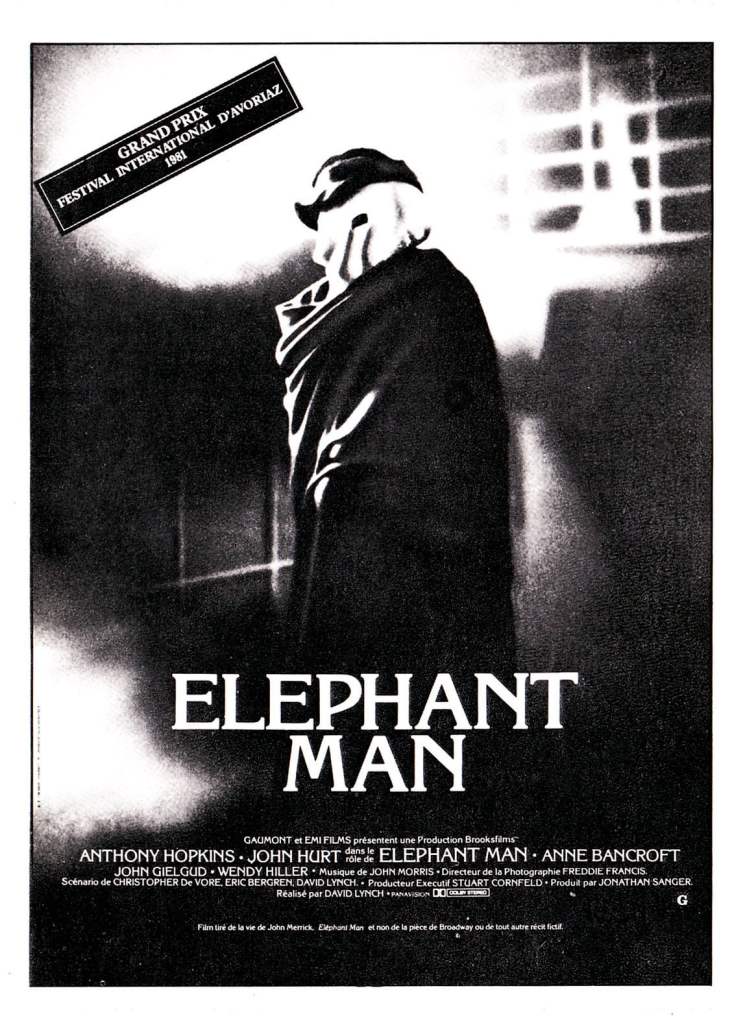
D’où l’ambiguïté des œuvres de Lynch, d’abord construites sur un jeu d’images et de suggestions, et même, à l’origine, sur des ambiances sonores, comme il le confie lui-même en interview. Lynch était un adepte de la méditation transcendantale, et ses films, dans leurs scènes les plus libres – qu’elles soient fantastiques ou comiques –, évoquent parfois l’expérimentation d’un Godard et la liberté, voire la gaieté du cinéma de Rivette. Je renvoie ici aux essais de Pacôme Thiellement, qui a bien montré les échos entre Lynch, Rivette, Shakespeare et le théâtre. Il n’est donc pas nécessaire de chercher du sens partout dans ces machines (puisque, comme le dit Freud, toute interprétation est déjà délire d’interprétation) : mieux vaut suivre le parcours par lequel le spectateur est amené à se délester d’un regard hérité pour accéder à d’autres visions. Le cinéaste se fait voyant. Dans son univers, les personnages ne sont pas définis par la place qu’ils occupent dans une hiérarchie morale, mais par les affects qui les traversent et qui les déplacent, parfois vers l’élévation, parfois vers la chute.
Sa grammaire est celle des sauts, du collage, d’une invention qui naît de rencontres inattendues, et du mariage des contraires. L’univers lynchéen est celui d’une crise, où la relation humaine peut servir de salut : l’amour, chez Lynch, consiste à relever l’autre. Wild at Heart (Sailor et Lula) en est l’exemple le plus pur. Et le plus intense. On pourrait même avancer qu’il ne peut y avoir de conversion à la fragilité, à l’empathie ou à l’étrange beauté du monde que s’il existe une connaissance intime de la douleur, prémisse indispensable à toute faculté de changement. Je pense ici à l’œuvre de Kafka, ou encore au concept de « machine » deleuzienne, qui connecte des réalités hétérogènes et produit des déplacements créateurs inattendus – des devenirs.

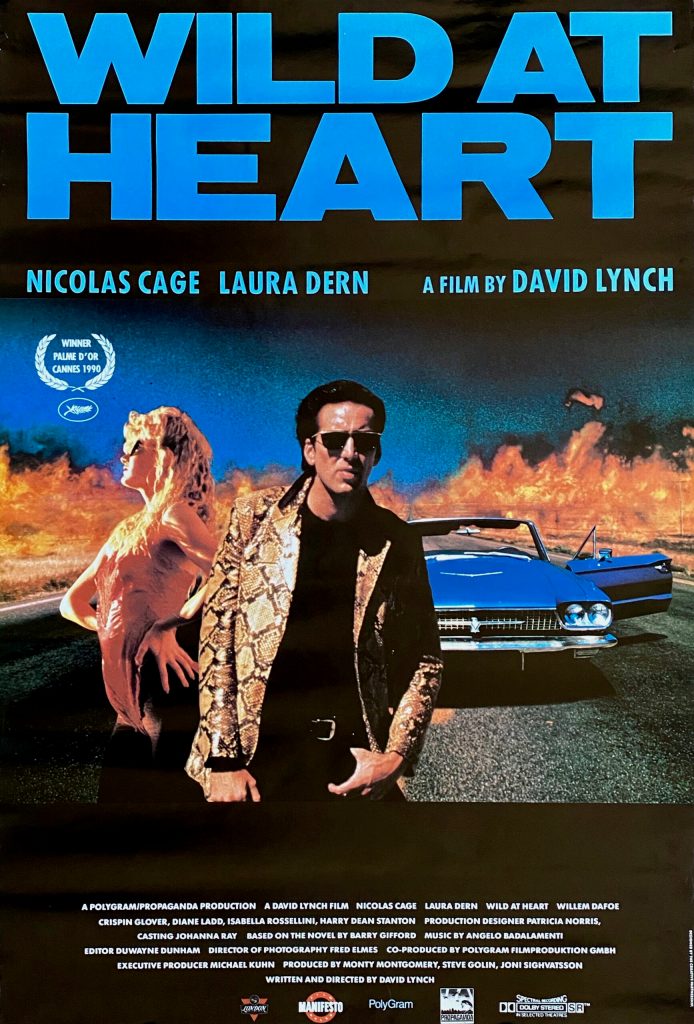
Blue Velvet n’est pas un conte de chevalerie. Jeffrey n’impose pas son emprise sur la femme, comme le voudrait le grand récit américain : il doit exorciser Frank, le violeur et séquestrateur de Dorothy. Franky est l’écho d’une frustration liée au phallus, un agent de la force brute et du ressentiment. Jeffrey, évoluant dans le monde nocturne des passions, perd sa naïveté par l’intermédiaire de deux femmes, à la fois sauveur et sauvé par elles. Il y a là encore du Kafka. Et l’apprivoisement d’une obscurité intérieure, face aux fables du monde et à l’essor de la virilité. Ce geste critique sera radicalisé dans Inland Empire.
On pourrait comparer Inland Empire (2006) au monologue de Molly Bloom (dans l’Ulysse de Joyce), mais ici sans la parole d’un sujet : c’est l’éclatement sensoriel d’une mémoire défaite par le cauchemar. Ce film, profondément perturbant mais d’une poésie phénoménale – le montage constituant la matière même du récit –, fonctionne comme un délire, un jeu de piste. Tourné principalement en numérique et de manière improvisée, le film accentue le caractère chaotique et sensoriel du récit. Il raconte, en réalité, l’odyssée intime d’une prostituée dans sa chambre d’hôtel, faisant face à un émetteur télévisuel qui semble branché sur l’inconscient. Et dont la métabolisation de la violence passe là encore par un dédoublement : comme dans un faux biopic, où réalité et fiction se confondent, la star s’ébat sous le regard scrutateur d’un réalisateur qui finit par s’effacer derrière une caméra omniprésente, quasi autonome. Chaque tableau est l’anamnèse d’une détresse à sublimer.
La triple fin d’Inland Empire est d’ailleurs d’une beauté extrême : une seule longue séquence où se succèdent une mort symbolique (un meurtre télévisuel) parmi les SDF d’Hollywood Boulevard, un retour à soi dans la chambre vide, et un réjouissant ballet de prostituées. Ce passage sonne comme un renversement, une revanche sur la société patriarcale dont l’industrie cinématographique serait l’incarnation. Mais ce qui se joue véritablement dans cette traversée des ténèbres, c’est une émancipation : libération du regard, destruction de l’image idéale de soi imposée par la société, émiettement du reflet. Le retour à soi de Nikki passe par une ouverture au monde et à ses marges. C’est tout le contraire de la jalousie possessive de Diane dans Mulholland Drive, qui se solde par le suicide.
On peut aller plus loin : ce refus d’une dialectique ouverte ou inachevée – au sens d’Adorno, ou du devenir chez Deleuze – ou encore l’impuissance à accepter ces dynamiques, meurtrit, abîme ou tue. Il en va de même pour le critique qui projette ses désirs et frustrations sur l’œuvre pour mieux s’en défendre. Pensons aussi à Fred Madison (Lost Highway), jazzman et schizophrène incarcéré pour le meurtre de son épouse, qui ne peut échapper à sa faute qu’en se réinventant dans une autre identité, jusqu’à ce que le crime, refoulé, vienne contaminer ses visions. Ou à l’agent du FBI Dale Cooper, qui, dans l’ultime saison de Twin Peaks, tente de revenir à soi mais, par hubris, force le cours des événements pour rétablir une pureté originelle définitivement perdue. Mentionnons enfin Philip Jeffries (David Bowie), autre enquêteur allé trop loin : assailli par des visions trop puissantes, il devient une figure quasi lovecraftienne, prisonnière d’une dimension alternative où le temps et l’espace n’ont plus cours…


Dans tous ces cas, et même dans la construction diégétique des séquences, dont les transitions empruntent la tuyauterie qui bricole le monde (routes de nuit, poteaux électriques, casinos…), se profile un même savoir tragique : celui d’un réel traumatique qui, pour reprendre les termes de Slavoj Žižek dans Lacrimae rerum, ne peut jamais être représenté frontalement, mais seulement revenir par ses effets de distorsion, lorsque la fiction se fissure et que son cadre symbolique cède. Le trauma affleure alors par touches, par flashs, au moment précis où l’écran semble crever. Aussi n’est-il pas si étonnant, à la fin de Twin Peaks, que la série brise le « quatrième mur » et débouche sur notre monde. Après tout, ce n’est pas l’œuvre de Lynch qui est violente, mais le monde, auquel Lynch nous ramène envers et contre tout. Et son cinéma est une tentative d’exorcisme.
Dans Twin Peaks (1990-1991), c’est en effet une ville qui devient un personnage choral, traversé par le même fil conducteur de la violence. Une violence qui s’émancipe de la ville et gagne le monde entier avec The Return, à l’heure de la globalisation financière – c’est-à-dire de l’extension du principe d’utilité, de la performance, de la marchandisation, et de la réduction de l’altérité aux attentes du consommateur.
Je revoyais récemment Fire Walk with Me (sans doute mon film préféré de Lynch), et il est incroyable de voir la manière dont il nous plonge dans les tourments de Laura Palmer, devenue un kaléidoscope de désirs, de craintes et de visages. Comment ne pas tomber amoureux, nous aussi, à l’instar de Bobby et de James ? Laura, qui avait été le cadavre ouvrant la série, comme une blessure, refait ici son apparition. Elle ressuscite. Elle est pleinement vivante. Ce que Sartre appelait une liberté. Ni vierge effarouchée, ni putain. Elle est un tout qui s’invente. Et va à sa perte.
Tour à tour sainte et démoniaque (ou plutôt démonique, c’est-à-dire hôte de forces anonymes), vulnérable et téméraire, Laura souffre et désire, puits de larmes et charbon incandescent. Elle, encore, incapable de se livrer pleinement à l’amour et cédant aux tentations de se défaire de soi dans le sexe ou la drogue, car l’inceste brise les coordonnées de l’intime. Il lui faudra donc se fuir pour exister, et comme elle le dit brûler dans sa chute. Sa tragédie naît de ce que Killer Bob, principe du mal, prend possession de l’être le plus proche, le plus familier : son père. C’est l’ordonnancement du monde qui est perverti.
Laura est ainsi un être libre dans un monde régi par des idoles, où seuls les dieux confèrent le pouvoir ou l’exercent avec voracité. Elle ne peut qu’y devenir objet de convoitise et sacrifice mythique. D’ailleurs, Laura est sans cesse convoitée : peu importe qu’elle soit morte ou vivante, et quelles que soient les relations qu’elle noue, elle est inévitablement un objet de transfert, de passions et de haines, comme si sa présence et sa disparition mettaient les personnages en branle, et chaque interprétation devient un moyen de capture. Lynch, lui, ne fait que déployer l’étendue de ses facettes, tout en préservant son énigme ; il la magnifie comme s’il s’agissait de l’hagiographie d’une sainte noire. On pourrait ainsi comparer le destin de Laura à celui de Lolita : comme Nabokov, Lynch fait d’elle un personnage plein de possibles, qui s’essaie au monde, mais dont le drame est d’être brisé dans son élan. Hollywood apparaît alors comme un mécanisme qui dévore l’innocence.
Mais à cette logique sacrificielle, Lynch n’oppose ni le puritanisme ni le renoncement. Sa critique de l’industrie audiovisuelle – qui n’est, au fond, qu’une extension du capitalisme –, ne débouche pas sur une condamnation des images elles-mêmes. Bien au contraire : elle se redouble paradoxalement d’une foi intacte dans la puissance de la fiction à façonner notre sensibilité, et donc à déjouer le conformisme comme la culture de la domination, laquelle passe le plus souvent par le plaisir pris à humilier. Il ne s’agit pas d’une promesse de salut, mais d’expérimenter d’autres rapports au monde.
Quant à The Return et à sa non-conclusion, elle tient au fait que Cooper (dont le double se livre aussi au viol) ne peut défaire la violence originelle (qui est celle de l’Amérique, de la bombe, d’Hollywood encore). S’il parvenait à sauver Laura du mal, il n’y aurait plus d’histoire. Ni de récit. Il ne peut donc pas y avoir de happy end. Comme le dit Baldwin, paraphrasant Joyce : l’histoire est un cauchemar dont on ne peut pas se réveiller. Mais cela ne signifie pas rester passif. Et c’est là le génie de Lynch : plonger dans le trou noir tout en tentant d’y garder en vie le bien, la douceur, la candeur aussi, l’attrait pour le mystère de l’autre. Le cinéma devient un lieu de traversée de la violence, de métamorphose et de désir, aussi sauvage soit-il. C’est à travers la blessure que l’histoire et le récit s’inventent. Et nous par nos doubles.
- Camille Nevers en a parlé avec brio dans Libération, cf. « Laura, Betty, Dorothy… Chez Lynch, des femmes fauchées dans la fleur de rage » https://www.liberation.fr/culture/laura-betty-dorothy-chez-lynch-des-femmes-fauchees-dans-la-fleur-de-rage-20250117_44EOYFBFVZAGPNOI6CHHZTWFJE/ ↩︎
