John Raby : Tra-la-la : une introduction à l’esthétique musicale de Deleuze & Guattari
« Que ne faut-il pas faire pour un nouveau son1? »
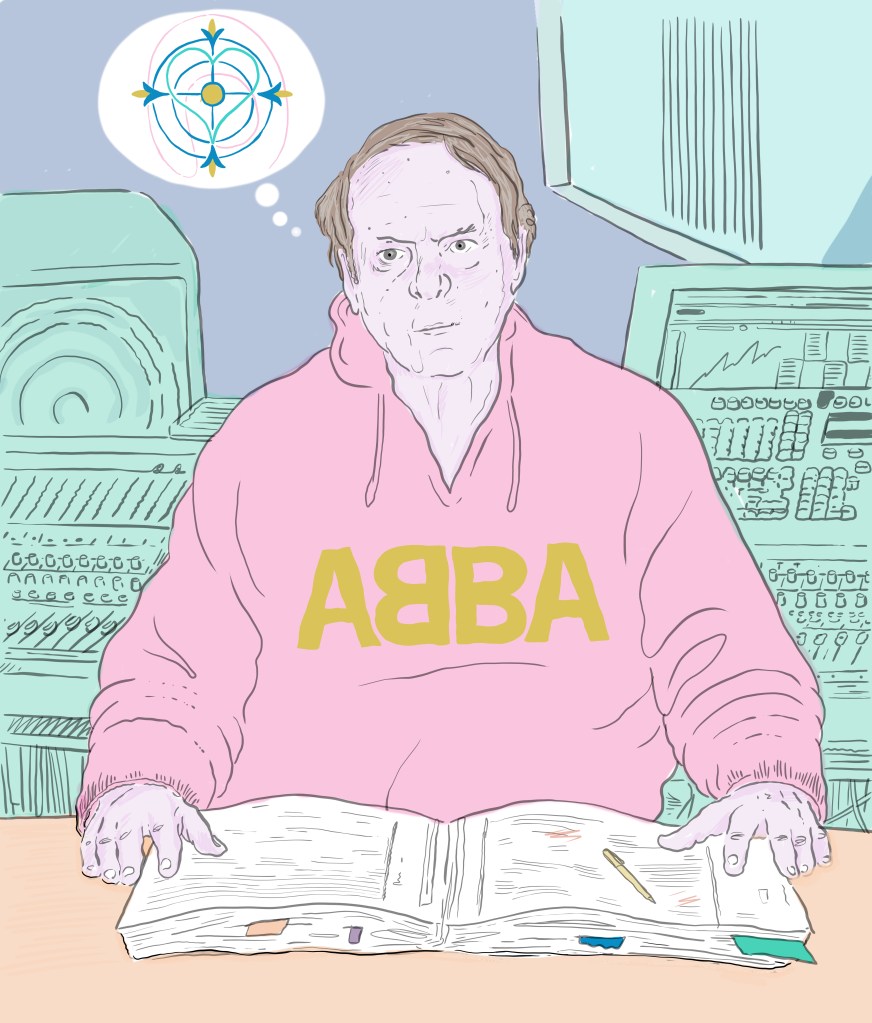
Contre une lecture réactive
Durcir l’opposition entre ponctuel et linéaire entraînerait une lecture hégémonique, bassement dualiste voire absurde. Sinon, pourquoi D&G persisteraient-ils à encenser les sonates de Mozart tout en ignorant, par exemple, les cataclysmes orchestraux de Xenakis ou les pièces les plus radicales du mouvement Fluxus ? La démarche de D&G consiste à déterminer des tendances à l’état pur, afin d’évaluer le jeu de forces en activité dans une œuvre.
À un élève qui lui reproche lors d’un cours d’encenser le temps lisse au détriment du temps strié, Deleuze rétorque donc : « (…) il va de soi que l’on ne se trouve jamais que devant des mixtes. Je ne pense pas que qui que ce soit puisse vivre dans un temps non pulsé, pour la simple raison qu’il, à la lettre, en mourrait2. »
Une œuvre actualisée ne peut être que plus ou moins lisse, plus ou moins strié. Bien plus, tout artiste a naturellement besoin du système ponctuel pour travailler : « On élabore un système ponctuel (…) mais pour le faire craquer, afin de faire passer une secousse sismique. » (MP, 362) Zéro manichéisme : le musicien confectionne même ses propres impossibilités, en fonction des petites ouvertures qu’il veut garantir.
Toutes les dualités qui ponctuent Mille Plateaux (ô combien nombreuses !) sont donc des concepts (ou plutôt des couplages de concepts) qui permettent non pas de juger ou de hiérarchiser mais d’évaluer les œuvres. Autrement dit, de discerner ce qui est de l’ordre de la représentation et des forces. Certaines lectures hégémoniques s’expliquent du fait que, dans le texte, sont effectivement célébrés le rythme contre la mesure, la ligne contre le point, le lisse contre le strié…
Mais Deleuze justifie pareilles expressions en précisant bien, encore une fois devant ses élèves, que les deux parties d’un mixte ne sont jamais de même nature : « L’une des deux parties est toujours plus ou moins donnée, l’autre est toujours plus ou moins à faire. C’est pour ça que je suis resté très bergsonien. Il disait de très belles choses là-dessus. Il disait que dans un mixte, vous n’avez jamais deux éléments, mais un élément qui joue le rôle d’impureté et celui-là vous l’avez, il vous est donné, et puis vous avez un élément pur que vous n’avez pas et qu’il faut faire3. »
Bergson disait par exemple de la durée, cette multiplicité qualitative, qu’il fallait la reconquérir par l’intuition, contre l’espace qui nous était donné d’emblée et nous trompait. Or, la qualité dans la perspective de D&G n’est pas « mauvaise » en soi puisqu’elle constitue même un accès privilégié à l’intensité (elle échappe davantage à la représentation que les données spatiales par exemple). Mais il s’agit dans Mille Plateaux de remonter au-delà, pour atteindre à l’intensif.
Suivant cette idée, le travail artistique consiste pour D&G en une « involution créatrice » (MP, 335). Remonter le fil de l’individuation pour renouer avec les forces qui, de fait, ne se sont pas encore « annulées », c’est-à-dire actualisées dans l’espace et les qualités, mais qui doivent en amont être mises en relation selon une configuration inédite pour créer de l’inouï. Si l’artiste a ce statut privilégié dans la pensée deleuzo-guattarienne, c’est que l’être est bien affaire de création.
Et ce « contre » qui rythme les binarismes de Mille Plateaux sont là aussi pour s’émouvoir de la lutte, aussi fine qu’acharnée, impliquée par une telle entreprise a priori impossible. Celle qui, dans le cas du musicien, consiste à concevoir à partir d’une intuition fondamentale, à la limite du vivable, un dialogue entre deux systèmes, afin d’y introduire une fulguration nouvelle… Celle de l’Inégal, de la différence pure. Telle est sa tâche, résumée en une superbe formule par Deleuze à l’occasion d’une conférence donnée à l’IRCAM : « (…) rendre audible des forces non-audibles par elles-mêmes4.»
La ritournelle
Ce dialogue entre les deux systèmes, D&G l’appellent d’un nom charmant : ritournelle. C’est elle qui va fulgurer entre les deux pôles, oscillant tel un zig-zag instantané. Une ritournelle est ce mouvement d’une œuvre qui magnétise sa face ponctuelle (sous cet angle, elle est qualifiée de « territoriale »), et sa face linéaire (elle devient alors « déterritorialisée »). Il s’agit en réalité d’un double-mouvement, un bégaiement selon lequel une déterritorialisation ne se fait jamais sans une reterritorialisation adjacente, à l’infini5.
Pour approcher cette délicate dynamique, rien de tel que le phénomène fondamental du rythme. On pourrait s’étonner que ce qui évoque le moins quelque chose de rythmé (d’incessants changements, ralentissements et accélérations) soit justement baptisé rythme dans certains passages de Mille Plateaux. En réalité, la ritournelle entre les deux systèmes doit être appréhendée, elle aussi, avec pondération.
Encore une fois, si l’on épouse de façon dogmatique les préceptes du temps non-pulsé, alors les Shaggs, du fait de leur amateurisme certes attachant mais vite usant, seraient les musiciennes pop les plus innovantes des sixties. On dirait même que leur façon de vriller les nerfs avec leurs chansons bancales serait une ouverture géniale sur l’intensif, etc. Autant les mettre au même niveau que le blues cubiste concocté par leurs contemporains : le Magic Band de Captain Beefheart ; ce qui reviendrait, en peinture, à assimiler les roses sanguinolentes de Cy Twombly à des gribouillis d’enfants.
Non, le rythme invoqué par D&G correspond aux infimes écarts (retard, avance, ralentissement, accélération…) que l’interprète apportera, selon ce qu’on appelle très justement son « sens du rythme ». Certes, rien de moins « funky » qu’une boîte à rythme mal utilisée (autrement dit, aussi « ponctuel » que le fuseau horaire d’Ibiza) ; mais rien de moins réductible au système ponctuel que le groove assuré par l’orchestre d’un James Brown, ou l’off-beat des Wailers sous la houlette de Bob Marley.
Car c’est bien la ritournelle, infiniment subtile et pourtant essentielle, qui confère à la musique cette puissance qui n’appartient qu’à elle. Tout musicien se comporte ainsi en funambule, en perpétuel déséquilibre entre deux pôles – système ponctuel/linéaire. D’ailleurs, pourquoi le funk de James Brown ou le reggae de Marley sont-ils d’autant plus spectaculaires que les instruments se taisent pour ne laisser que la basse, la batterie, voire quelques percussions ? Les enregistrements live ne peuvent que nous donner raison, tant la clameur du public « répond » à chacune de ces occasions.
Bien plus, comment expliquer que le dub intensifie la force du reggae en ne laissant parfois presque plus rien subsister, si ce n’est quelques notes de basse noyées dans une chambre d’écho ? Toujours s’approcher, serrer de plus près, via une ritournelle d’une grande sobriété, cette intensité qui se réduit à presque rien – ce « je-ne-sais-quoi » évoqué par Jankélévitch – et qui pourtant est à l’origine de tout.
En réalité, le groove comme l’off-beat suivent bien une mesure et pulsent le temps selon un profil singulier, mais esquivent en parallèle le présent assignable et étirent le temps à la fois vers le passé et le futur, dégageant un « temps flottant » où, pour reprendre D&G, on « occupe le temps sans le compter ». Le rythme réside dans l’écart, aussi infime soit-il – ainsi en va-t-il du style qui consiste en cette imperceptible variation continue qui fait trembler les piliers de la représentation. On retrouve cette qualité singulière, selon un tout autre profil, dans la luminescence du timbre de trompette de Miles Davis : sonner comme un soleil rougeoyant dont on ne sait jamais s’il est en train de se lever ou de s’évanouir…

Tout style nous émeut à la hauteur du doute qu’il fait consister ; autrement dit une suspension de la sensation qui se retrouve troublée. Considérons la techno minimale, tel l’album Consumed de Plastikman (Richie Hawtin), qui à partir d’un système ponctuel dès plus contraignant, dégage pourtant des intensités insoupçonnées. C’est que ce système y est tellement mis à nu, qu’il en est réduit à une basse fréquence qui frappe le bas ventre, une pulsation au timbre ciselé, un fantôme de mélodie… On pourrait presque parler de « décantation » au sens chimique, à l’instar du dub, ce qui a pour effet paradoxal de secréter une volupté intensive qui n’est pas sans rappeler la scénographie du retard, de la suspension, de l’attente infinie que Deleuze avait justement décelé dans le masochisme : cette « étrange atmosphère, comme un parfum trop lourd (…)6. »
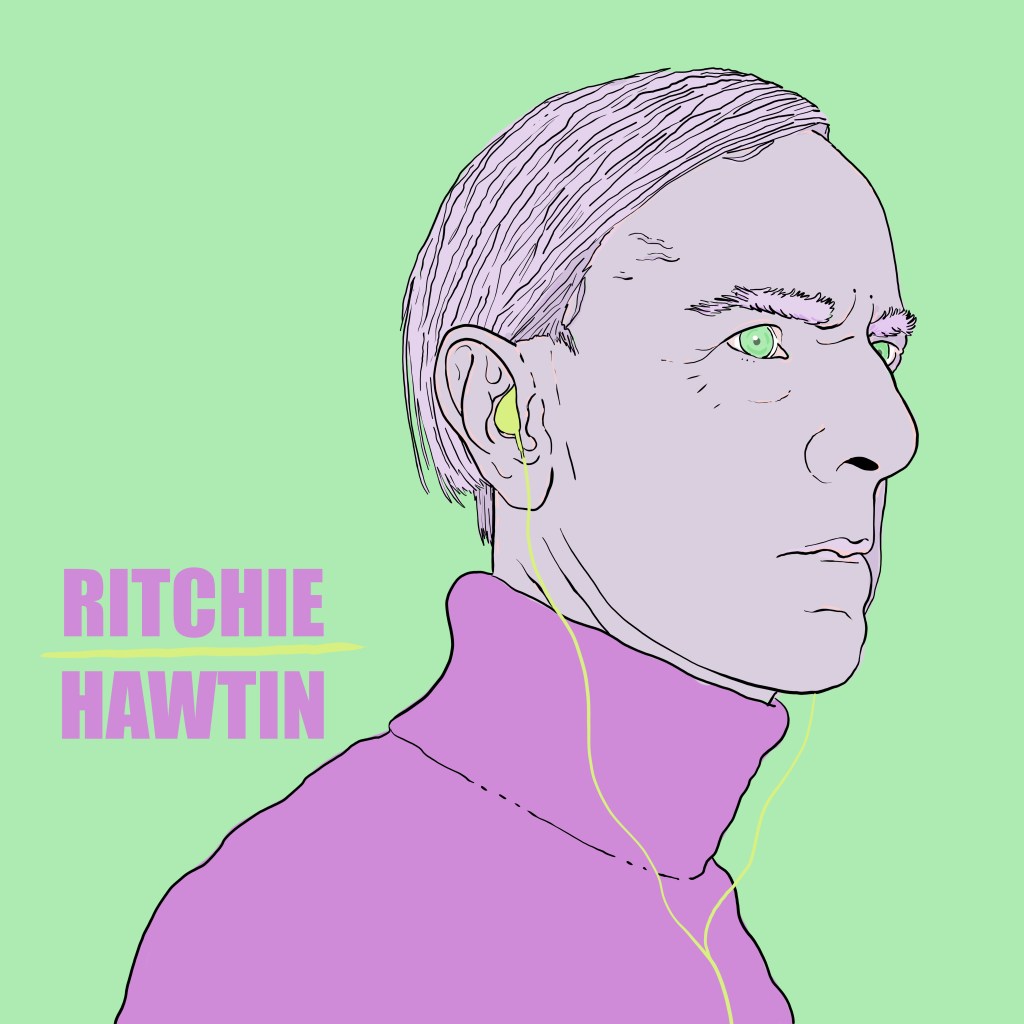
Si une certaine sobriété est essentielle pour inventer une ritournelle et glaner quelques intensités, cela n’entraîne pas pour autant une relativisation de la puissance de la musique tout comme des effets sur l’auditeur : bien au contraire…
Ligne de vie, ligne de mort
« On n’y va pas à coup de marteau, mais avec une lime très fine. » (MP, 198) Si les auteurs insistent, c’est que sombrer dans un chaos stérile guette l’artiste, et suscitera en prime ennui et irritation de l’auditeur (d’incessants changements inspirent plutôt l’indifférence qu’une épiphanie).
Ainsi, la critique acerbe de Varèse adressée à l’« Art des bruits » de l’artiste futuriste Russolo est relayée par D&G, tout comme ces derniers reprochent à John Cage certains excès dans l’indétermination. C’est le risque de faire que le plan de consistance devienne un « plan d’abolition ou de mort », une « involution dans l’indifférencié » (MP, 331), et que toute ritournelle ne s’évapore. On admirera d’autant plus des réussites tels que « L.A. Blues » des Stooges qui flirte avec le chaos sans y succomber tout à fait, mais au contraire en capturant ses vitesses à la limite du vivable.
Toutefois, le risque est tel que D&G déterminent deux lignes de fuite (c’est-à-dire deux destins du système) propres à la machine sonore : une ligne qui peut assurer toujours davantage la consistance d’heccéités et ainsi augmenter la charge intensive de l’œuvre ; et une ligne mortifère, qui tend vers l’annihilation pure : vide, silence, ou chaos. Le nihilisme de Metal Machine Music de Lou Reed, vortex de drogue dure dont l’usage reste à double tranchant, génère sur quatre faces le même cauchemar de micro-perceptions où toute consistance est impossible7.
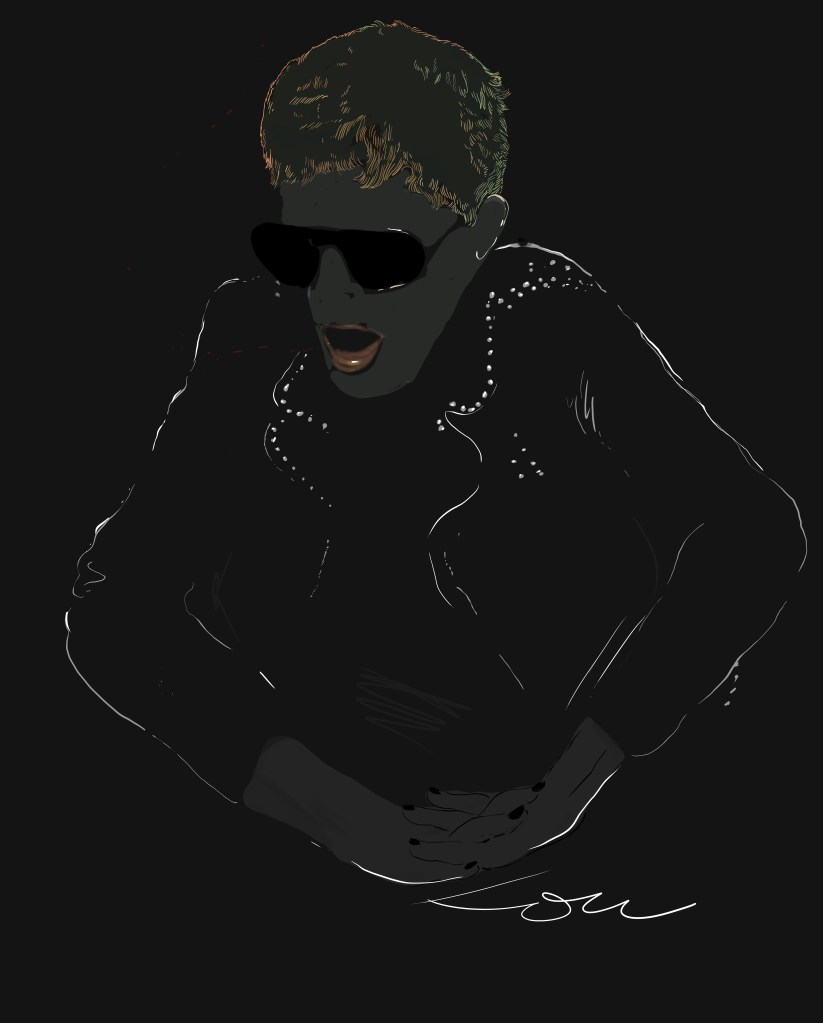
Mais ces deux tendances – la vie ou la mort – sont encore une fois contemporaines, ne cessant de s’entremêler à la manière d’une double hélice. On dirait que la musique ne commence jamais vraiment, mais se fait toujours « au milieu », selon une autre expression chère à Deleuze. Soit la chanson d’amour « This Must Be The Place (Naïve Melody) » des Talking Heads (Speaking In Tongues), enregistrée en 1983. Le chanteur David Byrne y célèbre à la fois une relation qui le ravit, mais dont il anticipe aussi la fin, tant une angoisse larvée le travaille. Le titre installe un climat doux et serein ; bien que le thème instrumental au synthétiseur dessine une ligne mélodique accidentée qui exprime une intensité délicate à décrire : un esprit joueur, léger et malicieux, cohabite avec un malaise qui chercherait à repousser le moment où ce thème musical précisément prendra fin. Si l’on devait lui attribuer un personnage musical, ce serait peut-être celui de l’enfant qui veut retarder le temps d’aller au lit.
Quant à la dernière exclamation de la chanson, certes chaleureuse, elle est bien celle d’une mise à mort opérée par l’aimée, à la demande du chanteur : « Ooh ! » Il ne s’agit pas que d’un simple paradoxe qui résiderait entre des arrangements groovy et des paroles ambiguës. Si le thème implique un jeu de forces, les larmes intensives, enveloppées dans la voix enfantine de Byrne, sont toute aussi essentielles. Elles participent de cette tension affective qui traverse la chanson, et fait d’elle une heccéité qui déborde les limites de l’anecdote, les seules franges du vécu et de ses émotions assignables : mélancolie et joie, nihilisme et gratitude se superposent, deviennent indiscernables ; exhalent par leur mélange un charme unique.
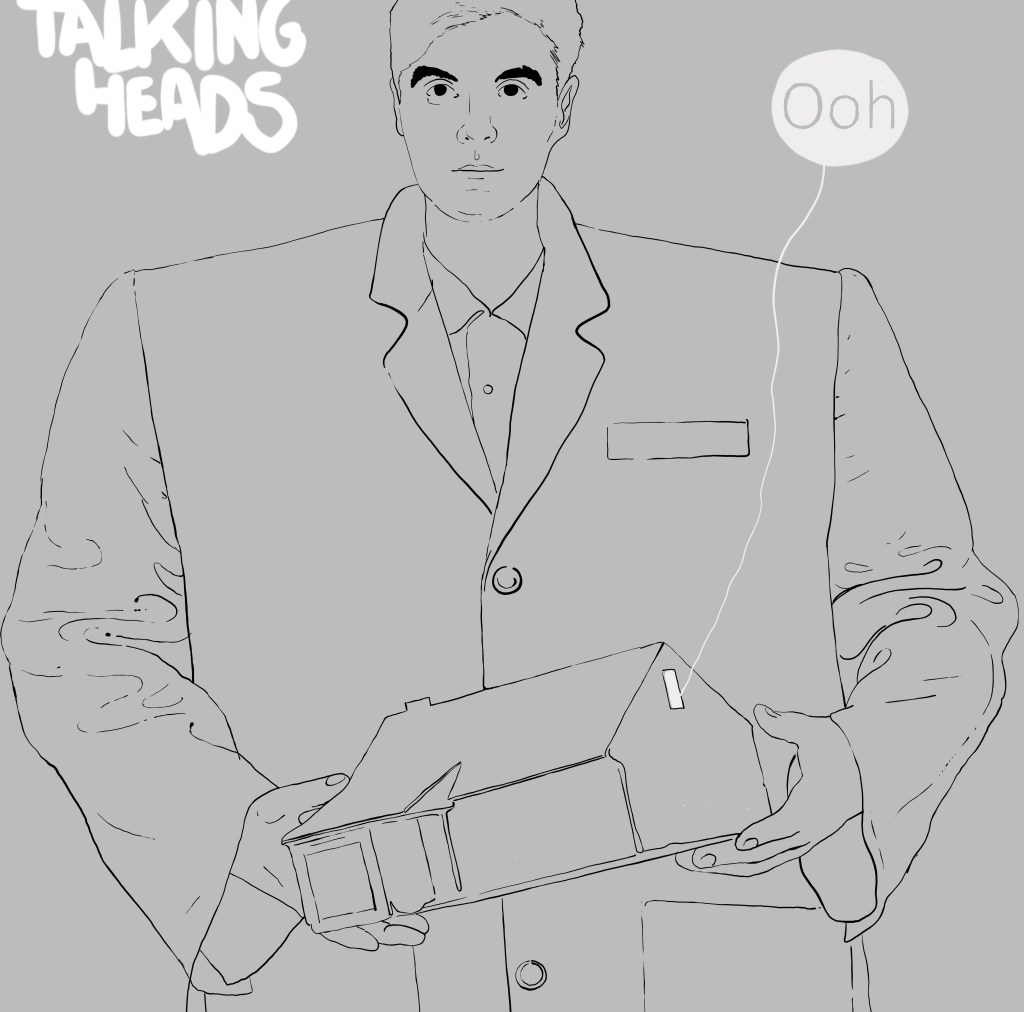
À l’inverse de ce tendre et tragique abandon, on peut invoquer le memento mori que constitue « Time Waits For No One » des Rolling Stones (It’s Only Rock’n’Roll) : titre qui prend pour squelette le temps pulsé le plus mortifère (l’imitation du tic-tac d’une horloge), mais qui lui échappe dans le même temps grâce au legato du solo final de Mick Taylor, dont l’inspiration semble intarissable – le guitariste étire le temps, le suspend pour repousser l’heure du trépas : Aiôn contre Chronos. La mélancolie du titre est d’autant plus puissante qu’elle consiste en une lutte : ce solo qui fuit toute résolution, à la manière d’une diagonale, louvoyant entre les territoires du blues et de la musique latine. Le titre a ceci d’ironique que l’improvisation s’éteint via un fade-out, tandis que l’horloge, elle, persiste.
La ritournelle, telle une onde, évolue ainsi entre la vie et la mort, l’ordre et le chaos, la consistance et la dilution. Ce n’est pas pour rien si les inflexions mornes, comme engourdies, de Leonard Cohen, Sun Kill Moon ou encore Lou Reed ont cette implacabilité que l’on prête au destin. Souvent, une femme meurt, par suicide telle Nancy de Cohen (« Seems So Long Ago, Nancy »), Caroline de Reed (« The Bed »), ou bien par accident, telle cette cousine de Sun Kill Moon : « Carissa ». La mort n’est pas une simple anecdote mais témoigne d’une dimension de la machine sonore insistent D&G. Une mort qui peut être individuelle, mais aussi un champ de bataille : « Machine Gun » d’Hendrix, mais aussi « Cortez The Killer » de Neil Young qui, par ses intensités à la fois flottantes et brutes, exprime autant la lente navigation de l’explorateur que l’inéluctabilité du massacre des Aztèques.
Un art de l’affirmation
La ligne d’abolition peut prendre le dessus et déclencher un chaos rageur tel Metal Machine Music, ou bien tout écraser sous une chape de plomb. Une chanson comme « I See A Darkness » de Bonnie « Prince » Billy s’approche de cette manière au plus près de la mort : la voix éteinte et tremblante de Wild Oldham accompagnée d’instruments en déperdition. « Is a hope that somehow you / Would save me from this darkness ? » Comment peut-on encore conférer une quelconque consistance à des intensités a priori aussi épuisées, à deux doigts du néant ?
D&G précisent que la musique n’est jamais tragique, mais toujours joie. Non pas de cette joie ordinaire, parfois superficielle lorsqu’elle se rapporte au seul divertissement, mais qu’ils assimilent à l’amor fati nietzschéen. C’est-à-dire une adhésion inconditionnelle à l’existence, y compris dans ce qu’elle a de pire. L’ouvrage Dialogues condense cette haute pensée en une formule : « Un amour de la vie qui peut dire oui à la mort8. »
La ligne d’abolition dans une chanson n’a rien d’une pulsion de mort freudienne qui chercherait le silence comme repos définitif (intensité = 0), mais au contraire témoigne d’une affirmation de la dissolution, en continuant justement de chanter, de vibrer, pour dire « oui » à ce qui érode et détruit. Si la musique reste joie, c’est que le musicien, par sa pratique, atteint au « devenir-imperceptible » ; autrement dit, il ne tend plus vers la mort en tant qu’individu, mais s’évanouit dans le jeu de forces impliqué dans sa chanson.
Ce n’est que par-là que l’on atteint à la plus haute singularité (le contraire de l’individualisme). Wild Oldham n’est plus seulement un homme, mais une configuration intensive qui transcende son seul vécu. On peut affirmer des larmes d’un musicien qu’elles touchent en effet à l’intensité lorsqu’on peut dire de lui qu’il pleure comme on dit : « il pleut ». Ou, pour reprendre cette forte assertion de Bergson : « Quand la musique pleure, c’est l’humanité, c’est la nature entière qui pleure avec elle9. »

Parfois même, la voix est forcée de s’absenter tant la mort est présente, telle celle de Nick Drake qui, dans le bref instrumental « Horn » (Pink Moon), s’exprime par une mélodie interprétée à la guitare, d’une sobriété qui ne fait qu’entourer le silence. Le chanteur se tait, mais l’absence même de sa voix constitue une intensité, les cordes témoignant de cette fine crête qui s’extirpe encore d’un terrible plan d’abolition qui finira par engloutir le chanteur.
Alors oui, toutes ces titres ravivent notre nostalgie individuelle (nos malheurs, nos regrets…), mais pour nous élever dans le même temps à un plan depuis lequel il n’est plus possible de dire seulement « je pleure », et ce au nom d’un « on pleure » plus noble. Ce que D&G appellent un affect, pour le différencier des affections ordinaires. « Machine Gun » d’Hendrix restitue l’horreur des massacres sur un temps-pulsé de mitraillette, mais pour s’élever à un « on meurt », dressant la carte intensive de toute guerre. Telle est la transmutation opérée lorsqu’une chanson remonte le fil de l’individuation afin d’y retrouver les forces vives qui président à toute chose.
Voilà peut-être pourquoi une chanson triste nous réconforte tant, tel le blues qui n’est jamais mortifère. Pourquoi un titre comme « I See A Darkness », ou la mélodie décharnée de « Horn », ont peut-être dû sauver des vies alors qu’ils sont la trace sonique de trous noirs. Pourquoi « Machine Gun » sera toujours plus efficient que l’hymne « Imagine » de Lennon qui est devenu un cliché d’une idée aussi creuse que la paix en général (l’ancien Beatles atteint davantage à l’universel quand il se fait jaloux : « I’m just a jealous guy… »). Comme le disait Nietzsche, un jour on s’apercevra qu’il n’y avait pas d’art, mais seulement de la médecine.
Le sort de la ritournelle
Dans ce combat pour dévoiler la part vivante, intensive, recouverte par la morne croûte de la représentation, rien n’est jamais gagné. Si l’hymne pacifiste de Lennon est devenu celui de la moraline, un riff de basse, pourtant éminemment musical, se voit par exemple régulièrement « reterritorialisé » en un cri de ralliement pour meutes souvent éméchées, voire en hymne pour meetings politiques : « Seven Nation Army » des White Stripes.
La ritournelle, lorsqu’elle devient ainsi territorialisée, accentue toujours les attitudes grégaires, les émotions cataloguées, le slow qui implique d’embrasser, la récupération du romantisme orchestral par le cinéma hollywoodien, l’effet « jingle » utilisé par la publicité qui pille les œuvres pour honorer un paquet de chips, les vidéos TikTok qui extraient dix secondes d’un refrain pour justifier une chorégraphie à imiter, les yeux rivés sur son téléphone.
À ce stade, D&G le disent bien, la ritournelle est ce qui empêche même la musique d’advenir. Or, celle-ci comme on sait, demeure souvent instrumentalisée tant sa force est grande, car des intensités passent malgré tout, même « aliénées », c’est-à-dire rabattue sur la représentation. Les publicitaires comme les politiciens le savent parfaitement. Tel est le « fascisme potentiel » de la musique (MP, 321). Wagner détourné par Hitler comme par les hélicoptères d’Apocalypse Now. Une scène culte du film de Coppola qui inspirera même l’armée américaine lors du conflit en Irak qui s’est emparé du dispositif, pourtant hautement critique au départ. Dans certains cas de figure, la reterritorialisation ne semble pas connaître de limite, selon cet infini propre à la bêtise.
Mais tout peut aussi être remporté, et souvent de manière spectaculaire. Les deux philosophes s’étonnaient même de la puissance de déterritorialisation propre au champ musical, comparé à celui du peintre qui doit laborieusement se débarrasser des clichés qui peuplent la toile avant même le premier coup de pinceau : « C’est curieux comme la musique n’élimine pas la ritournelle médiocre ou mauvaise, ou le mauvais usage de la ritournelle, mais l’entraîne au contraire, ou s’en sert comme d’un tremplin. » (MP, 431)
On a même le sentiment que plus le système ponctuel se montrera « coriace », plus sa déterritorialisation sera spectaculaire. Ainsi le sourire sardonique de Zappa qui traverse, telle une immense diagonale, tout matériau sonore quel qu’il soit, et accumule les virtuoses bouffonneries comme pour tendre un miroir aux gouvernements, aux fanatiques, aux hypocrites – bref, à ceux et celles qui ne savent pas rire d’eux-mêmes. Car si nous avons évoqué des œuvres tragiques, l’humour aussi est une intensité d’après D&G : non pas une contradiction, mais un écart affectif qui bouleverse les attentes.
On pensera aussi à John Coltrane, dans cette lutte contre la territorialisation, lorsqu’il s’empare de la petite chansonnette de La Mélodie du Bonheur, « My Favorite Things », pour en faire le vecteur d’improvisations déchirantes (Live In Japan) ; ou bien Ennio Morricone qui reprend une berceuse enfantine italienne et lui confère des allures toute aussi cosmiques par des arrangements dont lui seul avait le secret : « Matto, caldo, soldi, morto… girotondo. » (Vergogna Schifosi).

Dans un tout un autre registre, le style de musique electro Vapowave apparu au début des années 2010, et qui consiste à ralentir à l’extrême du easy listening des années quatre-vingt (publicités, musique d’ascenseur…) parvient à transmuter ce vil matériau, et à faire dérailler notre mémoire. En effet, la musique sonne d’emblée comme oubliée, bien que ce soit la première fois que nous l’entendions. Déterritorialiser de la muzak de telle manière qu’elle soit vectrice d’une nostalgie sans objet, d’une amnésie métaphysique : quel exploit d’hantologie !
Trahir le système ponctuel, y faire passer des intensités… Les exemples sont non seulement légions, mais une telle pratique n’obéit à aucun dogme. Cela ne se cantonne pas à la diagonale de l’atonalisme par opposition aux points du système tonal, voire modal. D&G qualifient même de « pseudo-coupure » cette opposition. Il n’y a pas de « recettes », ni même d’aboutissement, tel celui promu par le sérialisme intégral suivi entre autres par Boulez. Mais d’infinies manières de générer une ritournelle, c’est-à-dire passer entre les mailles du système ponctuel tout en plaquant un cadastre approprié d’après le système linéaire. Ou pour résumer : faire consister une intensité.
Et l’auditeur dans tout ça ?
La musique ne pourrait-elle pas faire l’objet d’une double écoute : plus ou moins ponctuelle, plus ou moins linéaire ? Surtout fuir le souvenir nous prévient Mille Plateaux – on croit beaucoup donner à la musique avec la mémoire, mais ce serait commettre l’erreur de Swann qui, dans la Recherche proustienne, plaque sur la petite mélodie de Vinteuil le visage d’une amante cruelle. Tel est le piège de la représentation : la musique renvoie à autre chose qu’elle-même. Le Narrateur du roman, lui, ne s’y trompe pas, et perçoit plutôt un être enveloppé dans cette même musique : « La seule Inconnue qu’il m’ait jamais été donné de rencontrer10. » La musique nous fait signe, et l’on découvre alors ses propres paysages intensifs, ses personnages soniques – heccéités.
Si « Suzanne » de Leonard Cohen ou « Billy » de PJ Harvey nous renvoient forcément à nos propres amours ; c’est aussi, sur un autre plan, une rencontre d’un ordre plus élevé. On s’émeut moins de notre sort ou de nos attentes qui résonnent avec une chanson, que des vibrations de cette dernière, de ses vitesses et de ses lenteurs, de cette ritournelle qui nous fait perdre, enfin, la notion du « Moi-je » comme du temps présent.
Aussi, le long d’une ligne temporelle étirée entre passé et futur, et qui pourtant ne dure souvent que quelques minutes, nous voilà délivrés de ce que l’on croyait être seulement nous-mêmes, fixé par le « sens commun » et notre prétendu « bon sens » comme une photo épinglée au mur. « Je sens que je deviens autre » – voilà ce qui pourrait faire office de cogito deleuzo-guattarien11.
En définitive, D&G veulent dire quelque chose qui est à la fois profond et simple : sur le plan des forces, les compositions sont objectivement des êtres vivants, tout comme une personne, une rivière ou une journée ensoleillée. On le découvre si le point de vue utilitariste de la représentation, avec ses synthèses, ses catégories, ses idées, saute ne serait-ce qu’un instant par le biais d’un choc sensible ; alors c’est un autre angle sur le monde qui se fait jour, au profit d’une vision où tout élément devient évènementiel et, de fait, communie sur un même plan de consistance : « Le climat, le vent, la saison, l’heure ne sont pas d’une autre nature que les choses, les bêtes ou les personnes qui les peuplent, les suivent, y dorment ou s’y réveillent. » (MP, 321). Sur le plan intensif, tout partage la même dignité d’existence.
Comme toute forme d’art qui implique de connecter de nouvelles intensités et de les rendre appréciables, la musique crée littéralement des mondes (et les êtres cinétiques qui le peuplent). Son exercice est de nature ontogénétique. Le parrain de l’ambient, Brian Eno crée avec « The Lost Day » (On Land) un univers à la fois pastoral et sinistre qui n’a rien de simplement imaginaire, mais qui est l’émanation d’une intensité réelle sans être actuelle (c’est-à-dire réductible à la représentation) : un « imminent tremblement de terre » pour reprendre les mots du compositeur.
Du fait de son immatérialité, elle qui n’est que vibrations, la musique est même dans un contact privilégié avec cette part nouménale, hautement énergétique, du réel. Elle constitue une puissance si extraordinaire d’affirmation que sa ritournelle s’élève, comme nous l’avons vu, jusqu’aux cimes de l’amor fati nietzschéen. N’être que pure adhésion. Si bien transmuter les matériaux les plus vils, les pires situations, que l’on est en mesure d’en extraire du sublime, et d’en désirer l’éternel retour.

Musique et métaphysique : éternel retour
Et si l’ontologie deleuzo-guattarienne n’était, au fond, qu’une nouvelle théorie musicale ? À un certain niveau, musique et ontologie finissent en effet par ne faire qu’une sous la forme de l’éternel retour « (…) comme petite rengaine, comme ritournelle qui capture les forces muettes et impensable du Cosmos. » (MP, 423) L’éternel retour est, dans cet univers intensif, la spirale qui permet de dresser le plan de consistance, puisqu’il constitue la Différence, l’Inégal, l’Incommensurable qui passe à travers toutes les intensités, et les fait résonner en un clapotement moléculaire. Formule magique de la multiplicité : « L’Un se dit en un seul et même sens de tout le multiple, l’Etre se dit en un seul et même sens de tout ce qui diffère. » (MP, 311)
Dans Différence et Répétition, Deleuze présentait déjà sous un angle musical ce retour nietzschéen qui reprend en chœur un seul et même « refrain » en passant par chaque intensité : « Chacun choisit sa hauteur ou son ton, peut-être ses paroles, mais l’air est bien le même, et sous toutes les paroles, un même tra-la-la, sur tous les tons possibles et à toutes les hauteurs possibles12. » L’éternel retour n’est pas l’effroyable récurrence du même mais revenir de la différence. Non pas un cercle, mais une spirale perpétuellement décentrée. L’enfant nietzschéen ne joue pas seulement aux dés pour affirmer l’innocence du devenir ; il se chantonne à lui-même un refrain dont les paroles toujours varient.
On repense ainsi au personnage conceptuel du petit enfant qui inaugure le chapitre « De la Ritournelle » en reprenant un « tra-la-la » pour trahir sa peur du noir. Un chantonnement implicitement présenté comme la naissance même de la musique, et qui se retrouve relayé à l’infini : le « Fort-Da » des enfants, mais aussi les « Ha ha ha » de Leadbelly, le « Ba-da-ba-da » d’Ella Fitzgerald, le « Ya-ya-ya » d’Yma Sumac, les « Na na na na na na » des Cannibal & the Headhunters, le « Ba-ba-ba » des Beach Boys, « Ob-La-Di, Ob-La-Da » des Beatles, « Fa fa fa fa fa fa » des Talking Heads, « Sha-ka-ra » de Fela Kuti, « A-rennda-rennda-rahhh » de Zappa, « De Do Do Do, De Da Da Da » de Police, « Babooshka ya-ya » de Kate Bush, « Hey Ya » d’Outkast, « Aaja aaja » de Shankar Jaikishan, « Waka waka » de Shakira… Nicole Croisille philosophe lorsqu’elle chante en chœur avec Pierre Barouh ce duo un brin sirupeux qu’est « Un Homme et un femme » : « Comme nos voix badabada dabadabada / Chantent tout bas badabada dabadabada ».
Après tout, le moment le plus lunaire de l’Abécédaire n’est-il pas celui où Gilles Deleuze vante non pas seulement le prestigieux Chant de la Terre de Gustav Mahler, mais aussi le bien nommé « Alexandrie Alexandra » de Claude François ? « Alexandrie où tout commence et tout finit… » Il y aurait peut-être moins de mauvaises musiques qu’une mauvaise façon de l’écouter. Non pas juger ni se souvenir mais évaluer, à la manière d’un John Cage qui, depuis son appartement new-yorkais, guettait le trafic routier dans l’espoir de capturer toute intensité susceptible de fulgurer.
Sobriété dans l’acte compositionnel, mais aussi sobriété quand il est question d’évaluer les musiques qui en résultent. C’est la diva islandaise Björk, elle qui a l’aplomb de tout dire avec cœur, qui l’affirme en 1997 pour le magazine Magic : Abba et Stockhausen ont cherché la même chose – ils n’avaient simplement pas suivi les mêmes ritournelles.
- Gilles Deleuze et Felix Guattari, Mille Plateaux, Paris, Minuit, 1980, p 47. ↩︎
- Gilles Deleuze, Sur la musique II, Cours Vincennes 03/05/1977. Humour du professeur qui répond à une objection finalement abstraite par un phénomène on ne peut plus concret : la pulsation du cœur. ↩︎
- Ibidem ↩︎
- Gilles Deleuze, Deux Régimes de fous. Textes et entretiens 1975 – 1995, Paris, Minuit, 2003, p. 146. ↩︎
- « Ritournelle » est à la fois un terme musical synonyme de reprise (da capo), mais aussi un mot-valise qui évoque l’éternel retour nietzschéen. Nous reviendrons sur ce point en fin de texte. En tous les cas, D&G ont le chic pour extraire un terme ordinaire afin de l’ouvrir à des dimensions d’ordres divers. ↩︎
- Gilles Deleuze, Présentation de Sacher-Masoch : le froid et le cruel, Paris, Minuit, 1967, p. 32. ↩︎
- D&G mettent en garde contre l’usage de drogues qui, si elle force l’accès à l’imperceptible, est vecteur de destruction et d’un mode de vie encore plus fermé que le seul régime représentatif (les rituels du camé). « Moins défoncé qu’enfoncé. » (MP, 123). ↩︎
- Gilles Deleuze et Claire Parnet, Dialogues, op. cit., p. 80. Quant à l’amor fati, nous conseillons vivement la lecture de l’article de Valentin Husson sur ce site, bien que sa brillante interprétation soit à l’opposé de celle, anti-freudienne, de D&G. ↩︎
- Henri Bergson, Les Deux sources de la morale et de la religion, Paris, Presses Universitaire de France, 2013, p. 36. ↩︎
- Marcel Proust, À la recherche du temps perdu. Tome 3, Paris, Éditions La Pléiade, 1971, p. 260. ↩︎
- On pourrait aborder comment la musique nous fait entrer dans des devenirs, c’est-à-dire nous transforme, mais cela outrepasserait largement les limites de cet essai. Précisons quand même que D&G ne promulguent pas une fuite « dans l’art », mais l’art doit servir au contraire à expérimenter dans notre vie. « Car vous ne donnez rien aux heccéités sans vous apercevoir que vous en êtes, et que vous n’êtes rien d’autre. » (MP, 320) Dans cette démarche, Suzanne, Billy voire même Cortez l’assassin peuvent nous y aider. ↩︎
- Gilles Deleuze, Différence et Répétition, op. cit., p. 113-114. ↩︎
