John Raby : Tra-la-la : une introduction à l’esthétique musicale de Deleuze & Guattari
« Que ne faut-il pas faire pour un nouveau son1? »
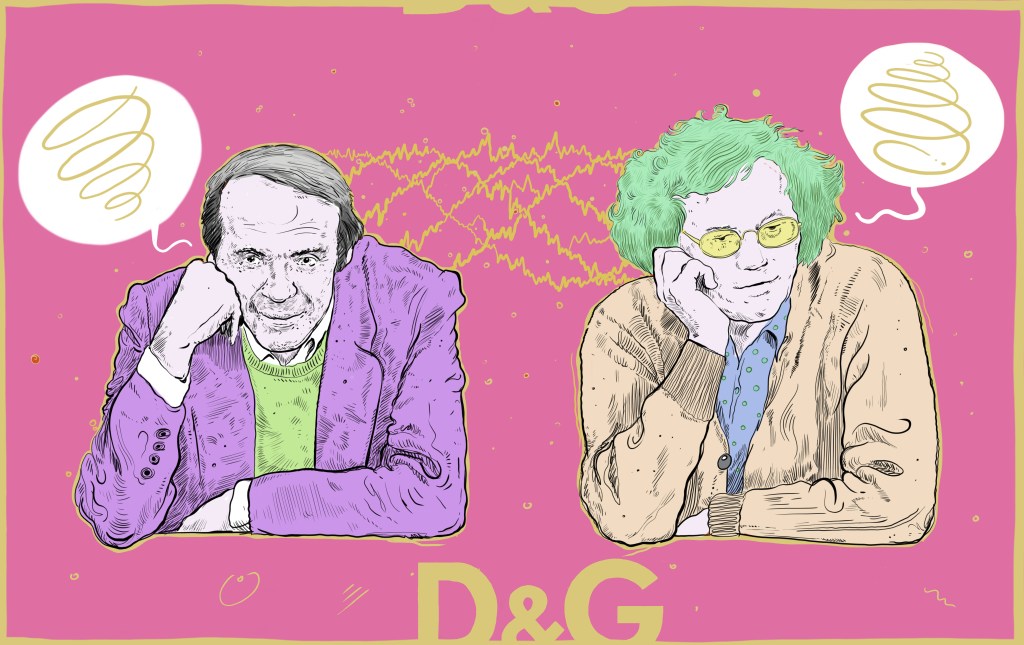
Dans son ouvrage La Musique et l’Ineffable, Vladimir Jankélévitch pointe le dilemme essentiel auquel se retrouverait confronté un philosophe lorsqu’il réfléchit sur la musique : « (…) il n’y a rien à penser ou, ce qui revient au même, il y a à penser en quelque sorte, à l’infini (…). »
Quel est ce « rien », ou ce « je-ne-sais-quoi » qui stupéfie tant la pensée que les philosophes ont si souvent évité la musique en tant que sujet ?
Il s’avère que Deleuze et Guattari se sont attelés à ce problème avec une opiniâtreté peu commune dans leur encyclopédie métaphysique Mille Plateaux, publié en 1980. En tentant de ne pas succomber au charme de leur écriture (ce qui revient à ne produire qu’une stérile reprise de leurs néologismes), nous proposons une analyse de l’esthétique musicale telle qu’elle est exposée dans cet ouvrage, afin d’approcher ce « rien » qui, comme l’a découvert Jankélévitch, constitue un infini propre au musical.
Aborder pareil problème selon les contraintes formelles d’un essai exige l’économie de subtilités propres à cette pensée du multiple ; elle qui s’amuse à nous séduire dans l’exacte mesure où elle nous égare. Ce texte pose les jalons, et prétend ouvrir des pistes de réflexion. Nous avons pris soin de ne pas citer uniquement des compositeurs déjà présents dans Mille Plateaux, ni des exemples limités au champ référentiel dit « classique » ou expérimental, comme c’est le cas de nombreuses exégèses deleuziennes. Et ce, afin d’optimiser l’appréhension d’une philosophie qui s’est revendiquée comme étant « pop ».
Musique et métaphysique : l’intensité
Si Deleuze & Guattari ont ce talent indéniable de rythmer leur philosophie, celle-ci, contrairement à ce que pensent certains de leurs détracteurs, s’avère être très structurée (certes à la manière toute spéciale d’un rhizome) ; mais surtout, n’a rien de métaphorique tel qu’on l’entend traditionnellement2. Ce qui est traditionnel en revanche, c’est que leur esthétique découle de leur métaphysique. Aussi ne pouvons-nous pas évoquer la question musicale en faisant l’impasse sur leur ontologie.
En guise de fil d’Arianne pour aborder cette dernière, nous prendrons comme base herméneutique le fait que D&G restent profondément bergsoniens dans leur méthode. Henri Bergson demeure en effet célèbre pour avoir distingué divers couplages de multiplicités : la durée de l’espace, la matière de la mémoire, l’intuition de l’intelligence, la morale de la religion…
Mille Plateaux consiste pareillement en des distinctions de nature, raison pour laquelle on peut décrire son contenu comme un déploiement de binarismes imbriqués : arbre/rhizome, territoire/déterritorialisation, agencement étatique/machine de guerre… Sous leurs dehors imaginés et séduisants, ce sont des constructions conceptuelles certes ouvertes, mais aussi très texturées – disons-le : virtuoses3.
Leur métaphysique étant subtile, assumons dans un premier temps d’être « grossier ». Disons qu’il s’agit essentiellement de distinguer deux domaines. Premièrement, celui qui appartient à la représentation, qui correspond à la différence rapportée au même : tel est le règne des généralités, des formes, des sujets… Comme Deleuze l’écrivait déjà dans son livre-souche, Différence et Répétition : « Le préfixe RE- dans le mot représentation signifie cette forme conceptuelle de l’identique qui se subordonne les différences4. »
Deuxièmement, le domaine qui est de l’ordre des forces, autrement nommées intensités. Un univers bien plus étrange puisqu’il consiste en des différences rapportées à elles-mêmes – un champ métastable, fait de purs potentiels diraient les physiciens. Ces forces, différences ou intensités, sont dans la pensée deleuzo-guattarienne l’équivalent du noumène kantien : la chose-en-soi.
Qu’entend-t-on exactement par intensité ? Une grandeur intensive a la particularité de ne pas être « composable » comme les grandeurs extensives. Si l’on connaît le résultat quand on ajoute cinq centimètres à son équivalent, mélanger deux cafés tièdes ne donnera jamais un café brûlant. Kant faisait déjà de l’intensité une condition interne de la perception (une lumière plus ou moins vive par exemple). Bergson lui donnera la primauté avec la durée comme multiplicité qualitative. Notre perception est faite de divers états qualitatifs, qui se compénètrent en un changement perpétuel, et qui ne peuvent être divisés ou répartis selon une appréhension spatiale. Le philosophe donne l’exemple d’une mélodie « où chaque note se fond avec la précédente et se prépare à la suivante5. »
Mais une distinction est ici primordiale : Deleuze & Guattari (D&G) évoquent une intensité qui prévaut aux qualités bergsoniennes, et donc s’extirpent et remontent au-delà des seuls états vécus. Bien plus, l’intensité s’annulerait dans les qualités, tout comme dans l’espace, et résideraient à l’état sauvage dans un spatium intensif.
Prenons quelques exemples concrets : lorsque je teste la température d’une eau qui se trouve être si chaude que, l’espace d’un instant, j’hésite à savoir si elle est « glacée » ou « bouillante ». C’est là que ma sensation, par cette anomalie, a accès à la différenciation, une intensité avant sa « résolution » dans une qualité (une certaine température donnée). D’autres phénomènes seraient une douleur soudaine, un vertige, voire l’orgasme, cette « vague irrésolue » pour reprendre une formule poétique de Gainsbourg. Autant de différenciations qui ne se laissent pas fixer en une qualité unique. Aussi une intensité ne peut-être que l’ordre d’une certaine fulgurance qui implique une secousse intime de la sensibilité.
Finalement, pareilles intensités correspondent à des dynamismes spatio-temporels qui ne sont pas censés être perceptibles par l’être humain ; qui dépassent en droit nos facultés, puisqu’ils président à la formation de ce que l’on appelle communément le « réel » (y compris la formation de notre corps, de notre sensibilité, de nos pensées…). À de rares occasions, sous le coup d’un choc (accident, deuil, coup de foudre…) nous assistons à un phénomène en train de naître, d’apparaître, et ce avant de se fixer sous une forme ou une qualité.
Dans la lignée de Nietzsche, D&G reprochent à la Critique kantienne, qui a tenté de déterminer ce que peut connaître un être humain, d’être restée conformiste en déterminant le « bon » usage des facultés selon des valeurs préétablies (morale, religion…). Ils reconnaissent cependant qu’une brèche essentielle s’est ouverte avec le sublime, qui consiste en un « accord-discordant » entre l’imagination et la raison. Seulement, ils généralisent à leurs tours ces raccords impromptus à l’ensemble des facultés dans ce qu’ils appellent un « empirisme transcendantal ». Mille Plateaux s’inscrit pleinement dans ce projet : découvrir ce que peut réellement un être humain, et qui outrepasse ce que la doxa peut anticiper.
Reprenons le fil métaphysique. L’être (si l’on peut encore employer ce mot) serait ainsi pure différence, et tout ce qui peut être « égalisé », y compris même une qualité qui a tout de même la propriété de se différencier de soi-même, n’est qu’illusion de surface. Il n’existe aucune substance en ce monde, seulement des processus infinis de différenciations… Et la philosophie, comme les arts, auraient pour but de fendre les choses pour y déceler, ne serait-ce que le temps d’un éclair, cette fulgurance nouménale.
Les forces invoquées par D&G sont multiples par nature : il n’existe que des jeux de forces, des polarisations entre intensités selon une régression à l’infini. Deleuze écrivait déjà en 1968 : « L’expression « différence d’intensité » est une tautologie (…). Toute intensité est différentielle, différence en elle-même. Toute intensité est E-E’, où E renvoie lui-même à e-e’, et e à ε à ε’, etc. (…)6. »
Ah, ces éclaireurs !
La représentation a ainsi le statut du « voile de Maya » qui nous illusionne, mais qui peut être soulevé. Toutefois, percevoir au-delà de ce voile doit se faire avec parcimonie tant la représentation nous protège aussi de ce qui serait, sans elle, un sublime dévastateur. C’est en cela que les artistes font figure d’explorateurs. Deleuze, pour son propre compte, parle de « voyant » ou d’« entendant », qui reviennent les « yeux rougis », les « tympans percés », après avoir soulevé un morceau du pan.
Sur un plan pictural, pensons au cri des cieux peint par Munch, et dont le personnage est comme un autoportrait, le visage déformé par le vertige impliqué par les forces. Cézanne, pour sa part, peint moins des pommes que les forces de germination qui les travaillent. Ou Soutine, qui ne s’intéresse pas seulement aux carcasses mais au processus de putréfaction. Gerhard Richter peint moins des portraits que la dissolution du temps qui les afflige, quand Lucian Freud, au contraire, s’attarde sur la poussée vitale de la chair jusqu’à rendre potentiellement explosifs ses modèles.
D’après une expression souvent reprise par Deleuze, ces êtres humains auraient vu ou entendu quelque chose de « trop grand pour eux ». Leurs œuvres (livres, peintures, musiques…) seraient les produits de ce qui fût, au départ, une extraordinaire intuition. Bergson ne disait pas autre chose des philosophes : tout commence par une fulgurance involontaire, une révélation qu’ils passeront toute leur vie à tenter d’expliquer. D&G adhèrent pleinement à ce point de vue.
Chercher à exprimer ces forces ou intensités s’impose comme une nécessité tant elles impliquent certes une forme de trouble voire de terreur, mais aussi une augmentation de puissance – capacité à percevoir, s’émouvoir, penser, voire découvrir des facultés jusqu’alors inconnues… Ce que Spinoza assimilait précisément à la joie. Au détour d’une page, Deleuze propose pour sa part un terme étonnant : « grâce »7.
Le compositeur Brian Eno est deleuzo-guattarien lorsqu’il dit de l’art qu’il nous permet de multiplier ces expériences-limites sans y risquer sa peau, car c’est évidemment chose rare et précieuse, mais aussi bouleversante. Les œuvres médiatisent mais surtout rendent durable ce contact avec l’imperceptible. Elles font de nous des artistes par procuration, sans pour autant convertir les salles de musées ou de concerts en sas pour futurs aliénés.
On mesure ainsi l’importance fondamentale que tient l’art dans la métaphysique de Mille Plateaux. Les artistes sont des éclaireurs, des intercesseurs entre deux mondes et ce d’autant mieux que tout passe par la sensibilité. Ou plutôt, ces créateurs donnent accès à un monde qui est impliqué en secret dans notre environnement : ce spatium intensif qui est le foyer vital de toutes choses.
Sur un plan musical, ces forces impliquées deviendraient audibles via une distorsion de notre sensation qui bouleverse, comme par un effet domino, toutes nos autres facultés : imagination, entendement et raison, etc. Il n’est pas question d’acquérir une oreille absolue déclare Deleuze lors d’une conférence à l’IRCAM, mais une « oreille impossible ». Car tout repose sur un paradoxe : percevoir l’imperceptible, selon un écart aberrant (une intensité) qui force la sensation, la pousse au-delà de son régime ordinaire, jusqu’à sa propre limite.
Distinguons à présent sur un plan musical ce qui est de l’ordre de la représentation, puis des forces ; pour ensuite saisir comment ces deux domaines entre en tension pour donner vie à une œuvre d’art. On constatera alors comment D&G sont parvenus, avec Mille Plateaux, à analyser avec profondeur ce paradoxe pointé par Jankélévitch, et que l’on pourrait reformuler de la manière suivante : pourquoi la musique nous émeut et nous donne à penser dans l’exacte mesure où s’y inscrit un « rien », trace pourtant d’un infini ? On vendra la mèche, en guise de boussole : ce rien vertigineux, telle est la nature de l’intensif.
Le système ponctuel
D&G assimilent dans Mille Plateaux ce qui est de l’ordre de la représentation en musique à ce qu’ils baptisent un système ponctuel8. Celui-ci impose au matériau sonore un encodage qui assure sa cohérence et son unité. Une structure qui se fonde sur deux coordonnées : une ligne horizontale qui assure la mélodie et la ligne de basse ; et une ligne verticale qui se charge de l’harmonie. Ainsi, lorsque plusieurs lignes horizontales se superposent verticalement, leurs rapports permet le contrepoint. La ligne verticale se déplace horizontalement, et gère alors l’enchaînement des accords.
Ces deux lignes, par leurs entrecroisements, assignent des points – les notes. De cette façon, l’espace musical (entendons l’ensemble a priori des sons possibles) se voit soumis à un balisage qui décante des formes (mélodies, accords, motifs, thèmes), mais aussi planifie leurs évolutions dans une période de temps donnée (développement thématique…).
L’invariabilité de ces repères dépend moins de leur persistance dans l’histoire, mais tient à sa fonction objective de polarisation dans le domaine sonore. D&G invoquent ici le système tonal ou diatonique, fondé sur les lois de résonances ou d’attractions, et qui déterminent des repères, des foyers dont l’exemple rudimentaire demeure la tonique9.
On peut reprocher au système ponctuel d’énumérer des caractéristiques on ne peut plus générales, qui relèvent de cours élémentaires de musicologie. Seulement, détailler ces propriétés est nécessaire puisque la pensée de D&G, à l’instar de Bergson, décante des tendances pures d’individuation dans chaque domaine qu’elle aborde.
Comme nous le verrons, si le système ponctuel correspond à l’approche traditionnelle des sons ; ce sera ensuite pour mieux distinguer une tout autre conception, plus complexe à appréhender : celle des forces.
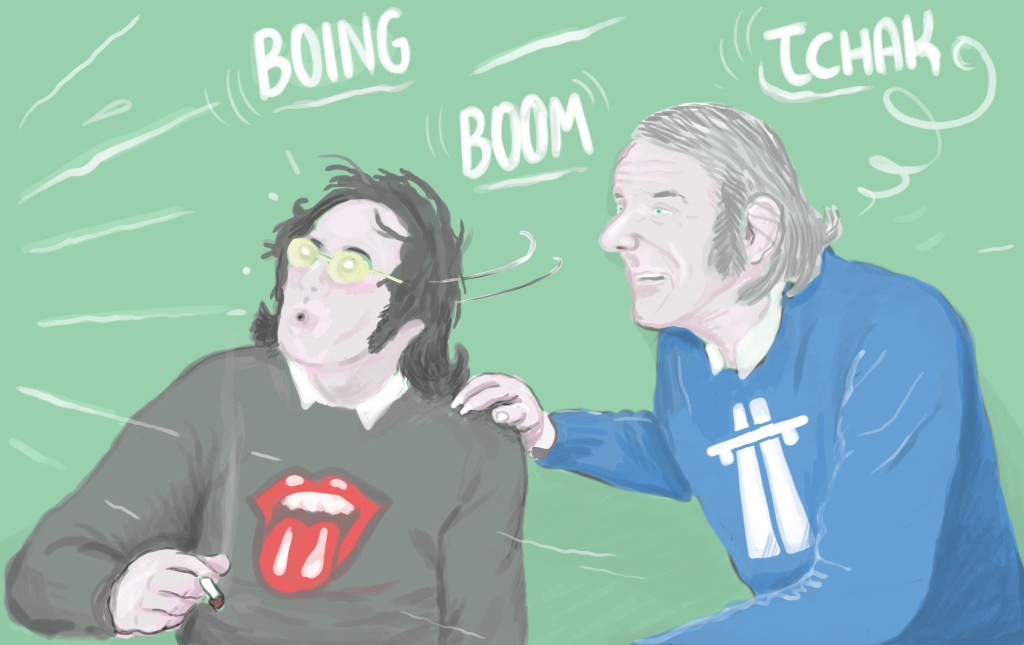
Espace strié et temps pulsé
Qu’implique l’application du système ponctuel sur le plan du son et du temps dans une œuvre musicale ? Quelles sont les limites que ce système impose aux compositeurs et, par ricochet, à l’auditeur ?
D&G décrivent l’espace sonore, c’est-à-dire l’ensemble des fréquences, comme étant strié. Le champ fréquentiel (soit de 20 Hz à 20 000 Hz pour l’oreille humaine) est découpé selon un étalon qui correspond, dans notre tradition européenne, au tempérament – système d’accordage qui répartit les intervalles selon une octave. Le champ fréquentiel est ainsi systématiquement réduit à des notes et son striage assure le développement des mélodies, des accords… Ce que D&G qualifient globalement de « formes ».
Aux côtés de ce striage fréquentiel apparaît un temps pulsé. Celui-ci désigne le fait que la durée d’une composition se voit scandée par l’intermédiaire de la mesure, du tempo, de la métrique… Ces repères donnent une pulsation plus ou moins régulière, selon le nombre de battements dans une tranche de temps donné.
Néanmoins, ce temps pulsé ne se limite pas à des pulsations et des périodicités simples. Il existe des pulsations longues et très irrégulières, mais qui n’en demeurent pas moins « pulsées ». Par exemple, si nous avons le fameux cri primal « one, two, three, four ! » des Ramones, ou le « Boing Boom Tschak ! » robotique de Kraftwerk, la tradition du raga hindou, qui se fondent sur des rythmes (tāla) de seize temps ou de trente-trois temps, n’en est pas moins elle aussi pulsée.
On peut donc affirmer qu’il y a pulsation toutes les fois où le temps se voit spatialisé afin d’être mesuré. Ceci correspond à l’approche « classique » pour maîtriser le temps musical : « (…) confier à l’esprit le soin d’apposer une mesure commune ou une cadence métrique à toutes les durées vitales10. » On sent bien là encore la présence de Bergson…
Plan de transcendance
En définitive, le système ponctuel constitue une structure a priori, c’est-à-dire jamais audible en elle-même, mais inférée d’après les évènements sonores. Raison pour laquelle D&G la nomment plan de transcendance — transcendante en ceci qu’elle assure l’organisation, la hiérarchisation des formes musicales depuis une « dimension supérieure » aux événements sonores. Citons les étapes d’une sonate (exposition/développement/réexposition), ou bien celle d’une chanson pop et de son alternance « couplet/refrain ». C’est un plan qui est déjà donné et qu’un compositeur doit suivre.
L’auditeur averti, pour sa part, est capable d’anticiper les événements, devinant par exemple qu’à la suite d’un « pont » sera sans doute repris le refrain, et qu’il s’approche ainsi de la fin d’une chanson. La musique est dès lors écoutée depuis l’instant présent, tel un point qui se déplacerait le long d’une ligne dont le parcours est déjà balisé par des segments. Une appréhension classique du temps que D&G baptisent « Chronos ».
Le système ponctuel se trahit donc par six caractéristiques :
– La musique obéit à une structure non audible en elle-même (plan de transcendance ou d’organisation).
– Cette structure impose à la matière sonore le développement de formes (approche hylémorphique du matériau).
– Le champ fréquentiel est strié selon un étalon qui correspond, dans notre tradition européenne, au tempérament.
– Le temps est pulsé, plus ou moins régulièrement, et la durée se voit ainsi « spatialisée ».
– Toute variation (mélodies, motifs…) renvoie à des repères fixes (notes) toujours plus profonds qui la limite.
– L’auditeur a une écoute inscrite dans le présent et anticipe les évènements (Chronos).
Le système linéaire
Au système ponctuel, D&G opposent le système linéaire qui fonctionne comme une puissance de décodage du champ sonore. Au lieu d’un balisage établi par un croisement horizontal/vertical, ce système assure au contraire la suprématie de ce que les deux philosophes appellent la diagonale. « Libérer la ligne, libérer la diagonale : il n’y a pas de musicien ni de peintre qui n’aient cette intention. » (MP, 362)
Étant donné l’abstraction du phénomène, appuyons-nous d’emblée sur un exemple de Mille Plateaux, lui-même emprunté à Pierre Boulez – compositeur et théoricien sur lequel se sont par ailleurs fortement appuyés D&G. D’après Boulez, le compositeur viennois Anton Webern serait parvenu au début du vingtième siècle, grâce à son atonalisme11 radical, à relativiser la contradiction entre les phénomènes horizontaux et verticaux de la musique tonale. « Il a créé une nouvelle dimension écrit Boulez, que nous pourrions appeler dimension diagonale, sorte de répartition des points, des blocs ou des figures non plus dans le plan, mais bien dans l’espace sonore . »

Atonalisme, intervalles disjoints, longs silences, perversion de la structure – pareils traitements auraient sapé tout « réflexe » propre au système ponctuel, pour libérer la musique du plan de transcendance. Ou comme le dit Boulez : l’œuvre n’a plus lieu « (…) dans le plan, mais dans l’espace sonore…12» On pressent ici que ce qui se décante, c’est la trace discrète, sous la forme d’un pur dynamisme, du spatium intensif qui se retrouverait normalement annulé dans toute actualisation, mais que Webern fait persister.
Au-delà du seul Webern, découvrons quels sont les effets du système linéaire sur le son et le temps… Là, nous pénétrons dans un tout autre monde, contre-intuitif puisque c’est la représentation, autrement dit notre façon habituelle d’appréhender la musique, qui est bousculée, pour ne pas dire mise à sac. Car il s’agit bien d’approcher ce qui est de l’ordre de la « perception moléculaire », c’est-à-dire d’impressions infra-conscientes (trop fluides pour les catégories, formes ou durées mesurables), mais qui néanmoins imprègnent voire bouleversent nos facultés.
D&G s’inscrivent ici dans le sillage des « petites perceptions » leibniziennes : le fracas d’une vague est en réalité la somme d’une infinité de petits bruits que certes nous n’isolons pas, mais qui nous affectent. De même, Bergson considérait que la perception consciente n’était que la crête d’un champ bien plus dense de micro-perceptions. C’est bien de ces dernières dont il s’agit lorsqu’on pénètre dans le territoire de l’intensif.
Espace lisse et temps non-pulsé
Sur le plan fréquentiel, c’est un espace lisse qui se révèle lorsque le striage libère de son emprise via le système linéaire. Au lieu d’intervalles qui assurent le tempérament, le lisse consiste en une répartition statistique des fréquences. Ce même tempérament finit alors par imploser au profit de distances et de voisinages indécomposables. Cela donne, à l’écoute, non plus la dualité classique « tension/résolution », mais plutôt une alternance « densité/rareté ».
On pense ici à la libération audacieuse opérée par Varèse qui revendiquait dès le début du vingtième siècle le droit d’utiliser tous les sons possibles, et qui parlait de « masses organisées de sons » et non plus de notes. Il comparait même le tempérament – avec un mépris princier – à un fil à couper le beurre !

L’espace lisse s’accompagne, sur le plan de la durée, d’un temps non-pulsé. La temporalité n’est plus organisée en fonction d’une mesure, simple ou complexe. Elle échappe plutôt à toute pulsation, cette dernière étant renouvelée à chaque moment, selon une série de précipitations et de ralentis si divergents que tout repère finit par être noyé
Invoquons la scène classique de la « nouvelle complexité » (New Complexity) et son fer de lance, Brian Ferneyhough. Ses œuvres ne permettent plus à l’auditeur une quelconque impression de pulsation, et ce par l’intermédiaire de techniques très élaborées : polyrythmies démultipliées, subdivisions irrégulières à outrance, notations surchargées, micro-indications de l’ordre du vingt-quatrième de temps…
Ce temps lisse bouleverse l’appréhension de l’œuvre qui devient un « champ de temps » ouvert. Un indice d’occupation ou de densité remplace en effet celui de vitesse induit par le temps pulsé qui faisait office de repère stable. S’en dégage une impression de « temps flottant », oscillant entre des épisodes de saturation, de suspension, d’étirement, de compression…
Une temporalité aberrante s’impose alors, où l’instant présent est comme dissout au profit d’un étirement paradoxal vers le passé (qu’est-ce que je viens d’entendre ?) et vers le futur (qu’est-ce que je vais entendre ?). Deux questions qui demeurent en suspens, mises sous tension du fait de la forte plasticité du matériau sonore. L’auditeur est, à un certain niveau, « stupéfait », c’est-à-dire que sa sensation est débordée, rendant problématique toute synthèse et classification propre à la représentation.
Heccéités
Espace lisse, temps non-pulsé entraînent une troublante inversion de perspective : c’est la variation elle-même qui devient systématique. Autrement dit, il n’y a plus des variations relatives à des repères fixes (notes, mélodies, harmonies, pulsations…), mais une variation à l’état pur. C’est ici que l’on renoue avec la métaphysique exposée précédemment, D&G considérant que toute chose formée n’est en réalité que la cristallisation d’un jeu de forces irréductible à tout invariant – primat du devenir contre la substance, primat de la différence contre la répétition.
Sur un plan intensif, D&G décrivent d’étranges « êtres musicaux » qu’ils baptisent heccéité13. Il s’agit là d’un mode d’individuation qui échappe à toute forme, et ne consiste qu’en rapports de mouvement et de repos entre une infinité de « particules » ou de « molécules sonores », le matériau étant en quelque sorte pulvérisé14.
On donnera comme exemple La Mer de Debussy qui ne « représente » pas la mer (il faut déjà tout un travail de transposition orchestrale, ce qui fera dire à D&G qu’en définitive, aucun art n’est imitatif), mais fait surgir une heccéité : un tourbillon sonore qui n’est pas un « thème » à proprement parler, mais plutôt l’expression de dynamismes complexes propres à l’élément marin : ondulations (mouvements harmoniques sans résolution), ou bien encore éclats et reflets (timbres qui génèrent certaines brillances soniques imprévisibles). On repense ici au célèbre exemple leibnizien de la vague faite de micro-perceptions…

Autre vortex – terrifiant et pyrotechnique celui-là : « Machine Gun » de Jimi Hendrix (Band Of Gypsys) où le guitariste, à l’aide d’une puissante saturation, de feed-back et l’usage de pédales d’effets, transpose sur un plan sonore d’autres heccéités : celles d’un conflit armé. Les cris et pleurs se confondent avec des crashs d’appareils par des passages expressionnistes entre bend, sustain et usage outrancier du vibrato. Hendrix restitue même les réactions depuis l’intérieur des armes : bombes à fragmentations, combustion du napalm et du phosphore blanc… Un champ de bataille intensif improvisé sur une six cordes, alors qu’il avait fallu au compositeur Penderecki plus d’une soixantaine d’instruments à cordes pour transposer la fission de la bombe atomique sur un plan sonore en 1959 (Thrène à la mémoire aux victimes d’Hiroshima).
Plan de consistance
Cette bascule qui fait de la variation la matière première d’une œuvre (ou pour reprendre l’expression de D&G, le fait que le thème est déjà la variation) génère non plus un plan de transcendance mais un plan de consistance. Plus de structure a priori mais un plan d’une toute autre nature, qui se construit à mesure que les évènements sonores adviennent sur lui.
Les développements de formes sont remplacés par des phénomènes de proliférations et de contagions. Rien que des éléments non-formés qui se distinguent par leurs vitesses différentielles, entrant dans des connexions variables, et formant un complexe d’heccéités dont la clameur est décrite, magnifiquement, comme un « clapotement moléculaire » (MP, 327)15.
Considérons par exemple Music For 18 Musicians de Steve Reich. L’ensemble du processus de déphasage entre instruments est audible. Toutes les règles harmoniques sont respectées, le temps est pulsé, et pourtant… toutes ces vitesses différentielles génèrent un flux de différenciations qui survole l’espace ponctuel, et dépasse la synthèse de nos facultés, nous transportant par paliers intensifs, notamment lorsque que la tonalité change.
Cette impression à la fois tangible et insaisissable que le climat sonore se renverse quand le centre tonal est déplacé, c’est cela une heccéité – une zone de passage, une inflexion atmosphérique qui pourtant imprègne tout. L’équivalent de ce que D&G appellent un « paysage sonore » enveloppé dans la musique. Ainsi fait-on un « voyage sur place », c’est-à-dire un voyage en intensités.
De même, lorsque cette pièce d’environ une heure prend fin, on pressent que nous étions immergés dans tout autre chose que la temporalité ordinaire propre au système ponctuel (Chronos). Notre appréhension s’est en réalité amplifiée, incapable de se fixer sur le moment présent mais restant plus sensible à un phénomène d’étirement : « Qu’est-ce qui vient de se passer ? » / « Qu’est-ce qui va se passer ? ». Ce phénomène temporel, surnommé Aiôn, se conjugue avec le régime intensif qui n’est que perpétuel écart, variation à l’état pur.

Ainsi, le système linéaire se traduit-il par six tendances :
– La musique n’est plus soumise à une structure a priori mais engendre un plan de consistance non planifié, mais qui provoque au contraire une « transmutation non volontaire » (MP, 329) selon des rapports cinétiques (vitesses et lenteurs).
– Sur ce plan se développent non plus des formes (mélodies, motifs…) mais des heccéités.
– Le champ fréquentiel est lissé, c’est-à-dire libéré de toute répartition qui voudrait le brider. Si notes il y a, elles sont subordonnées à la diagonale.
– Le temps est non-pulsé car il échappe à toute mesure, et ce grâce à d’incessants ralentissement, accélérations, bifurcations, déphasages…
– Les variations n’obéissent plus à des repères mais renvoient à une variation continue toujours plus profonde.
– La sensibilité de l’auditeur subit une appréhension du temps qui fuit tout présent au profit d’un étirement à la fois vers le passé et le futur (Aiôn).
- Gilles Deleuze et Felix Guattari, Mille Plateaux, Paris, Minuit, 1980, p 47. ↩︎
- Pour ce qui est du problème métaphorique, nous conseillons vivement l’ouvrage de François Zourabichvili La Littérarité et autres essais sur l’art. L’ensemble de ses travaux menés sur Deleuze restent d’ailleurs tous exemplaires. ↩︎
- Mille Plateaux est inépuisable : c’est un cristal. Son contenu change d’allure selon que l’on le lise sous le prisme de Nietzsche, de Spinoza, voire de la psychanalyse, de la géographie, de la littérature, de l’éthologie… Une caractéristique qui concrétise ce mot d’ordre que les auteurs se donnent pour objectif : le multiple, il faut le faire ! ↩︎
- Gilles Deleuze, Différence et Répétition, Paris, Presses Universitaire de France, 1968, p. 79. ↩︎
- Henri Bergson, L’Évolution créatrice, Paris, Presses Universitaires de France, 1998, p. 75. ↩︎
- Gilles Deleuze, Différence et Répétition, op. cit., p. 155. ↩︎
- Gilles Deleuze et Claire Parnet, Dialogues, Paris, Flammarion, 1996, p.109. ↩︎
- Dénomination qui ne manque pas d’humour, lorsque l’on sait que rien n’est pire pour un musicien que de perdre le tempo. ↩︎
- Note primordiale et génératrice d’une gamme ou d’un mode. ↩︎
- Gilles Deleuze et Felix Guattari, Mille Plateaux, op cit., p. 597. Du fait de nombreuses citations de l’ouvrage, les références seront désormais incluses dans le corps du texte via l’abréviation « MP ». ↩︎
- Utilisation de toutes les notes de la gamme chromatique en faisant l’économie de la tonalité et de la hiérarchisation entre les sons que celle-ci implique. ↩︎
- Pierre Boulez, Relevé d’apprenti, Paris, Seuil, 1966, p. 372. Il ne faut pas se figurer la diagonale comme une ligne droite ou une simple courbe qui passe entre les points, mais plutôt comme une ligne qui ne cesse de bifurquer et ne suit aucun contour. ↩︎
- Terme emprunté au philosophe Duns Scot et qui désigne la singularité absolue d’une chose. ↩︎
- Les particules ou molécules ne doivent pas être confondues avec des atomes qui restent « des éléments finis doués de formes » (MP, 320). Il s’agit d’autres termes, plus imagés, pour désigner les intensités, mot utilisé par Deleuze dans Différence et Répétition. Quant à l’étrange expression « vitesses et lenteurs », elle signifie qu’il n’y a jamais absence de mouvements, mais seulement une lenteur relative à une certaine vitesse. D&G s’inspirent ici de Spinoza, et plus particulièrement de ce passage de l’Ethique où l’individu est décrit comme un « composé de corps qui ne se distinguent entre eux que par le mouvement et le repos, la vitesse et la lenteur, c’est-à-dire de corps les plus simples. » (Baruch Spinoza, L’Éthique, Paris, Gallimard, 1954, p. 135). ↩︎
- Il faut se garder toutefois d’assimiler heccéité et brièveté dans le temps. Une suite de vagues, une bataille, un jour, une vie même, considérés sous l’angle des forces, sont des heccéités. Ce qui différencie cette dernière d’un phénomène tel qu’on le considère habituellement est la dilution de la substance (forme/matière) au profit des jeux de forces. Un exemple d’heccéité dont nous faisons tous l’expérience : la terrible fin d’après-midi de certains dimanches, quand la venue du soir retarde et que nous sommes pris entre chien et loup – diffuse angoisse partout. ↩︎
