Étienne Besse : Incipit Céline
La première phrase du Voyage au bout de la nuit et Mort à Crédit de Céline condense un commencement qui embrasse sa fin. Elle n’est cependant pas qu’une annonce de l’accent général du roman ou du résumé de son déroulement ; cette première phrase exprime l’achèvement même du commencement : elle dépose la Mort dans le commencement.
Avec le titre du Voyage, nous avons un but qui n’est pas la nuit même, mais sa fin, son « bout » comme achèvement qui annule la nuit : cette indication est donc son auto-suppression. De même, la première phrase « Çà a débuté comme çà » indique aussi un renvoi : nous allons du « çà » au « çà », donc du Même au Même alors que nous débutons. Ainsi, le titre du roman annonce un voyage qui ne vise que le moment de son annulation ; et la première phrase exprime un commencement qui n’est qu’un sur-place, une insistance paralysée exprimant un voyage qui n’est même pas un détour ou un retour, mais un début qui s’enfonce en son commencement.
En cela, la structure sonore du mot « débuter » est presque perverse : dé-buter peut s’entendre comme se départir du but, se dégager de tout but. Le voyage dont il est question est donc celui du commencement sans présupposer du but ni même d’un départ possible dans son surplace ; il vise ce « bout » annulateur du voyage. Ce mot « débuter » résonne aussi avec le « bout » de la nuit : comme un débouté, un rejet du principe même du voyage comme départ et arrivée, comme rejet de l’étrangeté d’un dépaysement exotique. Ce dont il est question est l’extrême du tout au tout, du bout dès le début. Ce bout de la nuit qu’est l’aurore n’est plus la nuit, de même lorsqu’ Épicure indique à Ménécée que « la Mort n’est rien puisqu’elle consiste en la privation de la sensation », de même, Céline va faire sentir cet ultime de la sensation, ce bout de la nuit en son absence, et nous mener à cet extrême de la privation de sensation apparente qu’est la nuit, entre perte de sensation et genèse de la sensation.
La résonance de la lettre « A » dans cette première phrase en témoigne ainsi : la première lettre de l’alphabet se redouble et s’accentue indéfiniment dans ses sonorités : « çÀ A débuté comme çÀ ». On ne sort donc pas de cette exploration du commencement. Ce n’est même pas Un commencement qui présupposerait donc sa sortie vers autre chose : c’est le commencement qui ne se fait pas autre en soi, qui ne va pas vers un ailleurs mais pose sa négation. Céline fait résonner l’en soi, le simple immédiat qui ne s’articule pas, s’ouvre en rien, ne se lie à rien.
Le terme « çà » est la manière de désigner la désignation elle-même dans sa grossièreté initiale, puérile, qui indique d’un geste sans pouvoir nommer. Nous sommes dans un commencement innocent qui n’est pas su, pas conscient, un cri qui n’a personne d’autre à qui nous pourrions témoigner d’une sorte de reconnaissance possible et qui comprendrait déjà l’indication désignée. Dans cet incipit, la désignation du « çà » se rabat en « comme çà » : l’ébauche est comparée, donc le çà a été déjà vécu mais il est perdu dans un initial qui doit retrouver l’initial par l’initial pour être véritablement désigné. Il est le scrupule qui craint de se départir de cet initial. Il attend l’initial dans la première phrase en y restant indéfiniment.
Quand Céline écrit « comme çà », il provoque la forme littéraire classique de la comparaison comme originaire métaphore – de la même manière que Mallarmé qui voulait supprimer le mot « comme » de la langue française. Il revient à l’originel de la comparaison en son mouvement de désignation qui prend forme dans un signe reproduit. Et ce signe recouvre le vécu initial mobilisé par un vécu scripturaire qui, comparativement, est apparemment en déficit, mais en même temps au-delà de l’initial vécu qui renaît cependant dans la lecture. Plusieurs expériences se sédimentent dans l’écriture et c’est cela que Céline veut faire ressentir en le donnant à lire non comme écrit seul, mais bien aussi comme écriture même.
Car bien que le vécu semble initial par comparaison avec ce qui est en apparence rapporté, en seconde main, par la littérature, la désignation prend et donne forme au vécu. L’approfondissement du commencement est donc le vécu de la désignation même, le « çà » qui désigne le vécu ; mais également ce souffle, ce geste même qui conditionne aussi la désignation, le signe. Le Voyage se place à la pointe expressive, lorsque le vécu vire et bascule dans la désignation et que le signe articule le vécu en retour.

Dans le Voyage, la Fin est donc déjà vécue dans un début qui est déjà terminé. Dans Mort à Crédit, ce qui est donné, c’est aussi la Mort ; donc la Fin ultime est déjà donnée alors que nous ne l’avons apparemment pas vécue. La littérature nous donne la Mort à vivre, mais à crédit, en avance avant de payer par la suite la dette que cette œuvre littéraire nous aura offerte au présent. Walter Benjamin l’interprète ainsi :
« … L’important, dans le roman, ce n’est donc pas qu’il nous instruit en nous présentant un destin étranger, mais que ce destin étranger, par la flamme qui le consume, nous procure une chaleur que nous ne trouverions jamais dans notre propre vie. Ce qui attire le lecteur vers le roman, c’est l’espérance de réchauffer sa vie transie à la flamme d’une mort dont il lit le récit1… »
La Mort s’actualise dans l’écriture même. Mais avec Céline, ce n’est pas l’attente de « la mort viendra et elle aura tes yeux » d’un Pavese qui s’apercevra qu’Elle est déjà là, après-coup, à partir de l’annonce du reflet. Céline ne laisse pas le temps de la consomption réflexive ou de la reconnaissance du reflet par devers soi comme son imago mortis. Il cherche l’éclat des instants.
Quelle est donc cette vie transie par la mort que porte l’écriture de Céline dans l’incipit de Mort à crédit ? La première phrase du roman – la plus intense de toute la littérature – est la suivante : « Nous voici encore seuls. » C’est une phrase sans verbe, c’est apparemment comme un cri dernier que rien ne « verbalise », tout comme dans le Voyage dont le « çà » n’était que l’ébauche, l’amorce de la désignation dans un geste avec une main de nourrisson hurlant son besoin. Mais ici, nous sommes en réalité dans une sorte de soupir qui n’appelle plus personne. Un soupir qui retombe sur la facticité d’un constat comme dans le Voyage : l’ « encore » qui n’est jamais sorti de la même situation.
A travers et avec le français, nous pouvons aussi entendre dans la sonorité de « encore », le Corps qui témoigne d’une solitude vivante et non abstraite : nous vivons la solitude. Qu’est-ce qu’une vie solitaire qui n’a plus que le témoignage d’un langage silencieux ? Le langage même est charnel dans l’expression de ses signes, et la solitude qu’exprime un langage s’inscrit comme monde, donc comme environnement où vivent des autres en relation, c’est-à-dire selon un « nous ».
« Nous » est dans cette phrase un ensemble « seuls », comme un soupir de constant constat de la condition humaine. Là encore, il n’y a pas de reconnaissance qui cherche à s’assurer de celle-ci, qui cherche à la démontrer. Céline joue évidemment sur le « nous » qui peut être un Je comme nous de majesté, mais il met le « seuls » au pluriel. Est-ce parce que notre solitude est toujours plus ou moins plurielle ? Tous ensemble nous sommes seuls, ensemble nous partageons une communauté de solitude, nous reposons sur une substance solitaire. Ce pluriel fait que la solitude particulière, singulière n’a pas de sens, elle s’inscrit toujours comme un ensemble.
Car « Voici » est cette présentation du « Nous ». Céline ne dit pas « nous sommes seuls », mais « nous voici encore seuls ». C’est une entrée, une venue, une présentation en l’autre que ponctue une occurrence qui nous fait seuls, seuls ensemble.
Nous nous présentons ensemble sans verbe, sans un Verbe johannique qui nous tiendrait encore « auprès de Dieu ». Nous expirons ensemble dans une condition sans extériorité, sans supériorité capable de nous tenir ou retenir.
Que signifie le « nous » qui s’achève en solitude ?
Que signifie un « voici » comme présentation commune qui n’a pas de comparaison, de distance rendant possible une reconnaissance extérieure ? comment comprendre ceci avec l’« encore », c’est-à-dire ce qui témoigne d’une forme de reconnaissance ?
Qu’est-ce que cette pluralité de « seuls » et quel sens peut avoir une solitude plurielle ? est-elle seulement partagée ? comment partager la solitude ?
Le Voyage a pour épigraphe une chanson de l’armée suisse du temps de la Révolution française. Mort à crédit d’une chanson de prison. Or à travers ces deux textes, les « sujets » devraient s’inverser si l’on considère que le Voyage est un surplace du commencement, et Mort à crédit, une expérience ultime, un avant-goût offert avant même d’être vécu. La non-vie est vécue par la littérature, la mort est donc vécue avant même qu’elle ne nous atteigne au bout de la vie : l’épigraphe du Voyage expérimente la mort comme « bout », limite, celle que nous lisons dans la Chanson de prison dans Mort à crédit témoigne d’un isolement forcé qui ne peut que faire du sur-place.
Le retour à l’encore-seul-ensemble indique un fond commun dont on ne peut s’extirper, sur lequel on retombe irrémédiablement « encore ». Ce commun sur lequel on retombe ensemble n’est cependant pas dit comme non identique ou étrange : il est pluriel, dans une altérité qui se fait commune dans sa pluralité, et par là, nous rend indiscernable.
Pour comprendre ce pluriel du nous « seuls », prenons deux froids constats de Emerson :
« Je ne puis me rendre chez mes parents les plus proches, parce que je ne souhaite pas être seul2.»
« Dès lors que nous rencontrons quelqu’un, chacun devient une fraction3. »
Autrement dit, le « nous » social ne forme pas un corps de société, mais fragmente le composé même de l’individuel par la société. Tout ensemble est abstrait, il n’y a que la qualité d’un échange qui rende proche dans sa complétude. Et pourtant cette complétude n’est pas un rapport de convenance ni un isolement individuel.
Avec la phrase de Céline, il n’y a même pas de distinction possible, nous sommes seuls dans une pluralité pourtant indécomposable et inindividuable. La complète solitude individuelle n’a pas de réalité. Ce que la solitude exprime individuellement, c’est qu’Elle s’inscrit non pas dans un isolement, un esseulement abstrait, ou sortie extérieure asociale, mais dans une pluralité qui nous fractionne d’autant plus que la proximité aux « proches » est intime. La solitude est un renvoi dans l’indénombrable. Avec l’incipit de Mort à crédit, cette fragmentation plurielle n’offre plus qu’un Nous, lequel est à prendre non comme un désordre où chacun intervient et se disperse, mais comme l’unicité d’une formation au sens de Nietzsche :
« Toute unité n’est unité qu’en tant qu’organisation et jeu d’ensemble : tout comme une communauté humaine est une unité, et pas autrement : donc le contraire de l’anarchie atomiste ; et donc une formation de domination, qui signifie l’Un, mais n’est pas une4. »
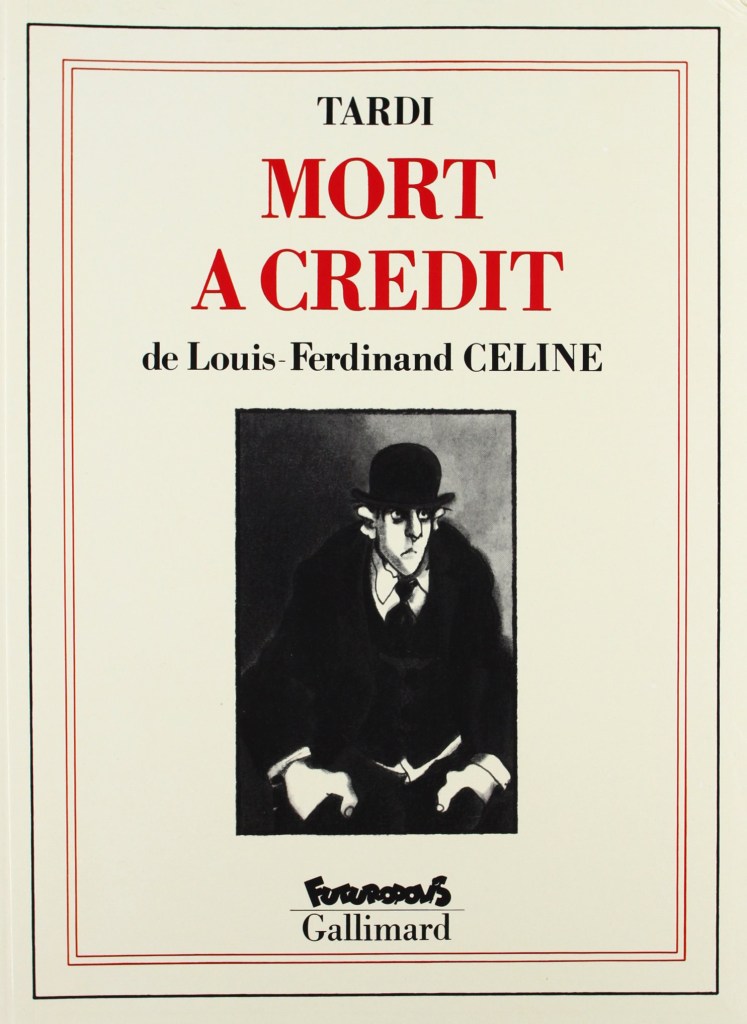
Cette même signification de l’Un du Nous dans les seuls se joue comme ensemble. C’est dans une occurrence, une reprise, que cette signification est possible en tant que « encore ».
Cet « encore » est un retour qui n’est cependant pas un « toujours ». L’encore fait que nous retrouvons un moment mais qui n’a pas besoin de reconnaissance car il était déjà là, constant, à chaque instant si nous y prêtions attention. Ce n’est pas un reflet, écho réflexif qui nous reviendrait automatiquement, mais une situation dont nous sentons le poids : nous en sommes « au même point » et la résistance du Même pèse comme « encore » alors que par ailleurs nous l’avions comme oublié temporairement. Celui-ci n’a pas changé, pas varié, on le retrouve tel quel.
Nous portons cet état de solitude commune comme chacun : cela devrait donc annuler la solitude puisque c’est ensemble que nous la trouvons, non comme tradition, nouveauté, mais essentielle de la récurrence. Et pourtant, elle n’est pas une promesse de solidarité dans la phrase de Céline.
L’encore en français se dit aussi en deux contextes : la plainte qui réclame plus, ou bien la plainte qui en a assez. Céline tient cette ambiguïté de la plainte solitaire qui ne reçoit pas ou se noie dans le trop. C’est en cet équilibre, cet instant seul que la Mort va peut-être éclore dans son aspect à la fois banal de la condition humaine, sa finitude, et à la fois exceptionnel et inattendu de l’événement même : entre trop et pas assez, la mort tient les deux bouts.
L’esseulement est l’abandon. L’absence se constate par l’attente. L’isolement est la sensation des limites. Le solipsisme le refus de la communication. Tous ces modes sont relatifs, c’est-à-dire ouvrent à l’altérité et présupposent la forme de l’altérité, même dans son exclusion. Céline parle d’un sens pluriel qui embrasse potentiellement toutes ces modalités, mais au point qu’il ne reste que ces modes mêmes, des rythmes de désignations sans mise en relation, des formes « sans personne, sans rien ».
Dans cette altérité invisible et aveuglante de la Mort, le soupir « nous voici encore seuls » pourrait donc signifier « nous voici de nouveau indiscernables » : nous atteignons un point d’expiration où l’on va se réabsorber ; nous sommes autre parmi les autres, au point qu’il n’y a plus de facteur de relation donc de désignation. Nous sommes Autre en l’autre parmi les autres. Selon Heidegger « les autres ce sont plutôt ceux dont la plupart du temps on ne se distingue pas, parmi lesquels on est aussi5. » L’avec n’est donc même pas commun, ce n’est pas une relation paradoxalement puisque l’avec rend indistinct si l’on suit Heidegger. L’avec ne mettant pas à distance, il ne noue pas de relation singulière, il rend commun.
Le « voici » que pose Céline est ce moment où l’on admet ensemble que l’existence se présente comme condition générale qui pourtant nous rend indiscernable, non individué, non distingué, non singularisé. C’est un retour au vivant pur qui en est invivable au point qu’il nous déchire et isole dans l’invisible voix commune, cette rumeur d’un soupir abandonné dans la noyade du genre humain. C’est un unique constat propre à la solitude sans unicité puisque c’est nous, indistincts, en masse.
Le soupir mousseux du « nous voici encore seul » échoue de cette intégrale condition, donc cette inconditionnelle condition qui ne s’arrache pas d’elle-même.
Le « voici » est habituellement une présentation, une entrée en scène, qui répond à un appel, une demande. Le présentateur annonce : « voici à présent ceci… » « le voici qui arrive !… ». Ou bien encore, solennellement, on répond « Me voici ». Avec « Nous voici encore seuls », il n’y a pas de réponse ou d’entrée présentative. L’Encore a clos l’entrée. Il y a alors cette stagnation sans sursaut, sans décongestion de soi à soi qui ne se donne, et ne peut se donner à quoi que ce soit. Il n’y a pas de déviance, de déficience dans ce « voici encore », il n’y a qu’une teneur de la condition massive, sans extérieur possible, sans intérieur non plus puisqu’il s’agit d’un « nous » indiscernable et indistinct. La distance nécessaire à la coexistence n’est pas envisagée dans cet encore-seuls.
Heidegger décrit : « cette distantialité inhérente à l’être-avec implique que le Dasein se tient, en tant qu’être-en-compagnie quotidien, sous l’emprise des autres. Il n’est pas lui-même ; l’être, les autres le lui ont confisqué6. » Or chez Céline, « nous » sommes confisqués dans et par « l’encore » : la solitude ne fait pas son entrée par surprise ; l’encore en a déplacé l’annonce et la révélation. Aucune dramatisation donc, aucune déviation ou sortie qui constituerait en même temps une distance dans ce « nous voici encore seul » : ce n’est pas que Céline falsifie un appel qui a déjà sa réponse dans l’encore, que l’entrée en scène soit donnée pour tous et pour personne : la relation est seule. C’est la relation qui pluralise mais la relation est même, « encore ». Elle n’offre pas de distance singulière et nécessaire à une compagnie ; la relation est déjà là comme « encore », constatée à nouveau indéfiniment.
Qu’est-ce qu’une solitude commune ? Arendt indique que la solitude est la condition même de la pensée, c’est-à-dire que la pensée nous fait être avec nous-même, c’est une relation à soi-même, donc une vie avec soi qui rend toute morale possible ; un acte non moral rend la vie avec soi-même impossible, donc la pensée absente, la solitude inenvisageable. Dans « Questions de philosophie morale7 » Arendt glisse en évoquant « l’esseulement ». L’esseulement semble ainsi se situer entre absence et isolement – ce dernier étant condition de la concentration dans le travail d’une œuvre selon Arendt. C’est peut-être ici que se situe ce dont parle Céline dans cette pluralité de la condition humaine, comme ensemble des seuls : un esseulement, un abandon essentiel. Qu’est-ce qui constituerait le sens de cet abandon déterminant l’esseulement ?
Quand on goûte pour soi quelque chose, que l’on expérimente et apprécie cela, que ce soit par l’adhésion ou la répulsion, ce qui est engagé est l’immédiateté solitaire de la sensation en sa vibration propre, et en même temps la résistance de cette sensation à la simple consommation, parce que le fait de goûter engage à une interprétation. Car ce n’est pas ma survie qui est directement en jeu mais le moment où je peux sentir une complétude des sens et non l’annulation de leur appel déterminé à se rassasier. Ce qui est en jeu dans le goût, c’est la relation des sens eux-mêmes, relations qui en même temps me dépassent puisque je suis réalisé par ces relations perceptives sans les expliquer. En goûtant, je suis à la fois seul mais aussi d’emblée dans une relation d’altérité vis-à-vis de moi-même, et ainsi engagé vis-à-vis des Autres. Kant analyse cette tension de la discussion qu’amène le goût – en tant que jugement de goût – comme relation aux autres dans laquelle nous voulons réinscrire et partager notre perception, c’est-à-dire faire opérer cette relation des sens au sens. Nous seul avons goûté, et pourtant nous en discutons avec les autres parce que nous avons été arrachés à nous-même dans l’appréciation. Nous avons été autre en soi, fragmenté dans une totalité qui nous comprenait sans cependant que nous puissions la comprendre. Nous réinterprétons alors cette sensation, nous la simplifions dans les mots, mais en même temps, par cette inscription du dialogue, nous retrouvons les mêmes modes variés dont notre goût procédait quand la sensation nous avait extirpé et altéré. C’est donc l’expérience même du goût qui déploie une solitude fractalisée, au pluriel, comme esseulement de nous-même par nous-même que nous voulons reprendre et partager par la confrontation avec l’altérité et l’attente de son assentiment tout en sachant vaine toute discussion.
Céline indique avec « nous voici encore seuls » que cette sorte de constat ne part pas du « Je », mais d’un ensemble, d’un nous < le noûs (νοῦς) ? > qui a une solitude plurielle dans le temps, comme occurrence qui se pense parce qu’elle s’opère par retour constant. Ce serait donc une condition « d’être-seul-ensemble » au point que le Je est perdu et qu’Autrui est indiscernable.
Mais peut-être reste-t-il le goût de cette condition en ses modalisations. Ici, l’esthétique célinienne constate seulement l’encore « seuls » : comme une harmonie sans accord ni mélodie.
Nous atteignons le paradoxe ultime avec cette phrase terrible, comme un glissement de terrain à chaque part qui pourtant s’appartient dans ce flux. Le Je est inexistant et pourtant en abandonnant au Nous le caractère abstrait de sa structure solitaire, il scintille, instantané, fantomatique instant, à travers la langue. L’ensemble Nous est un flux en fragmentation continuelle par la pluralité solitaire des seuls. C’est peut-être là, dans ce mouvement musical, « le secret de notre âme, chantant8. »
La condition humaine ne s’accorde pas dans le goût, ne forme rien de commun, mais elle goûte comme une expérience de conjugaison. Elle décline ce qui a de la valeur, ce-qui-vaut-pour et spécule sur ce qui peut appartenir et apparaître pour.
Comme indiqué à travers Nietzsche, le goût en tant qu’acte signifie donc l’Un mais n’est pas un : le particulier atomique ne goûte rien dans sa désorganisation particulière inerte, multiplicité vide alors même qu’elle est apparemment autant plurielle qu’individuelle. Mais ce n’est que dans la forme d’un ensemble partagé que nous goûtons réellement, que l’expérience a Une signification alors même que nous sommes « seuls » sans l’être particulièrement. Nous ne sommes donc plus simplement dans un devoir-être kantien qui exige un assentiment ; nous sommes réellement mobilisés par la Solitude comme « encore » essentiels et nous retentons indéfiniment l’expérience du goût même si elle nous fragmente. Et lorsqu’il s’agit d’une œuvre littéraire qui promet l’avant-goût de la Mort comme le roman de Céline, nous goûtons notre condition à travers cette duplicité apparente du particulier inerte, mais qui est pris dans l’organisation Une de la condition humaine : nous goûtons notre Mort mais ensemble.
Nous sommes alors seuls face à la responsabilité de notre style. Car ce qui est offert par Céline dans cette première phrase écrite est l’ultime du goût, lequel nous fait pluriel dans la solitude. En lisant « nous voici encore seuls », nous sommes conjugués ; notre goût subjugué est disséminé par la Mort dont nous goûtons à crédit l’avant-goût.
- Walter Benjamin, Œuvres III, « 4. Le conteur – réflexions sur l’œuvre de Nicolas Leskov », ed. Gallimard folio (2000), page 139 ↩︎
- Emerson, Société et solitude, ed. Rivages, page 24 ↩︎
- Ibid. page 19 ↩︎
- Nietzsche, Fragments posthumes, Automne 1885 – automne 1886, 2 [87], Gallimard, NRF, t. XII, Paris, 1978, p. 111 ↩︎
- Heidegger, Être et temps, §26 ed. Gallimard, page 160 ↩︎
- Heidegger, Être et Temps, §27 ed. Gallimard, page 126 ↩︎
- Arendt, Responsabilité et jugements, chap III, coll. Payot (2023), pages 146-147 ↩︎
- Céline, Lettres à la NRF, lettre à Jean Paulhan, 16 janvier 1950, page 76 ↩︎
