Mark Alizart: « Si je devais traduire L’Odyssée, je commencerais par l’appeler par son vrai nom : Le Grand Détraquement. »
(Propos recueillis par Mathias Moreau)
Résumer ici la carrière de Mark Alizart ne permettrait pas de saisir l’homme tant il semble être insaisissable. Passé par les grandes institutions culturelles françaises, de l’art contemporain à la mode ou au cinéma, Mark Alizart est avant tout un penseur. Auteur d’essais remarqués publiés aux P.U.F. dans la collection Perspectives Critiques, il révèle enfin à ses lecteurs un ouvrage qui dormait depuis trente ans. Astrologiques est un livre qui se dévore comme on pourrait imaginer Cronos dévorant ses enfants, car il autorise une chose que seule la pensée permet : une reconfiguration à 360 degrés de nos impressions propres. Mais plus que nos impressions, il s’agit avant tout de nos connaissances et ce que le temps a forgé comme certitudes. Usant du concept de l’astrologie dont les grecs étaient férus, Mark Alizart revisite le mythe d’Ulysse et son célèbre récit, redéfinissant par-là même ce que nous pensons savoir de cette épopée et de la civilisation grecque. L’Odyssée n’est pas qu’une simple histoire de héros nous dit Mark Alizart, elle nous parle d’autre chose, quelque chose que l’auteur ou les auteurs de L’Odyssée ont voulu dissimuler sous une épaisse couche d’aventures épiques. Avec une érudition formidable, l’essayiste nous livre une exégèse passionnante, renvoyant à la configuration des étoiles le mythe homérique et notre statut d’être pensant et ritualisé.
D’où vient l’idée d’écrire Astrologiques ? On croit comprendre que vous désirez vous inscrire dans une pensée qui a tenté d’escalader les mythes par un autre versant, je pense notamment à Jean-Pierre Vernant.
J’ai toujours été fasciné par la mythologie grecque, mais l’idée précise m’en est venue il y a trente ans, à l’occasion de mes études de philosophie. J’étais un avide lecteur des romantiques allemands qui avaient élaboré cette théorie selon laquelle le seul moyen de sortir de la crise de la modernité, qu’ils attribuaient, comme nous déjà, au rationalisme cartésien, au dualisme chrétien, et par extension à l’idéalisme platonicien, était de renouer avec la mémoire oubliée des temps présocratiques. Il m’a fallu beaucoup du temps cependant pour passer de cette « recherche de l’origine » au livre qui a été publié, en particulier le temps de comprendre ce qu’il y a de fantasmatique dans cette idée d’origine, voire de potentiellement toxique et réactionnaire. Bien sûr, la lecture démystifiante de l’Antiquité conduite par l’école française d’études grecques, Vernant, Veyne, Vidal Naquet, Détienne, Frontisi-Ducroux a été importante pour moi sur ce chemin, mais c’est surtout le livre Edna Leigh proposant une lecture archéoastronomique d’Homère qui a complètement réorienté mes recherches à partir de 2002, et donné naissance à ce qui a été publié.

Pouvez-vous nous présenter L’Odyssée, ouvrage que tout le monde connaît mais que peu ont lu ?
C’est l’histoire du retour d’Ulysse de la guerre de Troie, mais son récit se déroule sur très peu de jours, une douzaine, alors qu’on pense souvent qu’il inclue les différentes aventures qui lui arrivent (cyclopes, Circée, etc.) : celles-ci sont en fait racontées par Ulysse pendant son séjour chez les Phéaciens. C’est important parce que cela signifie que l’auteur de L’Odyssée a voulu lui donner une unité d’action et de lieu, c’est-à-dire une forme théâtrale. L’Odyssée n’est pas une épopée au sens de Gilgamesh ou des grands récits hindous. L’Odyssée était probablement jouée devant un public à l’occasion de moments privilégiés de la vie collective. L’hypothèse que je fais, après Edna Leigh et, tout récemment, Jean-Michel Ropars, est que ces moments coïncidaient avec des fêtes solsticiales et calendaires. Son action se déroule au moment du solstice d’hiver, fin décembre. Sa structure qui atteint son climax avec le massacre des prétendants, une grande scène grand-guignolesque d’une violence inouïe, tend à faire penser qu’elle avait une fonction cathartique semblable aux futures dionysies et autres mystères associés aux fêtes agraires qui sont devenus après les Saturnales romaines, les ancêtres des carnavals médiévaux. Ces fêtes avaient notamment pour but de tourner la page de l’année, d’en chasser les mauvais jours pour faire place à des jours plus propices, aux récoltes notamment.
On ne peut dissocier le mythe de la poésie et de l’organisation des sociétés et vous dites à juste titre, page 25, « aucune œuvre d’art ne peut faire l’économie d’une lecture politique. »
Absolument, et cela à deux titres au moins. Les mythes ont d’abord une fonction explicative. Ils offrent une interprétation à la fois proto-religieuse et proto-scientifique du monde, or cette interprétation est elle-même ancrée dans une structure sociale qui en oriente les conclusions. Les mythes fortifient donc une organisation sociale préexistante. Mais les mythes sont inséparables des rites qu’ils appellent. Il faut bien comprendre qu’ils ne constituent pas un savoir séparable d’une pratique. Ainsi, ils fabriquent aussi de la société. Si l’on admet par exemple que L’Odyssée est une tentative d’explication mythologique de la différence de douze jours entre les cycles lunaires et solaire qui se résout tous les dix-neuf ans – la durée du voyage d’Ulysse depuis son départ d’Ithaque – le rite qui en découle est l’ensemble des pratiques ascétiques pour participer à la résolution de cet écart.
Dans une note de bas de page, page 22, vous reprenez à votre compte une idée du préhistorien Julien D’Huy qui explique que l’Homme est indispensable à la bonne marche du monde et qu’il y a là l’exemple de l’utilité du mythe.
Oui. Le mythe prête des intentions à la nature et aux dieux, qui sont une projection de la représentation intentionnelle que les humains se font d’eux-mêmes. Si un malheur a lieu, c’est toujours que les dieux nous en veulent d’une chose. Le mythe, et particulièrement le rite, invitent donc toujours à une action de réparation, ce que j’appelle les pratiques ascétiques, qui implique un travail humain. Nietzsche a très bien expliqué tout cela, que nous comprenons encore mieux depuis Freud, et qui est maintenant une base de l’anthropologie.
Dans votre ouvrage, l’étymologie a une place très importante. Personnellement, j’en suis heureux car en remontant aux sources des mots on y trouve souvent une définition qui s’est perdue au fil du temps ou pire, qui a été galvaudée. Est-ce que l’étymologie – la recherche de la vérité – a créé le mythe ou est-ce le mythe qui donne toute son importance à l’étymologie ?
L’étymologie a été une des grandes passions de l’Antiquité. L’idée que les noms puissent être purement arbitraires est moderne. Là encore, l’intentionnalisme prévaut. On nomme les enfants à leur naissance en fonction d’un événement qui s’est passé le jour ou la semaine où ils viennent au monde. On nomme les guerriers après un exploit ou une vertu qui les caractérise. On nomme les lieux en fonction d’une forme qui les désigne. Mais le langage est plein de mots étrangers ou dégradés par le temps, dont le sens ne se donne pas à comprendre de prime abord. C’est notamment le cas du nom des dieux, qui sont souvent mésopotamiens, crétois, égyptiens, et aussi des héros mycéniens, par exemple Agamemnon, qui n’a pas de sens évident. L’étymologie consiste à essayer de retrouver le sens de ces noms, sachant que ce travail va permettre de définir le rite qui permettra le mieux de leur faire honneur, mais aussi d’écrire parfois toute une histoire qui servira à les inscrire dans le panthéon existant. Le nom disent certains hellénistes est génératif : certains mythes ne sont qu’une tentative d’expliquer une racine étrange (ou bien la racine elle-même, quand elle n’est pas sûre, est choisie parmi plusieurs possibles, pour augmenter un mythe existant). Par exemple Œdipe : à la fois « Pied (Pous) bot (Oidi) » et « Qui sait (Oida) ce qu’il en est des pieds (Pous) », qui devient l’homme qui a la réponse à la question de la Sphinge portant sur l’usage des pieds. Porter son nom dans l’Antiquité se comprend au sens propre : ce peut aussi être un fardeau. La vie d’un individu consiste à « réaliser » ce que son nom lui promet. Ainsi, Vernant a-t-il écrit avec justesse que la tragédie grecque se comprend comme le processus par lequel un héros va en venir à découvrir le sens du nom qu’il porte.
Vous donnez beaucoup d’importance à la traduction des prénoms des protagonistes de L’Odyssée ce qui donne à ce moment de votre livre, l’impression d’une déconstruction féroce quant à la réception classique que l’on peut faire à la lecture du récit d’Homère. Par exemple, Ulysse est « l’irritant », « l’odieux » plutôt que « l’affligé » ou « le peiné ».
Oui, le nom d’Ulysse fait typiquement partie de ces noms problématiques. Il ne semble pas que ce soit un nom grec. Homère en propose d’ailleurs lui-même une étymologie : Odysseus viendrait d’Odyssamenos, un mot assez rare dont une des significations est « irriter », mais cette étymologie obscurcit son mystère davantage qu’il ne l’éclaire. Faut-il la comprendre au sens passif, « Celui qui est irrité (qui est affligé) » ? ou au sens actif : « Celui qui irrite » ? Il est clair qu’il a irrité Poséidon, mais Zeus se défend d’être irrité par lui. Il vante même ses qualités. Par ailleurs, s’il a irrité Poséidon, ce n’est pas sa faute : il n’a fait que se défendre de la violence gratuite de son fils Polyphème. Enfin, si ce nom peut faire sens dans le cadre de L’Odyssée, il n’en a aucun dans celui de L’Iliade, où Ulysse n’irrite personne. C’est pourquoi je propose une autre traduction : « Celui qui tracasse, qui détraque ». Dans ce mot, on retrouve la notion d’irritation, mais elle se colore de deux manières supplémentaires qui fonctionnent dans les deux textes : « déstabiliser l’adversaire par la ruse », la métis bien connue d’Ulysse (le cheval de Troie dans L’Iliade), et « faire dévier de son chemin », son trek (track en anglais, trac en ancien français). Cette dernière signification s’entend d’ailleurs bien dans le nom grec d’Ulysse : Odos (« chemin »), Odeusimos (« cheminer »). Si Vernant a raison, la tragédie d’Ulysse vient de ce qu’il est forcé de porter son nom en perdant son chemin après avoir fait perdre celui des autres. Par ailleurs, cette étymologie fonctionne aussi très bien avec l’interprétation archéoastronomique : Ulysse étant la lune, il est à la fois détraqué par rapport au soleil, et il détraque les humains (à la pleine lune par exemple). C’est aussi le but de son épiclèse, polytropos au premier vers du texte, que de le souligner : polytropos est communément traduit par « l’homme aux mille tours », « Celui qui se tourne en tous sens », comme le poulpe, mais le mot désigne quelque chose de plus précis dans ce cas : « Celui qui est sens dessus dessous », « qui marche à l’endroit et à l’envers », « qui avance de biais » comme le crabe ou l’écrevisse, l’animal associé à la lune depuis toujours, le signe du Cancer (qu’on retrouve par exemple dans la carte du tarot de la Lune). J’aime aussi que Hamlet, qui a beaucoup de points communs avec Ulysse, soit l’homme du détraquement, et spécialement du temps, comme Ulysse est le témoin du détraquement du calendrier lunisolaire (« The time is out of joint »). Bref, il y a une tradition continue en faveur de cette étymologie. Si je devais traduire L’Odyssée, je commencerais ainsi par l’appeler par son vrai nom : Le Grand Détraquement.
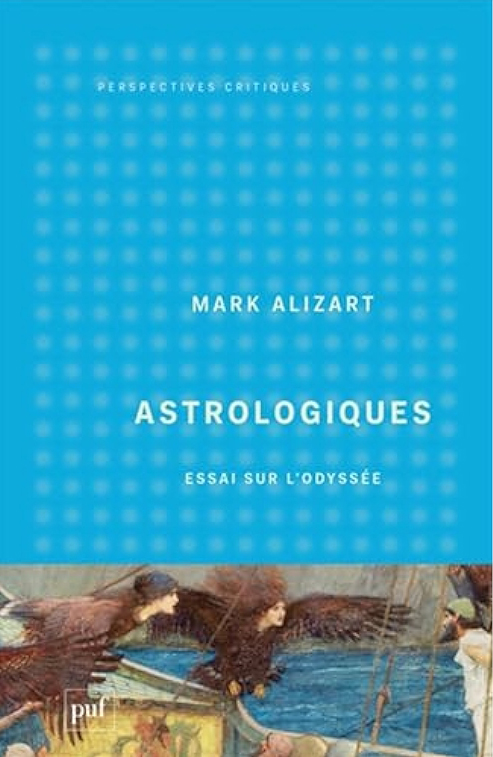
Une question qui m’intéresse beaucoup est cette accointance entre l’histoire religieuse grecque et celle juive et chrétienne. Ce parallèle, me semble-t-il, n’est pas assez exploité. En quoi pourrait-il expliquer la naissance des religions de tout ordre ? Quelle chronologie peut-on tirer des textes religieux quant à leur invention ?
C’est une affaire compliquée parce qu’elle a donné à pas mal de théories farfelues à partir de la fin du dix-huitième siècle sur l’existence d’une religion unique notamment égyptienne, ou d’un emboîtement du christianisme dans la mythologie grecque via des figures souffrantes comme Dionysos ou Œdipe. Nietzsche partage assez cet avis. William Marx en parle bien dans Le Tombeau d’Œdipe. Il est certain qu’il y a des éléments religieux qui ont circulé à l’occasion d’échanges commerciaux. On sait que le chamanisme, qui a possiblement été la première religion de l’humanité, se retrouve dans de nombreuses cultures. Le bassin mésopotamien a aussi été un creuset, depuis Sumer, pour des peuples sémitiques et proto-helléniques. Gilgamesh et L’Odyssée partagent des points communs : la quête de l’immortalité, qu’Ulysse trouve chez Calypso, l’herbe de jouvence, le moly, qu’Hermès lui confie avant de rencontrer Circé, le sage de la mer, etc. On peut aussi faire des ponts avec le monde hébraïque : Moïse est aussi un homme des eaux, de son abandon sur le Nil au Jourdain. Le jour du Grand Pardon fait suite à un jour du Grand détraquement, etc. Enfin, il y a incontestablement des aspects proto-chrétiens chez Ulysse, qui ne se limite pas au topos de la visite des Enfers, qui est en fait de nature astrologique (toutes les planètes et leurs dieux ou leurs héros associés visitent les Enfers, dès lors qu’elles disparaissent en passant de l’autre côté de la terre). Ce qui est proprement chrétien chez lui c’est la qualité thaumaturgique que lui confère son statut de trickster, de bouffon rusé. Ulysse rétablit l’ordre dans son royaume détraqué en le détraquant encore davantage. De même le Christ fait l’objet d’un ludibrium, une cérémonie romaine visant à en faire une figure de foire. C’est en tant que « roi des fous » qu’il sauve vraiment le monde. Mais c’est vrai qu’il est difficile d’en dire plus. On ne pourra jamais dire s’il y a là de simples coïncidences, des corrélations ou une causation.
