Laurent de Sutter : « L’ivresse marque l’apparition de l’obscur au lieu du clair. »
(propos recueillis par Julie Konieczny)
.
S’il avait besoin de nous, on offrirait volontiers à Laurent de Sutter un galion armé de canonniers et une carte de navigation pour parcourir les mers et les îles encore verrouillées par le conformisme ou le prêt-à-penser. Mais fort d’une vingtaine d’ouvrages et de son poste de directeur de publication aux PUF, l’auteur de Jack Sparrow, manifeste pour une linguistique pirate1 ou Pour en finir avec soi-même2 n’a pas besoin de Global Positioning System. Il fait paraître ce mois de mai le très cinégénique L’Art de l’Ivresse, dans la collection Perspectives Critiques, ouvrage dont les effets secondaires sont plus que souhaitables. Dans cet entretien, il fait pivoter une fois de plus les axes conceptuels traditionnels et revendique de ne pas s’en tenir à une entreprise d’explosion pour cultiver, avec une élégance évidente, la poétique; peut être celle que l’ivresse, seule et débordant les barrages policiers, rend absolument possible.
1/ Chose qui mérite, en particulier, d’être soulignée c’est le caractère universel et transversal de votre analyse. Historique, culturelle et géographique, certes, mais j’y vois aussi une approche « souterraine », « rhizomique » si j’osais le terme. Surtout, vous occupez tous les terrains d’abordage philosophique et le livre se construit avec souplesse sur des tableaux personnifiés : Éthique, Esthétique, Épistémologique, Politique, Ontologique. Avez-vous eu le souci de convaincre – et si oui qui – de la légitimité strictement philosophique de votre sujet ?
Vous avez raison. L’architecture de L’art de l’ivresse est une architecture qui répond à deux logiques croisées : celle de la multiplication des points de vue, et celle de la diversité des conséquences. Cela fait longtemps, à présent, que mon travail a excédé les frontières restreintes de la pensée occidentale, en particulier moderne. Dès mes premiers livres, une présence japonaise, chinoise, indienne ou arabe s’est insérée dans mon écriture et ma pensée, pour mettre en difficulté, par la pratique, le réflexe, que nous continuons à nourrir, d’imaginer que le pensable se limite à celui de l’Europe conçue au sens large. Il n’y a pas de pensée européenne qui tienne, pour moi ; il n’y a que la pensée, tout court, quelle qu’en soit la source, l’origine, la langue ou même le public. C’est d’autant plus vrai pour un sujet tel que celui de l’ivresse, dont les historiens ont pu montrer qu’il traversait toute l’histoire de l’humanité, même (et peut-être surtout) là où il a été censuré. Dans le cas de L’art de l’ivresse, il faut rajouter que cet attachement à la multiplicité des savoirs est aussi une manière d’établir une continuité stricte avec un des livres dont il constitue la suite : Métaphysique de la putain – où le Japon, par exemple, jouait déjà un rôle important. Quant au second point : donner une légitimité, quelle qu’elle soit, à ce dont je parle ne fait pas partie de mes préoccupations – tout simplement parce que je pense que la légitimité est toujours un faux problème. Dans un livre qui devrait paraître l’an prochain, Théorie du plouc, je traite justement de cette question – et de ses liens insécables avec la tradition politico-juridique de l’Occident, obsédée par le fondement et la garantie. Il est vrai, là aussi, que la pensée occidentale n’a cessé d’accompagner cette tradition en forgeant les instruments intellectuels permettant sa survie. Peut-être est-ce pour cela que mon approche, comme j’ai pu le souligner à de nombreuses reprises par le passé, n’est pas tant philosophique qu’antiphilosophique – c’est-à-dire opposée à la collaboration essentielle que la philosophie a toujours nourrie avec la police du pouvoir et de la loi (disons : de Platon à Habermas ou à la philosophie analytique contemporaine). Mon problème n’est donc pas tant celui de la légitimité (rien n’est légitime, jamais, et c’est très bien ainsi) que celui de la conséquence : que faire de l’ivresse – ou plutôt : comment décrire ce qu’en effet l’ivresse fait à une tradition qui, en réalité, s’est construite contre elle, au nom de la valorisation supérieure de la sobriété ? Comment le décrire, c’est-à-dire comment le penser ?
2/En quoi le terme « art » vous semble-t-il le plus approprié au sujet de l’ivresse ?
Disons qu’il y a deux manières possibles d’expliquer le recours au mot « art », dans le titre de ce livre. La première, comment souvent dans mon travail, est celle de l’ironie ou de la distance – « art » devant être lu comme entre guillemets ou comme relevant de l’antiphrase. L’art, ce n’est jamais très glorieux. La seconde, de ce qu’avec l’art c’est bien toujours d’un « faire » dont il est question – disons, d’une « poesis », d’une poétique au sens de la constitution possible d’usages (j’en ai souvent parlé avec mon ami Pierre Vinclair, qui soutient que ma pensée est, au fond, une approximation de ce que la poésie réalise). Lorsque j’utilise le mot « art », c’est donc à l’intérieur de l’interprétation des développements contemporains en matière d’art que j’ai pu exposer dans Striptease ou bien dans Pornographie du contemporain. Je ne considère par l’art comme une pratique propre, ou comme le référent d’une histoire prestigieuse (et, là encore, trop souvent limitée à la tradition européenne et à ses extensions), mais comme ce qui naît de l’abandon possible de la modernité critique – à savoir de la logique du jugement et du goût. L’art de l’ivresse aurait pu porter le titre de Poétique de l’ivresse ou même de Postcritique de l’ivresse – mais il y avait dans le mot « art » un appel ou une nécessité plus urgente : que l’ivresse s’adresse à l’art lui-même pour le déplacer du lieu de sa « légitimité » admise, pour reprendre votre mot.

3/L’ivresse serait-elle l’art du dévoilement ? Du vrai qui, caché, doit excéder pour apparaître ? Comment faut-il comprendre que « La vérité est toujours ivre » ?
Eh bien, je dirais que l’ivresse marque l’apparition de l’obscur au lieu du clair. C’est-à-dire que, comme le pensaient déjà les Arabes au début du Moyen-Âge lorsqu’ils parlaient de khamr, l’ivresse marque le lieu où, de se voiler, de se flouter ou de s’obscurcir, ce qui apparaît peut prendre enfin sa vertu propre. Cette vertu, toutefois, n’est pas celle de la « vérité » au sens traditionnel, philosophique, du terme. A nouveau, la « vérité » dont il est question est une vérité ironique ou impossible – une vérité qui est en réalité son contraire : l’affirmation rétrospective de ce qu’est vrai ce qui a eu lieu ou ce qui a été produit. Pour le dire de manière plus simple : les conneries qu’on fait lorsqu’on est bourrés sont tout ce qu’il y à savoir du vrai – de sorte que n’est vrai que ce qui en a résulté. Il n’y a pas de vérité qui pourrait se débarrasser du voile ou de l’obscur ; il n’y a pas de vérité qui pourrait apparaître dans la splendeur illuminée de la scène du monde. Cela, il faut le laisser aux amateurs de rock. Mais qu’il n’y ait pas de vérité qui puisse apparaître, nue, débarrassée des oripeaux de l’erreur, de la faute ou du mensonge, implique qu’il y ait tout de même une vérité – qui est celle-là même. Il n’y a de vérité que de son absence, si vous voulez. Et l’ivresse est ce qui permet d’embrasser cette absence – ou, du moins, ce qui, observé depuis l’extérieur, permet de comprendre qu’il existe quelque chose comme une absence de vérité à embrasser. En disant cela, toutefois, je ne cherche pas tant à aligner les paradoxes ou à pointer du doigt la possibilité d’une sorte de mystique négative du vrai (même si j’aime beaucoup les penseurs, par exemple Japonais (je pense bien sûr à Nishida Kitarô, à Nishitani Keiji, à Yamauchi Tokuryû), qui semblent suivre cette direction). Ce qui m’intéresse, c’est, par le recours à l’ivresse, de nous offrir une possibilité de penser (par exemple, la vérité) qui ne soit pas prédiquée par les valeurs que l’on y attache d’habitude. Ce que je souhaite, c’est dévaloriser la vérité pour mieux la valoriser.
Je ne crois pas une seule seconde à la pensée sobre, mesurée, nuancée – pas plus qu’à l’exactitude, à la mathématisation, à la statistique.
4/Est-il juste de déduire de votre analyse que si l’ivresse est pensée c’est, pour trouver un raccourci, afin de décrire comment Penser c’est toujours déjà être ivre ?
Je le pense, oui. Je pense qu’il n’y a de pensée qu’en état plus ou moins maîtrisé de délire. Je ne crois pas une seule seconde à la pensée sobre, mesurée, nuancée – pas plus qu’à l’exactitude, à la mathématisation, à la statistique. Il me semble que la pensée est toujours foireuse – et que cette dimension foireuse est ce que l’ivresse, d’une certaine manière, incarne. Penser, à mes yeux, tient d’un bricolage qui n’a de sens que pour autant que cela nous aide à dégager du marécage des idées ce qui ne s’y trouvait pas. Pour utiliser un mot qui fait florès ces temps-ci : penser tient pour l’essentiel à formuler des possibles. Mais une contrainte forte pèse sur une telle formulation : que ces possibles tiennent de l’impossible – c’est-à-dire qu’ils se dressent contre la division du possible et de l’impossible par lequel la réalité, cette fiction comptable, est policée. C’est-à-dire qu’on ne peut penser que l’impensable. Toute autre forme de pensée, par conséquent, tient de manière nécessaire de la tautologie ou de la leçon (et souvent, les deux). Nous avons besoin d’une pensée ivre, parce qu’il n’y en a pas d’autre – ivre, donc titubante, imprécise, à côté de la plaque, allant là où il ne faudrait pas aller, inconsciente de ses limites, etc. Partout où l’on vous dit : vous n’y pensez pas ! Quelle extravagance ! C’est impossible !, vous saurez avec une sûreté absolu que c’est là qu’il faut aller. Par exemple : tenter de penser l’ivresse pour parvenir à faire penser l’ivresse de la pensée.
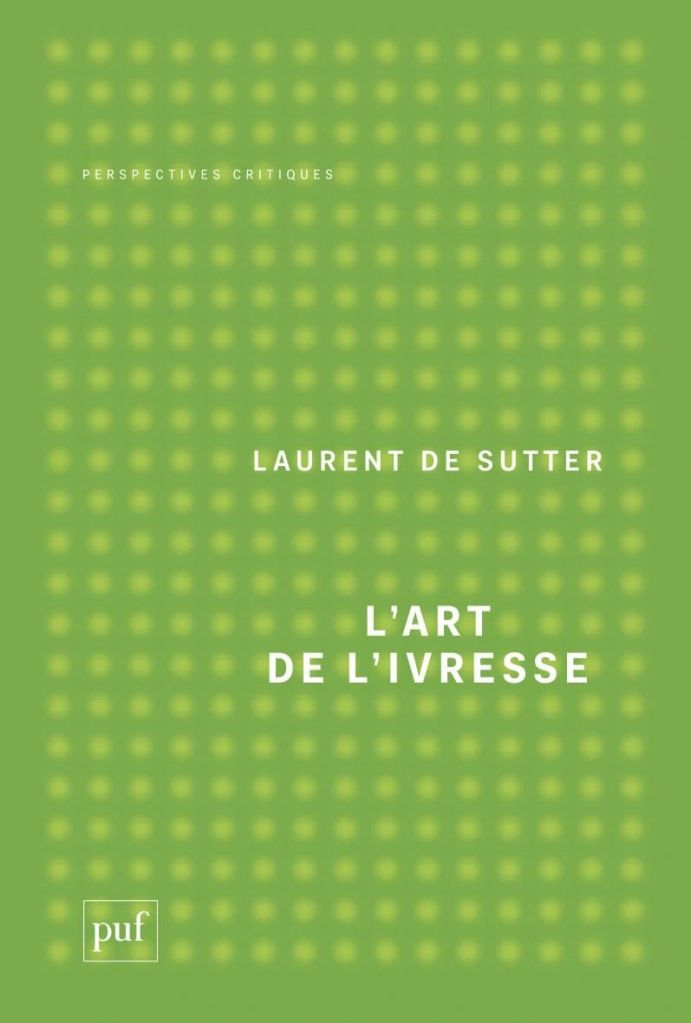
5/Vous revendiquez, me semble-t-il, le dynamisme de l’ivresse et votre ouvrage décrit des personnages emblématiques et réflexifs, qui ne sont pas anesthésiés par la boisson puisqu’ils activent le dialogue, dialogue intersubjectif ou dialogue métaphysique. Pourquoi la moralité et une certaine modernité semblent au contraire condamner l’ivresse ?
L’art de l’ivresse n’est pas seulement une suite de ma Métaphysique de la putain (suite réclamée, à l’époque, par l’éditeur italien de ce livre, Gino Giometti, hélas décédé depuis) ; il est aussi une réponse à mon L’âge de l’anesthésie. Dans ce livre, qui parle des liens qui existent entre capitalisme, anesthésie et médicaments et drogues, je ne disais pas un mot de l’alcool – de sorte que certains se sont interrogés sur cette absence. De fait, l’alcool est une substance qui se situe sur une sorte de ligne de crête : d’un côté, dans sa forme industrielle, il appartient au domaine des psychotropes par lesquels le capitalisme industriel travaille à l’anesthésie du contemporain ; mais, d’un autre, il est ce qui a toujours (disons : au moins depuis avant la révolution néolithique) ce qui a travaillé à la constitution de communautés ne cessant de se dépasser. L’anesthésie alcoolique, en effet, est d’abord l’anesthésie de ce qui nous rend asociaux – en l’occurrence, l’anesthésie du cortex préfrontal, siège de la volonté rationnelle et égoïste, qui fait de nous des primates individualistes, opportunistes et agressifs (s’il faut en croire les spécialistes). C’est-à-dire qu’il y a une amphibolie de l’alcool – une anesthésie productive qui peut devenir une anesthésie de capture : une anesthésie qui, par un paradoxe, nous fait sortir de nous-mêmes, et une anesthésie qui ne cesse de nous y ramener pour nous enchaîner à notre personne, donc à notre place. C’est ce déchaînement possible de l’ivresse, l’excitation fondamentale, anti-ontologique dans son efficace, qui la traverse jusqu’au cœur de l’anesthésie, qui a toujours effrayé les pouvoirs, dans le même temps où ils en tiraient d’abondantes ressources financières. En promouvant une conception sobre du vrai, du beau, du bien, du pensable et donc de l’être, la philosophie a accompagné ce mouvement – puis, après elle, la plupart des sciences humaines (à commencer par la psychologie, la sociologie et la criminologie pour lesquelles l’ « excitation », au 19ème siècle, constituait le pire des dangers). Aujourd’hui, heureusement, le vent semble tourner – et certains historiens paraissent vouloir redonner à l’ivresse son statut à l’intérieur de l’évolution de l’histoire humaine. Je ne fais que les accompagner.
6/La fermentation, sauf erreur de ma part n’est pas un terme cité et pourtant on a du mal à croire que vous n’y ayez pas fait fructifier votre réflexion ! Quel est le privilège du vin, s’il existe, dans votre propre méthode de travail ?
C’est vrai. Je ne cite la question de la fermentation qu’en passant – lorsque je dis que, dans l’islam, l’interdit frappant le khamr est un interdit frappant les « boissons fermentées », tandis que c’est aussi contre celles-ci que se dressent certaines franges du confucianisme, du taoïsme ou du bouddhisme. J’aurais sans doute dû y prêter plus d’attention, d’autant qu’avant l’apparition de la distillation à des fins de bouche, au crépuscule du Moyen-Âge, les boissons alcoolisées ne relevaient que de la fermentation : bière, vin, cidre, pulque, etc. Si je devais hasarder une thèse, je dirais que la fermentation constitue le modèle de ce que deviendra la distillation, à l’époque où Rabelais et les alchimistes s’y intéressaient : une manière de transmutation en vue d’exprimer la vis (la « force » ou la « puissance », la « vertu ») d’une substance. En passant d’un état à un autre, la matière qui fermente ajoute quelque chose à elle-même, suivant un mouvement de création ou de génération qui renvoie à la vis fondamentale du monde – c’est-à-dire, pour les alchimistes, de Dieu. La fermentation, c’est la Création qui continue, en quelque sorte. Donc, c’est aussi la métamorphose, la transformation – l’appel du dehors qui fait sortir du grain, du raisin, de la canne à sucre, etc., quelque chose qui est à la fois identique et plus vaste. A nouveau, c’est ce qu’ont pu montrer, de manière très concrète, les paléoanthropologues qui se sont intéressés aux premiers sites présentant des témoignages de pratiques de fermentation – qui étaient, à l’origine, des pratiques de fermentation alcoolique (c’est l’hypothèse dite « beer before bread » qui a cours aujourd’hui dans cette discipline). Assimiler une boisson fermentée, c’est assimiler sa transformation « vertueuse » pour s’en approprier la « vertu » et se transformer à son tour – et devenir autre chose (même si c’est au travers d’une idiotie d’ivrogne). Aujourd’hui, à la suite d’une longue histoire nourrie par un lobby industriel considérable (surtout depuis la 2ème Guerre Mondiale), le vin bénéficie d’un privilège de distinction en la matière – mais, en réalité, il ne se distingue en rien, de ce point de vue, des autres types de boissons fermentées. Il n’en reste pas moins que c’est bien la fréquentation du vin (et des cocktails) qui m’a donné envie de le dire.
Partout où l’on vous dit : vous n’y pensez pas ! Quelle extravagance ! C’est impossible !, vous saurez avec une sûreté absolu que c’est là qu’il faut aller.
7/Quels seraient, selon vous, les philosophes qui, sans en avoir effectivement abordé les rivages, ont le mieux approché, envisagé l’ivresse ? Les penseurs de la joie ? Sans doute pas Descartes qui valorisait une joie qui ne s’obtient pas au prix de la lucidité …
Je crains qu’il n’y en ait pas beaucoup. On pourrait citer quelques noms un peu attendus : Gilles Deleuze, Clément Rosset, Jean-Luc Nancy, plus près de nous Valentin Husson, dont L’art des vivres, que j’ai publié dans ma collection aux PUF, embrasse l’ivresse avec gourmandise – mais certainement pas Friedrich Nietzsche, par exemple, pourtant souvent considéré comme un penseur de l’ivresse. Pour l’essentiel, la tradition philosophique est sèche. Il n’en va pas de même des penseurs chinois ou japonais, en revanche, qui, à la manière des poètes de la tradition, ont beaucoup médité sur la « coupe de vin » (il y a des pages formidables d’Urabe Kenkô ou Kamô no Chômei sur le sujet, par exemple). Pierre-Yves Quiviger, dans un beau livre récent, a pu proposer une sorte de tour de table de la philosophie occidentale du vin. Même lui a dû conclure à la grande pauvreté de la pensée européenne en matière de vin et de boisson. Cependant, il est possible de relire l’histoire de la pensée depuis une conception moins littérale de l’ivresse – une conception plus proche du délire dont je parlais tout à l’heure. De ce point de vue, on pourrait considérer, par exemple, que les présocratiques ou les sophistes, les théologiens médiévaux, les fabricants de systèmes fous comme Hegel, les grandes figures de la théorie française des années 1960-1970, ou bien les défenseurs contemporains du réalisme spéculatif, du Weird Realism, du Dark Vitalism, de l’accélérationnisme, etc., tiennent de l’ivresse. Le rationalisme d’Alexandre Kojève, par exemple, est un rationalisme tout sauf sobre. De mon point de vue, l’ivresse tient du mode de pensée – un mode de pensée qui se nourrit du dehors pour fabriquer un dehors, suivant un mouvement qui est de transfert autant que de transformation. L’ivresse est ce qui circule dans la pensée et qui, circulant dans la pensée, la fait circuler elle-même. C’est pour cela qu’elle ne se repère par nécessairement chez les penseurs et penseuses les plus ivrognes.
8/Assumer en conclusion « l’effondrement ontologique » résonne, il me semble comme une provocation à l’heure où chacun revendique, au contraire, la dignité, le statut, la reconnaissance, l’identité. Est-ce qu’on peut voir, avec ce dernier chapitre, le privilège d’une réflexion philosophique sur le sujet ? C’est à dire la liberté de cette discipline à assumer quelque chose d’extra-moral, de « désastreux » ?
Sans doute, oui. Du moins, si on enlève la « philosophie » de l’équation. Au risque de me répéter, je ne pense pas que la philosophie dispose du moindre titre à prétendre constituer le dernier mot en matière de pensée. Je crois au contraire, avec Deleuze, que toutes les pratiques pensent (que toutes, comme il le disait, ont une « Idée ») ; il suffit d’écouter – et d’écouter en particulier ce que cette pensée fait faire à celles et ceux qui la pensent. Le désastre que vous évoquez commence, à mon avis, par être (ou devoir être, peut-être) le désastre de la philosophie avant de devenir le désastre, donc le désêtre, du reste. Il faut tout désastrer : tel pourrait être l’impératif catégorique de ma pensée, si j’acceptais l’idée d’impératif catégorique (ou d’impératif tout court). Vous avez raison de souligner que cela implique de prendre au sérieux un certain nombre de conséquences possibles d’un tel désastre du point de vue du contemporain. Dans Pour en finir avec soi-même je m’étais intéressé à l’identité, dans Éloge du danger à la sécurité et au safe, dans Décevoir est un plaisir à l’espoir et à l’attente, et dans Théorie du plouc je m’intéresse à la reconnaissance (sans parler du sort que je réserve à la « critique » dans Superfaible). Si je « désastre » ces différentes catégories, ce n’est bien sûr pas pour le plaisir du jeu de massacre – ni pour donner des armes aux merdeux dont parlait Williams Burroughs pour mieux battre ce qui survit encore de désir d’émancipation dans notre monde. C’est au contraire parce que je pense que ce sont précisément les armes des merdeux – et que les utiliser dans la lutte contre la police des corps et des esprits ne peut que se retourner contre celles et ceux qui les utilisent. Il s’agit de concepts désignés par la tradition philosophique qu’il s’agit de reléguer aux oubliettes. Il faut donc les reléguer aux oubliettes aussi.
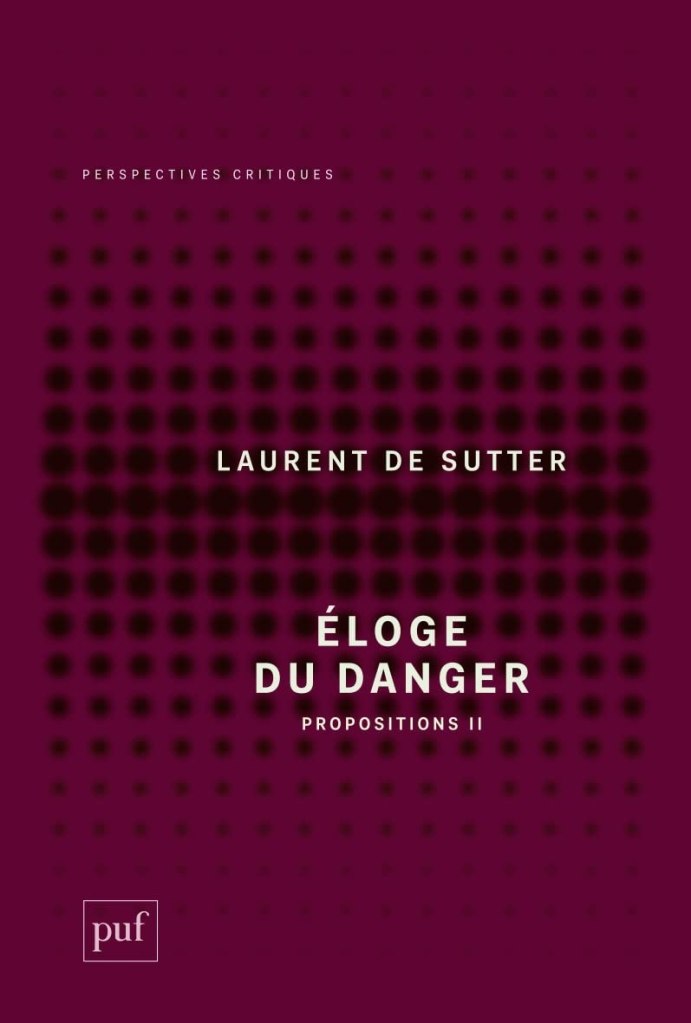


- Jack Sparrow : Manifeste pour une linguistique pirate, Impressions nouvelles, La Fabrique Des Heros, 2019 ↩︎
- Pour en finir avec soi-même, Perspectives critiques, PUF, 2021 ↩︎
