Amor fati : se vouloir soi-même. Nietzsche, précurseur de la psychanalyse
(Valentin Husson)

Amor fati, l’amour du destin. Voilà la formule par laquelle, Nietzsche, désigne, dans Ecce Homo, « la grandeur dans l’homme » (« Ma formule pour désigner la grandeur dans l’homme, c’est l’amor fati » (EH, II, § 10)1. Il s’agirait au fond d’embrasser sa nécessité, de dire « oui » même à sa souffrance et à sa maladie. La grande santé est à ce prix : celle-ci n’est pas l’absence de troubles, mais la manière, dont même atteinte, affecté ou fragilisé, le surhumain s’affirme et s’interprète en embellissant la vie. Ce qu’on aimerait proposer comme hypothèse est que cet amor fati recouvre l’enjeu d’une cure analytique. Il en est son but, le signe qu’une analyse a réussi. Il ne s’agit pas, en analyse, de devenir un autre, mais d’accepter celui qu’on est ; d’accepter ses symptômes, ses répétitions, son éternel retour. Ce qui n’est pas une stagnation, mais la chance offerte d’un déplacement : non pas l’éternel retour du même, mais le retour du même dans la différence. Les grandes révolutions se tiennent dans le déplacement d’une virgule.
Cette différence est de l’ordre d’une création. L’analysant ne cherche pas à faire peau neuve, à laisser derrière lui l’exuvie de sa mue, mais à prendre le réel tout entier, avec ses manquements, ses échecs, ses ratés. Nulle guérison n’est promise, ni par le philosophe-médecin, ni par le psychanalyste, tout juste peut-on comprendre, c’est-à-dire prendre avec soi ses symptômes, et les transmuer en force. La grande santé est l’affirmation créative de la vie troublée. La transvaluation nietzschéenne prend l’entièreté de son sens dans une analyse : étant entendu que les valeurs dont parle Nietzsche sont des forces plus que des qualités morales ou politiques. La transvaluation désigne en ce sens la capacité de réévaluer son passé, de faire de ses faiblesses, des forces. Puisque tout ce qui ne tue pas rend plus fort, et que toute maladie peut être le ferment de l’affirmation d’une grande santé.
Il n’y a pas de négativité pure chez Nietzsche, tout négatif est du positif réfréné ou en devenir. Les trois métamorphoses – le chameau, le lion, l’enfant – proposent l’image de ce devenir positif de l’humain. On connaît le propos de Freud, disant que l’inconscient ne connaît pas la négation ni le temps. Cela indique que cette positivité de la parole inconsciente – parlant avec droiture et vérité dans le lapsus, le rêve, le symptôme ou l’acte manqué – doit être accueillie sans résistance. La résistance est l’élément négatif de toute analyse : seul l’analysant qui fait tomber toutes ses défenses psychiques peut s’accueillir comme sujet non plus écrit par l’inconscient, mais comme auteur de sa vie. Demandez à quelqu’un ce qu’il croit être : il vous livrera le roman qu’il aurait aimé qu’on écrive sur lui. On pense être l’auteur de sa vie, on en est le personnage. On pense écrire sa vie, on est avant tout écrit. Sans analyse, nous ne sommes rien de plus – ainsi que le disait Nietzsche – « que le comédien de notre propre idéal ».
L’enjeu de la cure analytique est, en cela, celui d’un déplacement de perspective et d’interprétation. L’analysant est celui qui, comme Nietzsche, peut dire – je cite le Gai savoir (§276) – : « je serai ainsi l’un de ceux qui embellissent les choses »2. Il n’y a pas de faits tout faits, juste des interprétations de faits. Et le plus souvent, l’analyse nous apprend que les mots pour nous dire, pour dire nos souvenirs, ne sont jamais neutres mais chargés d’histoire. Un traumatisme cesse d’être un traumatisme, quand nous pouvons le remobiliser comme un souvenir qui a fait partie de notre vie, et quand la remémoration n’engage plus de reviviscence. En cela, la figure du philosophe-médecin ne prescrit nul traitement médicamenteux : on ne soigne pas avec des potions ou des drogues, mais avec des mots. Il y a, naturellement, dans cet amor fati un héritage tout stoïcien : le sage est celui qui éduque son jugement sur les choses. Les choses étant inéluctables, ce sont nos opinions qui doivent se régler sur elles pour n’avoir point à en souffrir. Je cite Epictète dans le Manuel : « Ce qui tourmente les hommes, ce n’est pas la réalité (les choses, ta pragmata) mais les opinions (les jugements, ta dogmata) qu’ils s’en font. » (Manuel, V). (Ou encore, dans les Entretiens : « Nous sommes maîtres de juger ou de ne pas juger (doxai), et non des choses extérieures. » (Entretiens, I, 11, 37).) Le jugement des stoïciens correspond à l’interprétation embellissante de Nietzsche, et à l’effort de déplacement de l’analysant (que Lacan appelait, on le verra, la ponctuation du sujet). Toute la sagesse du stoïcisme, du nietzschéisme ou de la psychanalyse consiste en une résignation heureuse au réel. Résignation heureuse au réel qu’Épictète disait ainsi : « N’attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites ; décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Il s’agit de désirer le fatum ; d’aimer, fatalement, celui que je suis ; de se vouloir soi-même.
Tous les ressorts de la cure analytique sont là. La psychanalyse ne cherche pas à nous faire devenir un autre que soi ; tout juste peut-elle nous apprendre, ainsi que Freud le disait, à devenir « autrement soi-même ». Le « Deviens ce que tu es » fait écho au « Wo Es war, soll Ich werden ». Cette phrase de Freud pourrait se traduire ainsi : « là où Ça (ça, quoi ?, le souvenir, le trauma, le passé) était, je dois devenir.» Au fond, la pensée nietzschéenne a ceci de commun avec la psychanalyse qu’elle engage une réalisation de soi, c’est-à-dire une capacité à s’accepter tel qu’en soi-même. Lacan le dit ainsi : « Ce qui se réalise dans mon histoire, n’est pas le passé défini de ce qui fut puisqu’il n’est plus, ni même le parfait de ce qui a été dans ce que je suis, mais le futur antérieur de ce que j’aurai été pour ce que je suis en train de devenir3.» Non pas, je dois devenir celui que j’aurai dû être ; mais j’ai à devenir celui que je veux être en vertu celui que j’aurai été. Le « devenir » ou « l’advenir » de Soi n’est pas la production d’un changement, mais une acceptation de ce qui m’est arrivé afin de m’arriver pleinement à moi-même.
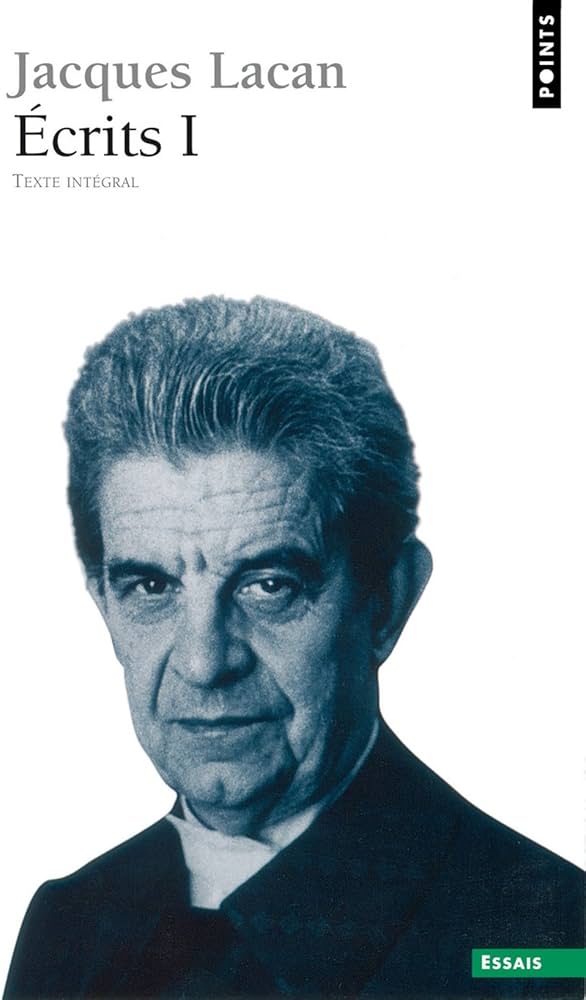
Ce que peut offrir une analyse, ce n’est pas une guérison de nos symptômes, mais l’acceptation de ceux-ci par leur compréhension généalogique.
L’éternel retour nietzschéen peut être compris à l’aune de la répétition freudienne. Ainsi que je l’annonçais en introduction, la répétition – pour l’analysant en cure – ne doit pas conduire à l’éternel retour du même, mais à l’éternel retour du même dans la différence. Là où le déplacement est un différemment me faisant advenir à soi différemment. Se vouloir soi, ce n’est pas vouloir rester le même, c’est se vouloir soi-même meilleur, ou, – comme on dit aujourd’hui – c’est vouloir devenir la meilleure version de soi. Tout peut bien revenir et se répéter, cette répétition ne doit pas être morne, identique, bien plutôt doit-elle déplacer quelque chose, faire bifurquer, créer un renouvellement. L’identité de ce devenir est l’identité de l’identique et de la différence. La vie est répétition : on répète une fois, on répète à nouveau, jusqu’au jour où l’on répète du nouveau – c’est- à-dire un renouveau. On ne fait jamais table rase du passé. Notre passé est un passif, et ce passif doit être déchargé de sa charge culpabilisante (le psychanalyste est l’inverse du prêtre!), être un passage vers un au-delà, un dépassement de soi. Que notre schéma d’existence se reproduise, c’est une chose !, mais ce qui fait retour doit nous revenir dans une réplique plus vive, plus intense. Tout progrès en analyse vient de ce déplacement infinitésimal, comparable au changement d’une virgule, à la modification d’un signe de ponctuation. Soit, ici, celui d’un point d’exclamation ponctuant ce « oui » que le surhumain s’adresse, et qui n’est autre que la figure de l’analysant en analyse.
Ce que peut offrir une analyse, ce n’est donc pas une guérison de nos symptômes, mais l’acceptation de ceux-ci par leur compréhension généalogique. De la même façon, chez Nietzsche, la maladie ne s’oppose pas à la santé, pas plus que la souffrance ne s’oppose à la joie : la vie est tragique, et c’est parce qu’elle l’est, qu’elle doit être tragi-comique. Il nous faut rire avec « bonne conscience » de nos malheurs, de nos erreurs. Car rien n’est de notre faute, mais tout est de notre fait. Nietzsche le dit ainsi dans le Crépuscule des idoles : « Nul n’est responsable d’exister de manière générale, d’être comme ceci ou comme cela » (Crépuscule des idoles, « Les quatre grandes erreurs », § 84). Le malheur vient à celui qui pense qu’il aurait pu faire autrement, ou qui regrette ce qu’il a fait ou ce qu’on lui a fait. Dans le premier cas, cela confine à la mélancolie, dans le second cas, au ressentiment – cet « affect de la haine rentrée », lit-on dans la Généalogie de la morale. Vouloir que son passé soit autre, c’est se vouloir autrement que l’on n’est. Autrement dit, c’est se déprécier soi-même, infirmer celui que je suis devenu, se dénier toute légitimité (le syndrome de l’imposteur, c’est cela : je suis devenu celui que je n’aurai pas dû être). L’analysant comme le surhumain se veulent eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils disent « oui » à leur passé, et se retourne sur lui en disant – comme Nietzsche dans Aurore – « tout ça, c’est moi » (Aurore, § 285). Affaire, encore une fois, de scansion et de ponctuation. Il s’agit de se réveiller chaque matin et de se dire : « quel malheur serait-ce, si je n’avais pas été moi ! »
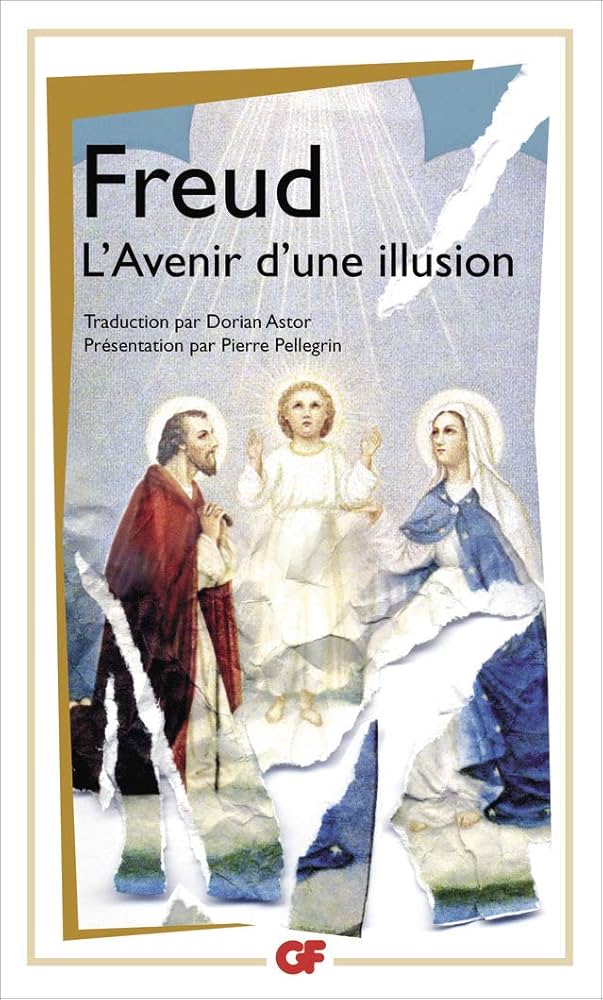
Au contraire de ce l’on peut penser, cette éthique nietzschéenne ou psychanalytique est, par son abdication heureuse devant le réel, d’une grande modestie. Ce que Freud nous promet, dans L’Avenir d’une illusion, n’est rien de plus qu’une « éducation à la réalité »5. Dans le principe de plaisir, le sujet tend à satisfaire sa jouissance immédiatement ; il souhaiterait que le monde entier se plie à ses désirs. Il s’agit non seulement de « jouir sans entraves », mais de jouir à tout prix, de tout, et tout de suite. Le principe de réalité, au contraire, est le principe par lequel l’individu comprend qu’il y a de l’inéluctable et du nécessaire. Au fond, ce principe de réalité est énoncé par la formule canonique et lapidaire de Descartes (stoïcienne, s’il en est!) : « Mieux vaut changer ses désirs plutôt que l’ordre du monde ». Quand le principe de plaisir ne voit aucun inconvénient à vouloir changer le monde, plutôt que ses désirs ; cette « éducation à la réalité » nous intime à régler notre désir sur ce qui est possible et à notre portée. Autre version pour dire que la psychanalyse nous apprend non pas à découvrir une volonté toute puissante en nous, mais la puissance de notre volonté.
La volonté de puissance doit être entendue, en cela, en son génitif subjectif : elle n’est une volonté illimitée, mais la volonté de ce qui est possible. Le dicton est donc trompeur ! Car ce n’est pas quand on veut, qu’on peut, mais c’est qu’on peut, qu’on veut. La puissance précède la volonté, et non l’inverse. C’est parce qu’on peut quelque chose, qu’on le veut. Ne pourrait-on pas, à ce point, tenter de formuler une sorte d’éthique de la psychanalyse (du point d’aboutissement d’une analyse pour l’analysant) et du nietzschéisme ? Elle pourrait se formuler ainsi : « veux-toi, toi-même, et fais du mieux que tu peux » (ça ne mérite guère de roulements de tambour, mais le plus simple est le plus difficile!). Une telle éthique nous rappellerait au sage stoïcien qui s’accommode du monde tel qu’il est, mais tout encore au sage spinoziste dont la sagacité s’éprouve dans l’acquiescement à soi et la réalisation d’une puissance parfaite en son genre.
C’est ce que le développement personnel – ce gloubi-boulga d’un stoïcisme évidé de sa substance et de son intelligence – rate. Celui-ci ne fait qu’accompagner le dispositif époqual qui est le nôtre, en produisant des injonctions intenables, et par conséquent culpabilisantes, de performance, de confiance en soi, de volontarisme, de contrôle de soi, de santé psychique et physique. Nous voilà sommés d’être sain(t)s ! De sorte que le symptôme de notre temps est d’être littéralement un saint homme (saintôme). Il y a tout lieu, pourtant, de se méfier de tous les Comités de salut public – surtout lorsqu’ils travaillent pour le « privé », c’est-à-dire pour les intérêts marchands. Il n’y a de Self qu’au self-service, pour le reste : ma volonté ne peut rien. Encore faut-il avoir levé toutes les déterminations inconscientes qui nous contraignent dans notre existence, en faisant du Je le jouet ou le hochet de l’inconscient, pour agir au-delà de toute répétition. A glorifier la volonté, et la toute-puissance de l’esprit sur le corps, on en vient à produire des haut-le-corps, des nausées existentielles, un dégoût pour soi-même. Comme le disait Spinoza dans la célèbre Lettre LVIII à Schuller : l’homme se croit libre, en ce qu’il a conscience de ses désirs, en ignorant qu’il est déterminé par des causes dont il ne sait rien. Ainsi en serait-il de cette pierre qui prendrait conscience d’elle-même dans sa chute, et qui se croirait libre d’embrasser ce mouvement, en ignorant que ce qui le cause est la pesanteur terrestre. Image qui, à tout le moins, nous dit quelque chose de ce Soi réifié, dont la gravité le fait ployer vers la Terre, quand sa volonté voudrait le maintenir droit. Le développement personnel est ce discours illusoire qui nous culpabilise de ne pas réussir à éviter la chute des corps6.
Dans Les Joyeuses commères de Windsor, Shakespeare résume poétiquement cette éthique de l’analysant et du surhumain : « Ce qu’on ne peut éviter, il faut l’embrasser ». Il y a donc de l’inévitable, de la fatalité, celle que Nietzsche appelait précisément, en l’écrivant en français dans le texte : le «faitalisme». Le fatalisme du fait, de la factualité du monde. A la manière des âmes platoniciennes dans le mythe d’Er au livre X de La République : nous devons accepter notre sort, le sort que Lachésis, déesse de la Nécessité, a décidé pour nous. Il s’agit de faire de mauvaise fortune, bon cœur, c’est-à-dire d’apprendre à s’avoisiner, à se résigner à être soi, à se dire « oui », pour le pire comme pour le meilleur. « Oui, je me veux » – voilà le seul mariage réussi d’une vie7 ! C’est ainsi que Nietzsche peut dire dans Le Crépusucle des idoles : « On est nécessaire, on est un pan de fatalité, on appartient au tout, on est dans le tout » (CId, « Les quatre grandes erreurs », § 8)8. »
Une autre expression française touche avec justesse à cela : « faire de nécessité, vertu ». On sait que, chez Nietzsche, la vertu est ramenée, dans Ecce homo, à la virtu, c’est-à-dire non pas simplement à une disposition morale mais à une force, au sens d’une force de caractère. La vertu, la puissance même du surhumain, ce qu’il fait qu’il est une « force de la nature », est sa capacité à dire « oui », sans ressentiment, sans amertume, sans esprit de vengeance, à son passé ; c’est-à-dire à l’oublier. Voilà un autre point commun avec la psychanalyse : le sujet est malade avant tout de ce qu’il ne peut oublier. Et ce qu’on ne peut oublier, c’est le refoulé. Le refoulé n’est pas ce que la conscience a oublié, mais ce dont elle ne se rappelle plus, alors même qu’il continue à influer sur elle. Ce qui est oublié n’affecte plus l’existence, au contraire de ce qui est refoulé, et de qui ne cesse pas de refluer et de nous diriger, malgré nous. On pourrait relire toute la seconde Considération intempestive, sur l’utilité et l’inconvénient de l’histoire, et donc du passé, depuis ces thèmes. S’il nous faut nous rappeler à notre passé, c’est pour évider celui-ci de son passif qui nous empoisonne : la méthode généalogique, comme celle analytique, cherche à décharger le passé de ses affects négatifs, afin de libérer le corps de son fardeau. Faire de l’histoire ou faire son histoire n’est qu’un moyen pour se surmonter. Il y a du passé qui ne passe pas, et c’est ce refoulé qui ne cesse pas de peser sur le cerveau des vivants, dont Nietzsche, comme Freud, ont voulu nous libérer, en nous apprenant à recréer notre passé en le réinterprétant.
Aimer son destin, c’est serrer tout contre soi l’irréversible et l’inéluctable ; c’est apprendre à ponctuer son histoire par l’affirmative.
Mais qu’est-ce que cela peut signifier pour nous aujourd’hui ? Quelles leçons philosophiquement peut-on tirer concrètement de Nietzsche et de Freud, pour vivre mieux ? Eh bien, ceci que : le destin, en somme, c’est l’inconscient ! Nous sommes, involontairement, pris dans la répétition d’une histoire qui nous écrit, plus que nous l’écrivons. On se croit le scénariste de notre vie ; on en est le personnage au beau milieu d’autres personnages. J’aime le mot arabe de « mektoub » – le destin –, qui littéralement signifie : « c’est écrit ». Je ne crois pas en la prédestination d’un Dieu, à moins que Dieu soit inconscient, comme le suggérait parfois Lacan, mais je crois que notre vie est écrite ailleurs, dans le refoulement de certains de nos souvenirs, dans le refoulement des accidents de la vie, dans certains mots censurés, ou encore dans ces mots d’amour qu’on attendait et qui ne sont jamais venus. Nous sommes écrits par cette histoire dont nous avons perdu le fil. Enfant, je dévorais la collection « Ce livre dont vous êtes le héros ». A l’instar de ces livres, les choix sont contraints, et les scenarii écrits d’avance ; dès lors, si l’on ne peut être le héros, au moins peut-on faire son numéro. Notre seule liberté est d’apprendre à « danser dans les chaînes » (Nietzsche). A l’image du chien, chez les stoïciens, qui, accroché avec une laisse à l’essieu d’un char, se voit offrir deux solutions : soit subir le mouvement forcé du véhicule tiré par deux chevaux ; soit accompagner ce mouvement, en l’acceptant. Aimer son destin, c’est ainsi prendre à bras le corps ce à quoi on ne peut se dérober ; c’est serrer tout contre soi l’irréversible et l’inéluctable ; c’est enfin apprendre à ponctuer son histoire par l’affirmative, et un point d’exclamation. Point que l’on appelait encore jusqu’au 18° siècle : un point d’admiration. « Tout ça, le bon comme le mauvais, c’est moi ! ».
Si « le style, c’est l’homme même », ainsi que l’écrivait Buffon, et que Lacan citait au commencement de ses Écrits, ce style réside avant tout dans la façon dont nous narrons notre histoire, et dont nous la ponctuons. Donner du style à sa vie, c’est apprendre à la ponctuer autrement que par des points de suspension, mais peut-être davantage par un point d’exclamation9. J’aime follement celles et ceux qui se racontent sans remords ni regrets. Au style pathétique et élégiaque, ils se racontent de manière épique et laudative. On appelle ça communément des « grandes gueules ». Leur vie fait envie. A-t-elle été si extraordinaire ? Loin s’en faut ! D’une sardine, ils en font une baleine. Et les fruits de leur vie sont infiniment plus beaux que ce que leurs fleurs promettaient. Mais justement !, justement, en donnant une forme mythique, voire homérique, au tout de leur existence, ils grandissent celui ou celle à qui ils parlent. Les lamenteurs attirent la pitié et rapetissent tout jusqu’à eux ; les enjôleurs, en s’élevant peut-être exagérément, provoquent un phénomène d’aspiration. Il faut être, comme Nietzsche, de « ceux qui embellissent les choses ». Ceux-là sont des figures de style à eux seuls ; de grands stylistes. Ils font de leur histoire, une histoire monumentale. Être auteur de sa vie, c’est avant tout choisir le caractère dans lequel on l’écrit10Ce qu’affirmait déjà Le Gai savoir, le seul gai savoir que, nietzschéens et analysants, partagent en propre : « Donner du style à son caractère, voilà un art grand et rare11. »
- Nietzsche, Ecce Homo. Nietzsche contre Wagner, traduction, introduction et notes par É. Blondel, GF Flammarion, 1992. ↩︎
- Nietzsche, Le gai savoir, trad. Pierre Klossowski, Paris, Folio essais, 2008. ↩︎
- Lacan, Ecrits, I, Paris, Seuil, collection « Points », 2006, p.298. ↩︎
- Nietzsche, Crépuscule des idoles, traduction par É. Blondel, Hatier, 2001. ↩︎
- Freud, L’Avenir d’une illusion, IX, trad. Dorian Astor, Paris, GF Flammarion, 2019, p.111. ↩︎
- Voilà bien un discours contemporain (c’est-à-dire content pour rien), qui croit avoir inventé l’eau chaude, parce qu’il ignore que ses aïeuls l’ont déjà fait bouillir. ↩︎
- On connaît la phrase de Wilde : « il faudrait être toujours amoureux, c’est pour cela qu’il ne faudrait jamais se marier. » Et il ajoutait : « S’aimer soi-même est le début d’une histoire d’amour qui durera toute une vie. » ↩︎
- Nietzsche, op.cit. ↩︎
- Ce qui est autre chose que de la ponctuer de trois points de suspension. En disant, à l’instar du Pessoa, poète admiré des romantiques : « mon passé, c’est tout ce que je n’ai pas réussi à être ». ↩︎
- Au sens typographique mais aussi psychologique. ↩︎
- Nietzsche, Le gai savoir, §290, trad. Pierre Klossowski, Paris, Folio essais, 2008. ↩︎
